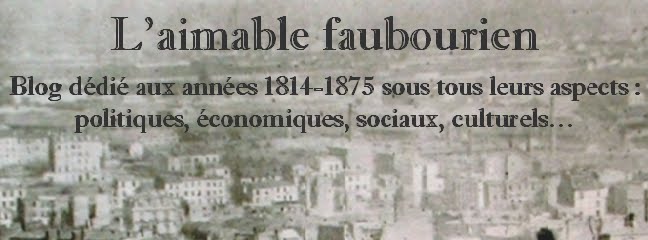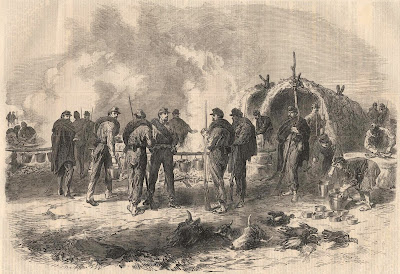Victor Duruy (1811-1894), ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869. Portrait en héliogravure tiré de V. Duruy, Notes et souvenris, t. 2, Paris, 2e éd., 1902.
« Monseigneur,
Dans la lutte engagée entre M. Duruy et nous, un grand nombre de nos vénérés Collègues alarmés comme je l'ai été moi-même, se sont hâtés d'élever la voix. Vous n'avez pas manqué, Monseigneur, de donner à la grande cause que nous défendons le puissant appui de votre parole, comme toujours si élevée et si ferme. L'Église et toutes les familles chrétiennes vous en seront reconnaissantes.
Vous le dites avec raison, Monseigneur, l'entreprise de M. Duruy est "sans précédents dans l'histoire des sociétés, depuis que, devenues chrétiennes, elles ont environné la femme de respect et d'égards." Comme vous le dites encore, "c'est un fait inouï" qu'un ministre puisse ainsi changer, seul et à son gré, et radicalement, les conditions de l'enseignement des jeunes filles en France, le transporter des mains des femmes aux mains des hommes, destiner aux jeunes filles, de sa pleine autorité, sur tout le territoire français, les 3.000 professeurs que la loi donne aux jeunes gens ; qu'il ose de pareilles tentatives, sans consulter personne, ni le Conseil d'État, ni le Corps législatif, ni le Sénat, ni même le Conseil supérieur de l'instruction publique, sans se préoccuper en rien des embarras qu'il crée, et créera de plus en plus au gouvernement ; et se lance enfin de la sorte, sans frein ni guides, à travers les questions les plus délicates et les intérêts les plus sacrés. […]
Quoi ! des cours réguliers, quotidiens, de jeunes filles, six jours de la semaine, deux fois par jour, dans le quartier latin, à la Sorbonne, c'est-à-dire au lieu où se tiennent tous les professorats littéraires et scientifiques, où se font tous les cours des jeunes gens, tous les examens des bacheliers, etc., etc. !
Le quartier latin ! M. Duruy a-t-il donc oublié ce qu'il est ? Pour moi, malgré l'entrée par la rue Gerson, je ne suis guère rassuré sur ce quartier-là, et je n'ai pu qu'être fort attentif aux paroles d'un des plus honorables fonctionnaires de noire ville qui s'écriait, à propos de tout cela : "le quartier latin, il est donc bien changé depuis notre temps ! Appeler là les jeunes filles, mais cela n'a pas le sens commun !"
J'ai moi-même été professeur à la Sorbonne, et je n'en ai jamais traversé les cours et les abords, sans les voir, comme ils le sont encore aujourd'hui, remplis d'étudiants qui vont et viennent, qui attendent l'ouverture des amphithéâtres, ou, après les leçons des professeurs, se forment en groupes pour discuter. Ce sera donc au milieu et sous les regards de tous ces jeunes étudiants, dispersés dans les cours ou aux abords de la Sorbonne, que devront sans cesse passer les jeunes filles, pour se rendre aux leçons qu'institue M. Duruy !
Mais, dit-on, ces jeunes filles, elles ne seront pas seules, elles viendront chacune, à défaut de sa mère, avec une gouvernante. Mais quel âge aura cette gouvernante ? M. Duruy ne le fixe pas plus que l'âge des professeurs. Et celles qui n'ont pas de gouvernantes, et dont les mères sont trop occupées, c'est-à-dire le plus grand nombre, elles viendront là, avec une bonne, plus ou moins jeune : et au lieu d'un péril, en voilà deux. Ce n'est pas tout : elles peuvent venir seules, car on n'exige pas qu'elles soient accompagnées. Mais alors quelles garanties aura-t-on sur celles qui viendront ainsi, et, s'il faut tout dire, sur ce qu'elles pourront venir chercher là?
Non, tout cela est absolument impossible. Il y a ici une absence, ou du moins un oubli passager du sens moral, qui ne se conçoit pas. M. Duruy lui-même serait effrayé, si je lui répétais le mot qu'un homme d'État éminent me disait, il y a peu de jours, sur le péril de ces étudiants et de ces étudiantes ainsi obligés sans cesse à se rencontrer. […]
Ce sont là les premiers pas dans une voie qui mènera loin, si le bon sens public ne fait résistance. Bien aveugle qui ne le voit point ! Et ceux d'ailleurs qui n'ont pas ici leurs raisons pour mettre des gants et des masques, ont dit nettement les choses, et déchiré tous les voiles.
Le jour même où ma lettre sur M. Duruy et l'éducation des filles était imprimée, et avant qu'elle eût paru, Le Siècle voyait dans cette circulaire de M. Duruy le moyen d'arracher les femmes "au joug de superstitions ridicules, et de préparer des générations nouvelles." (16 novembre.)
Quand la lettre eut paru, Le Siècle écrivit : "je demande, dit M. Dupanloup, qu'on ne forme pas pour l'avenir des femmes libres-penseuses ! Nous le croyons sans peine. Avec des femmes libres-penseuses, plus de superstitions, plus de confréries de la Vierge dirigées par des prêtres, plus de denier de saint Pierre, plus d'influences cléricales, plus de riches offrandes !" Puis Le Siècle ajoutait : "que (M. Duruy) crée le plus tôt possible une école normale supérieure de professeuses ! Pour vaincre l'ennemi qui fait obstacle à tout progrès, il n'y a qu'un moyen, un seul : instruire les femmes pour qu'elles instruisent les jeunes filles, et former des libres-penseuses." (Le Siècle, 20 novembre.)
Selon L'Opinion nationale, et c'est pour cela qu'elle applaudit à M. Duruy, le but de la circulaire, c'est d'arracher l'éducation des filles à la religion, au catholicisme, à l'Église. C'est ce que L'Opinion appelle organiser "l'enseignement laïque des femmes". "C'est là, dit-elle, une question vitale pour le pays. En effet, le Clergé tient tout en France par les femmes, et il tient les femmes par l'éducation. La plupart des filles sont élevées chez les religieuses. Par là, les prêtres sont les maîtres chez nous, dans nos maisons. Si bas ou si haut que vous portiez les regards, ils ont dans chaque intérieur un œil sans cesse ouvert et une influence toujours active." […]
Selon Le Temps, la portée de la circulaire, "c'est d'enlever définitivement la direction des esprits à l'Église, c'est de consommer la sécularisation des intelligences. […]" (Le Temps, 21 novembre.) Le Temps dit encore : "il s'agit de savoir si le prêtre, qui tient encore la femme, recouvrera par son moyen l'empire sur la société, eu si la société achèvera de s'affranchir du prêtre, en lui enlevant la femme, pour la faire participer à la culture cl à la vie générales. Au fond, et en définitive, c'est le sort de la France qui est en question." (Le Temps, 21 novembre.) […] Enfin, un professeur de l'Université, qui intervient dans la question, choisit le Siècle pour écrire ce que voici : "nous voulons pour nos filles un enseignement secondaire qui soit plus en harmonie avec l'enseignement que reçoivent nos garçons.... qu'elles puissent lire dans le même livre que nous et y puiser les mêmes pensées" : c'est-à-dire, comme dit Le Siècle, devenir de libres-penseuses. Puis il continue en ces termes : "vous dont la vie tout entière se passe à étouffer tous les sentiments que la nature a mis dans l'homme, vous voulez la domination sur la femme pour dominer l'homme à son tour, vous voulez la retenir sous votre joug et la maintenir sous votre autorité afin de commander par elle dans la famille." (Le Siècle, 21 novembre). […]
Comme honnête homme, je vous demande : quelle France voulez-vous nous faire ? Et que lui restera-t-il de pudeur et d'honneur ? Et jusqu'où voulez-vous aller enfin, puisque vous trouvez "bien modeste encore l'effort que fait en ce moment M. Duruy pour tirer les femmes de l'ignorance, où le clergé se plaît à les voir c et à les maintenir." (Opinion nationale, 23 novembre.) […]
Tout cela est profondément triste, Monseigneur, mais à un point de vue, tout cela est heureux, et, dans la tristesse de mon âme, je bénis Dieu. Car le péril qui s'est tout à coup révélé ne date pas d'hier ; mais nous ne le voyions pas assez. Depuis quelques années l'Église est tellement menacée au dehors, et les passions impies et démagogiques, dans toute l'Europe, attaquent tellement tout ordre religieux, moral, et social, que nous n'avons pu toujours suivre d'assez près la marche et les progrès de l'impiété parmi nous. Sur cette grave question de l'enseignement public, il y a trop longtemps que les hommes religieux se sont laissés distraire. Nous sommes ainsi faits en France. La mode a chez nous une puissance étonnante. Ces questions ont été longtemps à l'ordre du jour : que de discours, de livres, de commissions, de pétitions, de projets sur l'enseignement pendant vingt ans ! Puis on passe à autre chose, et on n'y pense plus. Pendant ce temps, M. Duruy, et ses alliés, les livres et les circulaires font leur œuvre. Eh bien, si cette dernière circulaire nous réveille, je le dis, elle est heureuse.
Pour moi, il y a longtemps déjà que les actes et les livres de M. Duruy en particulier m'occupent, et que j'ai examiné et fait examiner, avec le dernier soin, non-seulement ses écrits, mais une quantité d'ouvrages historiques publiés en collaboration avec lui, sous sa direction personnelle (*), et répandus avec profusion dans nos lycées et dans nos écoles ; et j'en ai été effrayé.
Quand je pense que le Ministre de l'instruction publique d'une nation comme la France, dans une introduction solennelle à notre histoire, marchant sur les traces de ceux qui font de l'homme un orang-outang perfectionné, ose donner pour ancêtre à l'homme le singe, et pour point de départ à l'humanité l'état sauvage ; quand j'entends Le Moniteur universel, le journal officiel de l'Empire, nommer, lui aussi, et avec agrément, le singe un ancien congénère de l'homme, son aïeul peut-être (2 mai 1864) ; et ailleurs donner à la France des leçons de haute morale comme celle-ci : "l'homme n'est pas une intelligence servie par des organes, comme on l'a dit en style prétentieux, mais un organisme qui s'est élevé par degrés jusqu'aux plus fiers sommets de la pensée." Et un peu plus bas : "la véritable histoire du genre humain qu'il faut distinguer des légendes, atteste que le ventre fut le précurseur du cerveau. Nos premiers pères, ces anthropophages vénérés, avaient la tête bien petite, leurs crânes fossiles en font foi. La digestion a précédé la pensée, et de longtemps ; il y a des centaines de siècles entre ces deux ordres de phénomènes." (4 août 1867).
Quand je vois ces doctrines abjectes, honorées d'un tel patronage, élevées dans les plus hautes chaires de l’enseignement, décorées par la fortune, mais en vérité je me le demande : où en sommes-nous donc, et où allons-nous ? Est-ce avec de telles bassesses qu'on préparera nos jeunes et vaillantes générations aux luttes de l'avenir, et les jeunes Françaises aux vertus sans lesquelles la famille et la société s'écrouleront dans des abîmes de honte et de douleur ! La vérité est que le mal social fait au dehors depuis dix années n'a d'égal que le mal fait au dedans par la presse impie, à laquelle en ce moment un ministre aveugle, c'est le moins que je puisse dire, bon gré, mal gré, donne la main. Et tout cela systématiquement, froidement, implacablement. […]
Encore quelques années de ce régime et de la résignation plus ou moins expresse, plus ou moins silencieuse des honnêtes gens, et l'on recueillera la moisson de tout ce qui a été semé. Et déjà l'on commence. Les plus funestes doctrines faisant explosion, les grandes écoles de radicale impiété, l'athéisme, le matérialisme, et les théories les plus subversives de toute morale, s'étalant avec audace, se propageant avec une ardeur redoublée par l'espérance d'un prochain triomphe, voilà ce que nous voyons.
Pour moi, ma conviction profonde est que nous ne pouvons pas fermer les yeux plus longtemps. Et quand je vois ces graves questions de l'enseignement, qui portent en elles la vie ou la mort des sociétés, traitées comme elles le sont par M. le Ministre de l'instruction publique, je ne puis pas ne pas être ému, et ne pas le dire. Non, c'en est trop, et il faut qu'on sache enfin si les grands pouvoirs publics n'ont rien à voir sur de pareilles entreprises. […]
Veuillez agréer, Monseigneur, l'hommage de tous mes bien dévoués respects.
† FÉLIX, Evêque d'Orléans. »
_________________[note du texte] "50 volumes, format in-12, publiés par une société de professeurs et de savants, sous la direction de M. V. Duruy, 1852".
Félix Dupanloup, Seconde lettre de Mgr l'évêque d'Orléans
sur M. Duruy et l'éducation des filles, Paris, Charles Douniol, 1867.