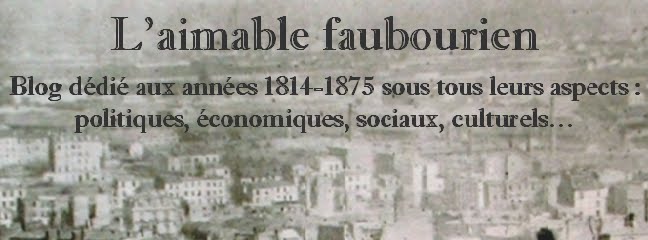« HYGIENE PUBLIQUE.
DE L'INFLUENCE DE QUELQUES UNES DE NOS LOIS FISCALES SUR LA SANTE PUBLIQUE.
Pour bien apprécier l'influence de nos lois fiscales sur la santé publique, il importe de considérer chacune de ces lois en particulier : il y a en effet sous ce rapport une très grande différence entre les impôts directs et les impôts indirects. Le législateur a cherché dans l'établissement des premiers à prendre pour base proportionnelle la fortune des citoyens, tandis que dans notre système d'impôts indirects on n'a aucun égard aux facultés diverses des particuliers; on atteint indistinctement toutes les classes de la société ; il y a plus, et nous le prouverons tout à l'heure, on atteint plus particulièrement les classes pauvres, on aggrave leur misère, et conséquemment on altère leur santé. Mais passons à l'examen de ces lois en particulier.
La contribution des portes et fenêtres n'est autre chose qu'un impôt sur la lumière et sur le renouvellement de l'air. Dans un ouvrage présenté tout récemment à l'académie des sciences, un auteur établit qu'il y a un rapport direct entre les lumières de l'esprit et celle qui pénètre par l'ouverture de nos maisons, et que ce rapport entre l'instruction et le nombre de ces ouvertures est parfait, c'est à dire que plus il y a déportes et fenêtres, plus il y a d'instruction, et réciproquement ; en sorte que toutes les fois qu'en traversant un pays on voit des maisons ayant beaucoup de portes et fenêtres, on peut en conclure que l'instruction y est répandue.
Nous trouverons, nous, un autre rapport non moins formellement établi, c'est que le nombre des maladies, et particulièrement des maladies scrofuleuses, est précisément en raison inverse du nombre des portes et fenêtres; de sorte que toutes les fois qu'en traversant un pays, on voit des maisons presque entièrement privées de fenêtres, on peut en conclure que les maladies scrofuleuses règnent dans les mêmes habitations; et il n'est que trop avéré que dans beaucoup de villages, les habitants, pour diminuer le fardeau de leurs impôts, prennent le parti de boucher leurs fenêtres ; dans un village de Picardie, nommé Oresmaux, des familles entières ont fini par succomber, atteintes qu'elles étaient toutes de scrofules ; M. Baudelocque en a recherché les causes : la plupart des maisons, construites en terre, n'avaient pas décroisées (Etud.sur la mal. scroph., page 244).
M. Baudelocque rappelle dans son ouvrage que, suivant une tradition fort ancienne, le sacre conférait aux rois de France le pouvoir de guérir les scrofuleux, et que l'attouchement eut encore lieu lors du sacre de Charles X. Suivant M. Alibert, ancien médecin de ce roi, la chose était louable, en ce que le pouvoir profitait de celle occasion pour faire des libéralités ; suivant nous, le meilleur attouchement eût été d'exempter d'abord les malades de l'impôt sur les portes et fenêtres, et d'accorder des primes d'encouragement à tous ceux qui par un bon système de ventilation, de renouvellement de l'air, auraient mis leurs familles à l'abri de celle maladie. Mais je passe à des impôts dont l'action sur l'état sanitaire des populations est bien moins contestable encore, je veux parler des impôts indirects et des prélèvements des octrois.
Voyons d'abord l'impôt sur le sel : pour faire sentir combien cet impôt est onéreux, et comment, par sa nature même, il tend à altérer l'état sanitaire des classes les moins aisées de la société, il faut parler de l'usage du sel et de son indispensable nécessité.
Il résulte de quelques recherches faites tout récemment par mon compatriote M. Barbier, que chaque individu consomme, terme moyen, de trois gros à une once de sel par jour; que, quelle que soit l'abstinence, la sévérité du régime, imposées à certaines sectes religieuses, leur santé peut se conserver intacte, mais à la condition d'user d'une certaine quantité de sel ; on a vu d'une part des individus soumis au régime le plus austère, mais usant de sel, conserver les attributs de la plus belle santé, et d'autre part des paysans russes, bien nourris d'ailleurs, mais forcés par leurs seigneurs de s'abstenir de sel, tomber dans un état de dépérissement rapide. Ainsi, dit M. Barbier, nos humeurs ne tardent pas à se détériorer, nos tissus organiques à perdre de leur intégrité normale, quand une certaine quantité de sel ne pénètre pas journellement dans la machine humaine ; mais il y a un autre fait non moins important, surtout lorsqu'il s'agit de constater les effets d'une mesure fiscale, c'est que la consommation du sel diminue en proportion de la délicatesse des aliments ; chacun sait, en effet, que les aliments tirés du règne animal exigent peu de sel pour leur digestibilité, tandis que ceux qu'on tire exclusivement du règne végétal en exigent une bien plus forte proportion, d'où il résulte que la consommation du sel augmente d'autant plus que les aliments deviennent plus farineux, qu'ils deviennent plus grossiers. Il faut près d'une once de sel pour faire digérer un litre de haricots : de sorte que l'impôt sur le sel augmente précisément avec la misère du pauvre !!
Je ne parlerai pas de l'utilité du sel dans l'économie rurale, soit pour faire supporter aux animaux ce qu'on appelle la vie d'étable, soit pour rendre plus florissante la vie des prairies, soit enfin comme moyen prophylactique d'une foule de maladies, spécialement des affections cutanées et des cachexies séreuses : je ne parlerai pas non plus de l'utilité du sel comme moyen puissant de fertilisation pour le sol ; il est évident que c'est là un impôt qui ne pourrait être décliné par personne, et moins encore par le pauvre que par tout autre.[…] Mais le fait le plus important à signaler ici c'est que le besoin du sel est d'autant plus formel, d'autant plus impérieux, d'autant plus pressant, que l'alimentation est grossière et insuffisante ; de sorte que l'impôt sur sa consommation nous parait surtout devoir compromettre la santé des pauvres habitants des communes rurales.
Remarquons ensuite, comme conséquence de ce que nous venons de dire, que les- produits graduellement plus considérables de cet impôt, loin d'être un signe de prospérité publique, prouvent plutôt que la misère augmente, que le besoin de faire supporter une mauvaise alimentation devient chaque jour plus pressant et plus universel. Ce n'est donc un impôt bien assis, qu'en ce sens ; que nul ne saurait s'y soustraire, pas même le plus misérable, et que son produit augmente avec la détérioration de la santé publique, qui suit la perte du bien-être.
Sous la restauration, on a vu cet impôt grossir d'année en année : en 1814, il ne produit que 25 millions; en 1815, il passe 35 millions ; en 1818, ses proportions augmentent de nouveau, on lui voit atteindre 41.218.000 ; en 1821, 49 millions. Sous le régime actuel, il n'acquiert pas moins de force ; en 1835, il s'est élevé à 53.817.000 fr., sans comprendre les produits très considérables des salines de l'Est.
Bien que les produits des octrois ne soient portés que pour un dixième au budget général de l'Etat, que les administrations soient distinctes et spécialisées, je rapprocherai ici ces impôts des contributions indirectes et j'en examinerai les effets sur la population des villes. [...]
Le vin, pour les ouvriers des villes, ne devrait pas être un objet de luxe, mais bien un objet de première nécessité ; nos lois fiscales tendent à intervertir cet ordre naturel, cet ordre tout moral. Le vin est devenu pour les dernières classes un objet de luxe et de débauche ; aussi son usage, loin de tourner au profit de la santé du peuple, contribue plutôt à l'altérer. Les ouvriers n'introduisent guère de vin dans leurs ménages, ils n'en achètent ni pour leurs femmes ni pour leurs enfants, chacun sait que c'est surtout hors des barrières, le dimanche et les premiers jours de la semaine, qu'ils vont en boire pour échapper aux lois fiscales. Ainsi, pendant les jours consacrés aux travaux les plus pénibles, les privations sont rigoureuses pour les familles indigentes ; arrivent ensuite des excès qui augmentent la population des hôpitaux.
Peu de temps après le rétablissement des octrois, en l'an IX, le droit d'entrée des vins dans Paris était de 6fr. 60 c. par hectolitre ; en 1819, il était de 13 fr. 50 c. ; sous le nouveau régime ce droit a été porté à 18 fr. 50 c. Personne n'ignore que les droits sont les mêmes pour tous les vins ; mais, comme l'ouvrier prend cette boisson en détail chez les marchands de vins, il doit en payer d'abord la valeur réelle, puis les droits d'octroi, les droits de l'exercice des contributions indirectes, puis le bénéfice des marchands ; bref, le vin falsifié a triplé pour lui de valeur !...
Nous avons montré tout à l'heure la progression rapide du tarif des octrois de Paris depuis l'an IX jusqu'en 1833 ; or nous allons voir que la consommation, dans le même espace de temps, a suivi une marche inverse. En l'an IX, il est entré dans Paris 1.016.613 hectolitres de vin tarifé, comme nous l'avons dit, à 6 fr. 50 c.; en 1819, il n'en est plus entré que 805,499 hectolitres tarifés à 13 fr. 50 c., et en 1839, seulement 595.585 hectolitres tarifés à 18 fr. 50. Ce n'est pas tout, en l'an IX la population de Paris n'était que de 547.756 habitants; en 1819, elle était de 713.765, et en 1839 de 774.338 habitants. On voit d'après ces chiffres quelle réduction progressive a éprouvée la consommation de chaque individu !...
Les eaux de vie au dessous de 93° ont été tarifées à raison de 95 fr. l'hectolitre, et 18 fr. pour le compte du Trésor ; mais comme les ouvriers trouvent moyen de se stimuler et même de s'enivrer avec une quantité bien moindre d'eau de vie que de vin, il en résulte que dans l'intérieur de Paris, c'est sur l'eau-de-vie qu'ils se rejettent.
Parent-Duchâtelet a cité à cette occasion un fait remarquable : c'est que le régime des ouvriers débardeurs est très différent au delà et en deçà des barrières. Les ouvriers de Bercy ne boivent que du vin naturel, tandis que les ouvriers de l'intérieur ne boivent guère que de l'eau de vie ou du vin frelaté, aussi sont-ils presque toujours tourmentés de coliques ou de tranchées.
Toutes les viandes sont taxées, or la viande est un aliment indispensable aux ouvriers des villes. Les ouvriers sans travail, sans ressources, sentent tellement cette nécessité, qu'ils préfèrent manger une viande détestable à ne pas en manger du tout. En voici la preuve : il y a dans Paris deux établissements où l'on débite des têtes de moutons cuites et du bouillon fait avec ces mêmes têtes; l'un de ces établissements est situé près de la Grève, l'autre dans la Cité. Le potage, préparé dans une immense chaudière, distribué à discrétion, coûte un sou par convive. Les têtes, pourvu qu'on rende les os, coûtent de deux sous et demi à trois sous.
Mais il est à remarquer que tous ceux qui fréquentent ces établissements sont des hommes absolument fans ressources, que s'ils y vont, c'est à cause de leur extrême pénurie, de leur profonde misère; dès qu'ils ont du travail ils se gardent bien d'y retourner : ils achètent d'autres viandes.
L'impôt sur les viandes a été aussi en grossissant depuis l'époque de son rétablissement jusqu'à nos jouis; non pas tant sous le rapport de sa quotité générale que sous le rapport du tarif : je m'explique :
Depuis le rétablissement des octrois, la population de Paris a été sans cesse en s'accroissant, les besoins de cette cité ont dû s'accroître dans la même proportion ; d’un autre côté le tarif a été élevé ; il devait en résulter des produits beaucoup plus considérables ; mais il n’en a pas été ainsi ; ce tarif paralysait et même arrêtait la consommation dans les classes peu fortunées, en voici la preuve :
On voit d'après ce petit tableau que la consommation des viandes de bonne qualité a progressivement diminué depuis l'an IX jusqu'aujourd'hui; on voit d'un autre côté que la viande de vache n'entrait que pour une très faible proportion dans l'alimentation des habitants de Paris en 1819, mais que le tarif s'élevant de jour en jour, il a bien fallu en revenir à ces sortes de viandes, de telle sorte que dans les derniers temps on a consommé presque deux fois autant de viande de vache qu'en l'an IX, et presque cinq fois autant qu'en 1819.
La consommation des viandes de mouton et de veau a été au contraire en décroissant ; quant à celle de porc elle a été en augmentant, mais peut-être au détriment de la santé. J'ai dit plus haut, en parlant des boissons, que les ouvriers de nos villes, dans la presque impossibilité où les avait mis l'augmentation incessante des tarifs d'acheter du vin en suffisante quantité, s'étaient rejetés sur l'eau-de-vie qui produit des effets de stimulation à bien plus faible dose et à meilleur marché, j'en dirai autant pour la viande de porc et surtout pour les viandes à la main, viandes qui, sous un petit volume, produisent des effets plus marqués; ajoutons en outre que ces viandes sont vendues toutes préparées, ce qui les fait encore plus rechercher par la classe ouvrière.
D'après tout ce que nous venons de dire on conçoit combien des droits excessifs imposés sur l'alimentation première, indispensable, sont préjudiciables à la santé publique. La population s'accroît, et cependant les moyens de bonne alimentation vont en diminuant ; si donc d'autres éléments n'agissaient avec force sur le mouvement de la population on la verrait rapidement tomber par le fait de ces lois fiscales.
La somme totale de l'alimentation liquide et solide reste la même, du moins elle éprouve peu de variations; mais elle se détériore, elle devient d'autant moins saine qu'on élève les tarifs ; les ouvriers boivent autant que de coutume, mais ils boivent ou des vins falsifiés ou de l'eau-de-vie; leurs familles, leurs enfants boivent plus d'eau. Ils mangent toujours de la viande, mais la proportion des viandes de vache, de porc et de viandes à la main, est plus forte. Or, des deux côtés, veuillez en mesurer les effets sur la santé publique ; calculez les effets d'un régime composé de viande de vache, de têtes de moutons et d'eau ; ajoutez les effets d'un régime composé de charcuterie et d'eau-de-vie !!!
Sous le ciel de la France, et particulièrement sous celui de Paris, qui, chaque année, nous gratifie de cent quatre-vingts jours de brouillard, de cent quarante jours de pluie, et de vingt-un pouces d'eau, il faut de toute nécessité user de combustibles; aussi on s'est empressé d'imposer les combustibles. Ici encore, comme pour les boissons et les comestibles, le tarif s'est graduellement élevé et la consommation moyenne a diminué; donc la somme des privations a été en s'agrandissant.
C'est sur les deux extrêmes de la vie qu'ont dû nécessairement porter ces privations. S'il est un point de doctrine bien constaté en hygiène publique, c'est l'influence funeste des saisons rigoureuses sur les jeunes enfants et les vieillards. Pour deux enfants qui meurent en janvier, dit M. Quetelet, ou n'en perd qu'un seul au mois de juillet. L'hiver recommence à faire sentir sa funeste influence après l'âge de 40 ans ; après 65 ans le froid est aussi a craindre pour les vieillards que pour les enfants nouveau-nés. […]
Il y a plus : nous pourrions donner à cet égard une sorte de contrépreuve. Il existe une petite ville à quatre lieues de Lyon sur la rive droite du Rhône et qu'on nomme Givors. M. Brachet en a relevé les décès avec soin, et à son grand étonnement, il a trouvé que le maximum de la mortalité pour les enfants y est déplacé, qu'il n'est plus le même qu'à Paris ; l'hiver n'y exerce plus sa funeste influence sur le premier âge de la vie. Le froid cependant n'est pas moins vif à Givors qu'à Paris, mais, dit M. Brachet, les moyens de s'en garantir y sont très communs; pour la classe ouvrière et surtout pour les ouvriers de la verrerie, le chauffage ne coûte rien ; ils ont leur tour à recueillir ce qu'on appelle le grésillon ou charbon brûlé ; chacun a un bon feu chez soi.
Ceci confirme pleinement cette vérité que l'homme, comme être intelligent, sait et peut réagir contre les climats, qu'il peut en atténuer les mauvais effets, les annihiler même ; mais, pour cela, il ne faut pas que la misère vienne lui en ôter les moyens.
Qu'on établisse en effet à Givors des lois fiscales sur la consommation des combustibles, sans oublier le grésillon, et bientôt vous verrez le maximum de la mortalité des enfants retomber en hiver et dès lors vous aurez une augmentation considérable dans cette mortalité ; car le maximum d'hiver l'emporte nécessairement sur le maximum d'été.
Mais pour justifier la nécessité, la rigueur de ces sortes d'impôts, en nous objectera sans doute que la majeure partie des sommes perçues est précisément employée à secourir les indigents et les malades. Pour apprécier cette objection à sa juste valeur, il faut tout simplement examiner combien on exige des pauvres contribuables et combien on leur donne.
On a établi qu'en France la moyenne des impôts est actuellement de 31 fr. 35 cent, par individu ; mais par suite des exigences locales, dont je n'ai fait connaître qu'une partie, dans certaines villes la moyenne s'élève annuellement à 100 fr., et ceci est rigoureusement vrai pour les individus qui touchent à l'indigence. Or, après mille expédients, après tant d'appels à la philanthropie des riches, tout ce que les bureaux de charité peuvent accorder aux indigents inscrits sur leurs livres ne va pas au delà de 20 fr. par an ! Comparez.
Sans doute c'est pour leurs dépenses locales que les communes ont été autorisées à s'imposer extraordinairement, à s'entourer d'octrois ; nous savons qu'une partie des rentrées doit faire face aux frais des hôpitaux, des hospices et des secours à domicile ; mais nous avons vu que l'assiette de ces impôts est telle qu'elle accroît nécessairement d'année en année le nombre des indigents et des malades. C'est comme une vaste plaie qu'on veut guérir aux dépens des parties malades elles-mêmes. [...]
Dubois (d’Amiens). »
L'expérience: journal de médecine et de chirurgie (publié par J. E. Dezeimeris), n° 83, 31 janvier 1839.