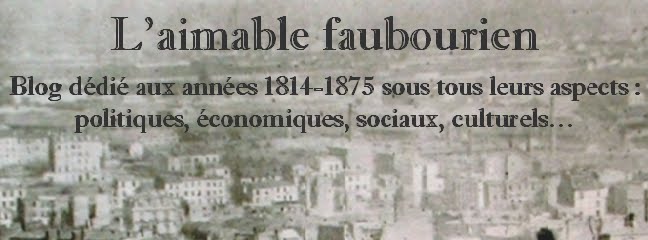« Le Jeune d’Arcole ou le Pont de la Grève.
Le Jeune d’Arcole appartenait à cette classe laborieuse d’ouvriers qui trouve son bonheur dans l’accomplissement de ses devoirs et le travail. Les parents d’Arcole avaient plusieurs enfants qu’ils élevaient de leur mieux. Ces bonnes gens se suffisaient par une honnête industrie et beaucoup d’ordre. Le héros de cette histoire était âgé de quatorze ans et travaillait en qualité d’apprenti chez un serrurier. Levé dès l’aurore, on voyait chaque jour le jeune Philippe d’Arcole, après avoir embrassé ses parents, rendu à sa mère de ces petits services qui sont utiles à un ménage pauvre, mais ordonné, conduire à une école gratuite du voisinage ses deux plus jeunes frères, et de là se rendre chez son maître pour y faire sa journée.
Philippe était un bon fils, bon frère et apprenti soumis. Son maître se louait toujours de son assiduité au travail ; et déjà, pour l’en récompenser, d’Arcole recevait tous les samedis une somme de cinq francs qu’il portait fidèlement à sa mère.
Le dimanche, on voyait l’heureuse famille réunie et aller ensemble, père, mère et enfants, faire autour de Paris de ces parties innocentes, qui peignent le bon accord et les bonnes mœurs. Le père de Philippe avait été sergent dans la vieille garde ; il avait fait toutes les guerres de la Révolution, et il était revenu sain et sauf des désastres de Moscou. Il fut l’un de ceux qui accompagnèrent le héros de la gloire française à l’Ile d’Elbe ; et ce n’est qu’après la catastrophe de Waterloo que le brave militaire unit son sort à la fille d’un honnête artisan. Tous deux vivaient heureux d’un petit commerce, et les enfants provenant d’une union aussi bien assortie, étaient l’exemple de leur quartier. [...]
Le 26 juillet 1830, le lundi, le vieux d’Arcole alla, contre son ordinaire, se promener avec aîné du côté des boulevards. Le vétéran de la vieille garde était un citoyen paisible, s’occupant plus de son petit commerce de fruitier, que des intérêts de l’Etat. Toutefois, quand il entendait parler de l’humiliation à laquelle ses anciens camarades étaient souvent exposés par les agents de Charles X, et qu’il se rappelait sa vieille gloire, son cœur se gonflait et ses yeux se remplissaient de larmes. Remarquant un poste de gendarmes qui s’éparpille au milieu d’un groupe de paisibles habitants de toutes les classes, il en demande la cause : son fils et lui écoutent. On parle d’ordonnances qui détruisent la liberté, qui annulent les élections, et cassent la chambre des députés… "Qu’est-ce que cela", dit-il ? Il se le fait expliquer. Chaque parole qu’il entend agite, émeut son cœur, et excite son courroux… Les satellites du Roi parjure sont devant lui ; il dit à son fils en les montrant de la main : "vois-tu ces soldats, il n’en ont que l’habit ; ils sèment la terreur parmi nous, et dont détester leur maître par la barbarie de leur conduite". Le jeune Philippe et son père, indignés, exaspérés de tout ce qu’ils ont vu, ne rentrent que tard à leur domicile après s’être mêlés aussi dans les groupes, et avoir manifesté tout ce que leur cœur excité par l’exemple, leur inspirait contre la force armée.
Le lendemain 27, l’ex-sergent de nos vieilles bandes, sans rien dire à sa femme, sort avec son fils, et lui dit : tu n’iras point aujourd’hui chez ton bourgeois. Nous sommes accoutumés, l’un et l’autre à ne nous occuper que de nos affaires, et c’est en général ce qu’on peut faire de mieux ; mais il paraît qu’il ne peut pas en être de même aujourd’hui. Tout Paris se trouve dehors, il y a du nouveau sans doute ; il faut que nous voyions cela. Et les deux faubouriens se tenant par le bras, s’avancent de rues en rues, de groupes en groupes, et s’instruisent ainsi des vœux du peuple, de ses intentions et de sa résistance. Ils arrivent rue Saint-Honoré, près de la Place du Palais-Royal, au même instant où les troupes de Charles X font une décharge sur le peuple, dont la fureur augmente progressivement à la vue du carnage. A cet aspect, le vieux guerrier et son fils se jettent dans la mêlée ; l’un saisit le sabre, l’autre le fusil d’un gendarme. Leurs yeux étincèlent d’horreur, de courage et d’honneur ; leur action surprend d’abord ; les citoyens présents électrisés, se joignent à eux, les suivent, et voilà deux hommes obscurs, devenus les chefs et les libérateurs de deux troupes nombreuses. Le père d’Arcole embrasse son enfant et lui dit : "Va, mon fils, le sang qui coule dans tes veines appartient à la patrie ; cours de tons côté où le danger t’appelle, ne recule point devant lui, il est beau de mourir pour son pays ; tandis que tu feras ton devoir, je remplirai le mien". A ces mots, le sergent de la veille garde s’éloigne avec une troupe nombreuse qui fait retentir les airs et les cris de liberté. Le jeune Philippe dans ce moment se croit un géant, un Hercule ! L’exemple et le discours de son père l’ont électrisé pendant toute la soirée et une partie de la nuit, il est partout où il y a du danger, des lauriers à cueillir, et des citoyens à défendre. La troupe qui le suit obéit aveuglément à son énergie, malgré sa jeunesse.
Après mille dangers, après avoir affronté la mort qu’il brave et dédaigne, d’Arcole, le 28, se trouve en face de l’Hôtel-de-Ville, sur le quai aux fleurs, proche du pont de chaînes. Muni d’un fusil dont il a appris à se servir en tirant sur les ennemis du peuple, il commande un feu roulant sur les Suisses qui ont repris et défendent l’Hôtel-de-Ville, et en encombrent la place. Mes amis, dit-il à ses compagnons, ce ne sont pas des Français que nous combattons ; les mercenaires ne méritent aucune pitié. Imitez-moi ; et s’élançant sur le pont de la Grève : "A moi, camarades, s’écrit-il ! les balles tuent, mais ne font point mal ; je vais vous le montrer ; si je succombe, donnez mon nom à ce pont ; je m’appelle d’Arcole, cela nous portera bonheur". On le voit au même instant, percé des balles ennemies, tomber en expirant à l’entrée de l’arc en pierre qui supporte les chaînes des deux côtés du pont.
La vue de leur camarade baigné dans son sang rend les compagnons d’Arcole furieux ; ils ne connaissent plus aucun danger, ils se pressent sur le pont, bravent les balles et la mitraille, et la victoire est à eux. Partout la cause sacrée de la Liberté triomphe, et des cris d’allégresse se font entendre. Le malheureux d’Arcole, que ses compagnons de gloire entourent, est porté dans un hospice. Les soins les plus touchants lui sont prodigués, mais ses jours étaient comptés ; Dieu l’appelant à lui laissa un exemple de dévouement à suivre pour la patrie.
Avant de mourir, Philippe demanda que son convoi funèbre passât sur le pont témoin de leur bravoure. Sa famille et ses camarades en pleurs, suivis d’un cortège nombreux, s’y arrêtèrent. On a placé sur le pont témoin de l’héroïsme du jeune ouvrier, ces mots simples et touchants : le pont d’Arcole. »
A. de Sainte, Les enfans de Paris ou les petits patriotes, scènes de courage, de présence d'esprit, de magnanimité, de grandeur d'âme et de désintéressement de la jeunesse parisienne pendant les journées des 27, 28, 29 juillet 1830, Paris, Nepveu, 1831.
La mort de D'Arcole, dessin paru dans
A. Esquiros, Les martyrs de la Liberté, Paris, 1857.