« Un jour de l'automne dernier, Evélina était à son piano, étudiant sa leçon, quand la porte du salon s'ouvrit devant deux de ses amies qu'elle n'avait pas vues depuis plus d'un mois.
Evélina poussa un cri de joie, les autres en firent autant, et, selon l'habitude, les petites filles se mirent à s'embrasser en parlant toutes les trois à la fois. Questions et réponses partaient, se croisaient, comme les fusées d'un feu d'artifice.
Quelques minutes suffirent pour laisser passer ce flot de paroles, et alors ces demoiselles, un peu calmées parce qu'elles avaient déchargé leur cœur, commencèrent à causer raisonnablement. Ecoutons-les.
Marie : Nous savons en gros que vous êtes tous allés aux bains de mer, que vous vous êtes beaucoup amusés. Mais cela ne nous suffît pas ; il faut, ma petite Evélina, que tu nous racontes cela de fil en aiguille. […]
Berthe : […] D'abord où êtes-vous allés ?
Évélina : A Sainte-Marie ; c'est un hameau tout près de Pornic. Pornic est un petit port de mer situé sur la côte de Bretagne, à douze kilomètres au sud de l'embouchure de la Loire.
Berthe : Au sud ! Est-ce que tu vas nous parler comme un capitaine de vaisseau ? Le sud, est-ce à droite ou à gauche ? parle-nous comme tout le monde.
Marie : […] Vous avez donc passé un grand mois à Sainte-Marie, dans un tout petit village ?
Évelina : Dans un tout petit village. Figurez-vous une pauvre église de campagne, une espèce de grange surmontée d'un clocher; autour de l'église une trentaine de maisons jetées sans ordre, et au lieu de rues des chemins où en hiver il doit y avoir un pied de boue.
Berthe : Et vous ne vous êtes pas ennuyée à mourir dans un pareil endroit !
Évelina : Non ; et cela par une raison bien simple, c'est que si la maison que nous avions louée était à Sainte-Marie, nous n'y rentrions que pour manger et dormir : tout le reste de la journée nous étions au bord de la mer, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.
Berthe : Et que pouviez-vous y faire ?
Évélina : D'abord, prendre tous les jours notre bain ; ensuite, nous promener, chercher des coquillages, ramasser des moules, attraper des crabes, pêcher dans les flaques des petits poissons ; fureter dans les trous, sous les pierres, pour y trouver une foule d'animaux plus drôles, plus curieux les uns que les autres. Que sais-je encore ? Ce qu'il y a de certain, c'est que quand l'heure du déjeuner, du dîner ou du coucher arrivait, nous étions si affairés que nous demandions toujours des minutes de grâce pour achever quelque chose de commencé.
Marie : Et comment prend-on les bains de mer ?
Évélina : Voici la manière dont nous nous baignions. Il se peut qu'on se baigne avec plus de cérémonie ailleurs; j'ai entendu parler d'espèces de petites voitures qu'on roulait dans la mer; mais je n'ai rien vu de semblable, et je ne puis vous parler que de la méthode généralement suivie à Pornic et dans les environs.
Nous avions adopté, pour prendre nos bains, une petite anse située à dix minutes de Sainte-Marie, et presque au pied du phare de Pornic. Cette anse, creusée par la mer dans la ceinture de rochers qui borde la côte depuis Pornic jusqu'à l'embouchure de la Loire, semble avoir été faite exprès pour l'agrément des baigneurs. Ils y trouvent une plage du plus beau sable, unie et moelleuse comme un tapis, et si légèrement inclinée qu'en s'avançant dans l'eau on ne peut craindre d'être brusquement surpris par sa profondeur, puisqu'à chaque pas en avant cette profondeur augmente à peine d'un travers de main.
Au fond de cette anse le gardien du phare place tous les ans une rangée de cabanes qui ressemblent tout à fait aux guérites des soldats, à la seule différence qu'elles sont munies d'une porte pour s'enfermer et d'un carreau de vitre pour les éclairer. Le mobilier de chacune d'elles se compose d'un banc pour s'asseoir, d'un portemanteau et de chevilles pour suspendre ses habits, d'un petit miroir, et enfin d'une boîte pour placer sa bourse et sa montre quand on en a. C'est dans ces cabanes que nous nous déshabillions, et que nous mettions notre costume de bain... un joli costume, allez ! dans lequel on est fagotée à faire peur : il consiste en un large pantalon de grosse laine roussâtre, en une blouse fermée de même étoffe ; et il est complété par un serre-tête de toile cirée, qui empêche les cheveux d'être mouillés. Quand chacun avait fait cette superbe toilette et que nous étions toutes prêtes, nous prenions la corde...
Berthe : Quelle corde?
Évélina : Tiens, c'est vrai ; j'ai oublié de vous parler de la corde. C'est une corde solidement fixée à la tète de pieux qui s'avancent en ligne droite dans la mer. En allant d'un pieu à l'autre cette corde forme donc une espèce de rampe à laquelle on se tient à deux mains ; sans ce point d'appui des fillettes comme nous seraient renversées par les moindres vagues.
C'est donc en suivant la corde que l'on entre dans l'eau, et l'on va jusqu'à ce que l'on en ait presque au menton. Alors on danse, on saute, on s'en donne à cœur joie. Chaque fois qu'on voit arriver une lame plus haute que les autres, on crie : A la lame ! pour que tout le monde se mette sur ses gardes, c'est-à-dire serre la corde, et ferme la bouche ; et la vague vous soulève, et passe majestueusement au-dessus de vos têtes.
Marie : Alors vous vous trouviez tout à fait sous l'eau ? Et vous n'aviez pas peur ?
Évélina : Pas le moins du monde. Cela nous amusait, au contraire, beaucoup. On ne reste sous l'eau qu'un instant, pendant que la lame passe pour aller se fondre en écume sur le rivage. Quelquefois cependant nous étions bien attrapées ; c'est quand nous étions surprises par une lame pendant que, nous soulevant de terre, nous nous laissions flotter sur l'eau suspendues à la corde : c'était là notre manière de l'aire la planche. Mais pendant qu'on se balançait ainsi en babillant, arrivait sournoisement une lame qui vous coupait la parole et vous salait la bouche... et, pour vous consoler, on se moquait de vous.
Berthe : Mais si malheureusement, dans ces moments-là, vous aviez lâché la corde ?
Évelina : Vous ne sauriez vous imaginer combien on s'y cramponne, sans avoir besoin d'y penser, et par un mouvement naturel. Puis je suppose que cela me fût arrivé : la vague m'eût emportée vers le rivage, et laissée presque à sec sur le sable. De plus il y avait toujours là le maître nageur, prêt à nous repêcher, comme il disait. Enfin nous allions toujours nous baigner à marée montante, quand le courant et les lames portent à terre.
[…] Ce n'est que vers la fin de notre séjour à Sainte-Marie que nous n'avons plus pris nos bains avec le même plaisir, à cause de l'apparition d'une énorme quantité de méduses. Ce sont bien les plus dégoûtantes bêtes qu'on puisse imaginer. […] Eh bien, pendant les huit derniers jours que nous sommes restés à Sainte-Marie, non seulement on ne pouvait faire un pas sur la plage sans rencontrer des cadavres de méduses ; mais quand nous nous baignions, celles qui flottaient encore venaient à chaque instant nous passer sous le nez, et nous avons fini par ne plus entrer dans l'eau qu'une baguette à la main, pour les écarter de nous. »
C. G., Les enfants au bord de mer, Tours, Ad. Mame & Cie, 1851.
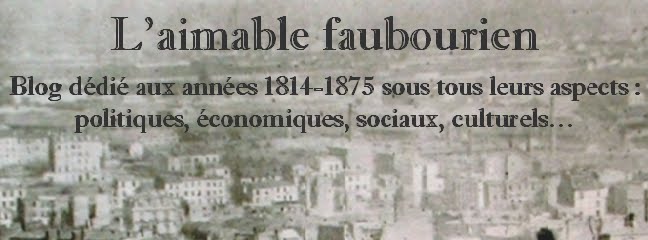
.JPG)

































