Ernest Louis Pichio (1840-1898), "Alphonse Baudin sur la barricade du faubourg Saint-Antoine, le 3 décembre 1851" (1869). Paris, Musée Carnavalet.
« Dans ce moment solennel de décembre 1851, où les libertés, la dignité et l'honneur de la France formaient l'enjeu de la lutte, c'est exclusivement aux républicains qu'appartient toute la gloire d'avoir engagé cette lutte avec courage, et de l'avoir soutenue avec énergie, tant que possibilité matérielle il y eut.
Réunis au café des Peuples, salle Roysin, les républicains décidèrent d'élever des barricades, et la première fut érigée au coin des rues Cotte et Sainte-Marguerite. Les troupes, vendues à Bonaparte, sillonnaient déjà tout Paris. La brigade Marulaz, avec des canons, occupait la place de la Bastille, et la brigade Courtigis, accourue de Versailles, se trouvait à la barrière du Trône. Un détachement du 19ème régiment d'infanterie légère vint attaquer la barricade ; il était conduit par le chef de bataillon Pujol et le capitaine Petit. La barricade fut attaquée et prise ; l'un des membres les plus distingués de l'assemblée, Baudin, se tenait sur la barricade, rappelant aux soldats leurs devoirs envers les lois de leur pays ; il tomba frappé de trois balles. II y avait dans la foule des agents de police déguisés ; l'un d'eux, au moment où la barricade venait à être élevée, cherchait à calmer le peuple en disant : il ne faut pas aller se faire tuer pour les vingt-cinq francs ; infâme allusion aux vingt-cinq francs de traitement quotidien, accordé par la loi aux représentants de la nation. Le noble Baudin, ayant entendu cet indigne propos, s'écria : TOUS allez voir comment on meurt pour vingt-cinq francs, et après ce mot sublime, il s'élança sur la barricade et il y fut tué.
La France possède aujourd'hui un gouvernement bonapartiste ; elle a un Corps Législatif rempli, en très-grande majorité, de valets payés à raison de plus de quatre-vingt francs par jour, pendant toute la durée des sessions, pour voter servilement et platement tout ce que le gouvernement leur commande d'accepter; elle possède aussi un sénat rempli, à très-peu d'exceptions près, de valets idiots payés à raison de plus de quatre-vingt francs par jour durant l'année entière, et dont les fonctions consistent à trouver beaucoup trop libéral l'un des gouvernements les plus obscurantistes de notre siècle. La France peut se convaincre aujourd'hui, qu'il valait mille fois mieux pour elle payer vingt-cinq francs par jour aux élus de la nation et jouir d'un gouvernement libre, contrôlé par une assemblée composée, sauf quelques exceptions bonapartistes, d'hommes honnêtes !
Le comité de résistance dont nous avons parlé, et qui, dans ces jours néfastes, honora le nom français, prenait toutes les mesures possibles pour accroître la résistance du peuple contre l'usurpateur. Les membres du comité circulaient, à tour de rôle, dans Paris, les premiers devant le danger, donnant l'exemple de l'énergie. Dans la journée du 3, le comité fit afficher un décret proclamant Louis Bonaparte déchu, pour crime de haute trahison, de ses fonctions de président de la république et ordonnant à tous les citoyens ainsi qu'à tous les fonctionnaires de lui refuser obéissance, sous peine de complicité. Le lendemain, le comité fit afficher trois autres décrets : le premier déclarait toutes les condamnations politiques levées; toutes les poursuites pour causes politiques annulées, et enjoignait à tous les directeurs des maisons d'arrêt ou de détention de mettre immédiatement en liberté tous les détenus pour cause politique; le second décret levait l'état de siège, et faisait défense à tout chef militaire, sous peine de forfaiture, de faire usage de ses pouvoirs extraordinaires ; le troisième convoquait le peuple au 21 décembre pour élire, par la voie du suffrage universel, une assemblée souveraine. […]
Nous croyons devoir citer ici les noms des citoyens, qui se signalèrent surtout par une participation courageuse à la lutte de la loi et du patriotisme contre l'usurpation et le despotisme. C'étaient d'abord les membres du comité de résistance : MM. Victor Hugo, Carnot, de Flotte, Jules Favre, Madier de Montjau, Michel de Bourges et Schoelcher. Ce furent aussi Baudin et Dussoubs, tous les deux tués dans cette noble lutte; MM. Artaud, Aubry, Bruckner, Chaix, Charamaule, Cournet, Delbetz, Deluc, Duputz, Xavier Durrieu, Duval, Esquiros, Kessler , Lebloy , Le Jeune, Amable Lemaître, Longepied, J. Luneati, Maigne, Maillard, Malardier, Ruin, Sartin, Watripon.
Pendant ce temps, à l'Élysée, Louis Bonaparte tremblait de crainte de voir échouer son coup. Les nouvelles de l'agitation dans les faubourgs arrivaient sans cesse: Magnan et plusieurs généraux commençaient à hésiter; à la préfecture de police, Maupas était saisi d'une telle frayeur, que l'ex-préfet Carlier disait : ce petit jeune homme a la colique. Maupas télégraphia au ministre de l'intérieur, Morny, qu'il était malade, et reçut cette réponse : couchez-vous, j......- f ..... ! A l'Elysée, l'on faisait emballer, à tout événement, papiers et effets ; trois voitures de voyage se tenaient dans la cour, attelées chacune de quatre chevaux. […]
Saint-Arnaud n'avait point hésité, dès le 3, à faire placarder dans les rues une proclamation infâme, annonçant que tout individu pris construisant ou défendant une barricade, on les armes à la main, sera fusillé !!! Mais la résistance croissait, et Saint-Arnaud vint déclarer à Louis Bonaparte qu'il serait nécessaire d'avoir recours aux moyens les plus extrêmes, peut-être même de détruire le faubourg Saint-Antoine tout entier et passer la population an fil de l'épée. Faites tout ce qui sera nécessaire, répondit le prince. […]
… le 4 décembre, les nouvelles arrivaient sans cesse ; toujours de plus en plus mauvaises pour les bonapartistes. Le prince Louis, la figure toute verte, comme il lui arrive dans les moments où il est pris de terreur, était assis, le regard fixe, devant la cheminée d'un salon du rez-de-chaussée à l'Elysée. Le général Roguet entra pour lui annoncer que les barricades se multipliaient, que sur les boulevards l'on criait : à bas le dictateur, à bas Soulouque ! que devant la galerie Jouffroy un adjudant-major avait été poursuivi par la foule, et au coin du café Cardinal un capitaine d'état-major avait été précipité de son cheval. Louis Bonaparte se souleva à demi de son fauteuil, et dit à Roguet : eh ! bien ! qu'on dise à Saint-Arnaud d'exécuter mes ordres. Et la boucherie commença ....
[…] La victoire de la violence, de la perfidie et de la fourberie sur le patriotisme et sur l'amour de la liberté était gagnée ; la France cessa, pour une série d'années qui se prolonge encore, d'être un pays libre et de se voir régie par un gouvernement honnête. […] Rarement a-t-il été donné de contempler, dans les fastes de l'histoire, une bande de plus ignobles misérables, après avoir remporté une victoire par des moyens plus vils et plus cruels, en abuser d'une façon aussi odieuse. »
Pierre Dolgoroukow (*), La France sous le régime bonapartiste, Vol. 2, Londres, Stanislas Tchorzewski libraire, 1864.
________________________
(*) Piotr Vladimirovitch Dolgoroukov (Moscou 1807 - Berne 1868). Historien et journaliste russe, issu d'une illustre famille princière. Banni pour la publication de son livre La Vérité sur la Russie, il trouve refuge à Paris en 1859, puis doit passer finlement en Suisse, où il décède en 1868.
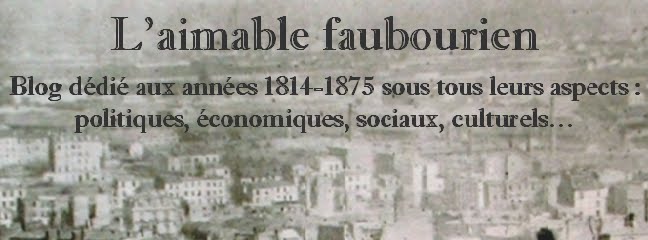

.JPG)













