 L'élection du vice-président de la République vue par Victor Hugo
L'élection du vice-président de la République vue par Victor Hugo « M. Boulay de la Meurthe était un bon gros homme, chauve, ventru, petit, énorme, avec le nez très court et l'esprit pas très long. Il était l'ami de Harel auquel il disait : mon cher et de Jérôme Bonaparte auquel il disait : Votre Majesté.
L'Assemblée le fit, le 20 janvier, vice-président de la République.
La chose fut un peu brusque et inattendue pour tout le monde, excepté pour lui. On s'en aperçut au long discours appris par coeur qu'il débita après avoir prêté serment, Quand il eut fini, l'Assemblée applaudit, puis à l'applaudissement succéda un éclat de rire. Tout le monde riait, lui aussi; l'Assemblée par ironie, lui de bonne foi.
Odilon Barrot, qui, depuis la veille au soir, regrettait vivement de ne pas s'être laissé faire vice-président, regardait cette scène avec un haussement d'épaules et un sourire amer.
L'Assemblée suivait du regard Boulay de la Meurthe félicité et satisfait, et dans tous les yeux on lisait ceci : Tiens! il se prend au sérieux!
Au moment où il prêta serment d'une voix tonnante qui fit sourire, Boulay de la Meurthe avait l'air ébloui de la République, et l'Assemblée n'avait pas l'air éblouie de Boulay de la Meurthe.
Ses concurrents étaient Vivien et Baraguay-d'Hilliers, le brave général manchot, lequel n'eut qu'une voix.Vivien avait beaucoup compté sur la chose. Quelques moments avant la proclamation du scrutin, on le vit quitter son banc et s'en aller à côté du général Cavaignac. Le président manqué consola le vice-président raté. Je n'aimais pas Vivien, parce qu'il était honteux de son père, ancien maître d'études, pion, chien de cour, comme disent les gamins à la pension Cordier-Decotte, rue Sainte-Marguerite, n° 41. Ceci me fît voter pour Boulay de la Meurthe. [...]
Pendant que le vice-président pérorait à la tribune, je causais avec Lamartine. Nous parlions architecture. Il tenait pour Saint-Pierre de Rome, moi pour nos cathédrales. Il me disait : — Je hais vos églises sombres. Saint-Pierre est vaste, magnifique, lumineux, éclatant, splendide. — Et je lui répondais : — Saint-Pierre de Rome n'est que le grand ; Notre-Dame, c'est l'infini. »
Victor Hugo, Choses vues, II, Paris, Ollendorf, 1893.
Discours du comte Henri Georges Boulay de la Meurthe (1795-1858) en réponse à son élection au poste de vice-président de la République française le 20 janvier 1849 :
« Citoyens représentants, je n'ai point recherché l'honneur qui m'est fait.
Tandis qu'il en était temps encore, j'ai prodigué les instances les plus vives pour obtenir que quelque nom revêtu de plus d'autorité que le mien lui fût substitué sur la liste de présentation. Une affection dont je m'honore a été plus forte que ma volonté.
J'espérais du moins que votre justice vous ferait préférer quelqu'un de mes deux honorables concurrents : l'un, vieux soldat mutilé dans les combats (Très bien ! très bien !) ; l'autre, athlète glorieusement éprouvé dans les luttes parlementaires. (Très bien ! très bien !)
Plus ce double honneur est inattendu, et plus ma reconnaissance (reconnaissance, permettez-moi de vous ouvrir mon âme, mêlée de trouble et de tristesse), plus ma reconnaissance est profonde envers le président de la République comme envers l'Assemblée nationale, tous les deux les grands élus du suffrage universel. (Très bien !)
Je ne m'enorgueillis pas de ma nomination, j'en tire deux enseignements.
Dans un de ces enseignements, je vois une honorable déférence pour ce que l'Assemblée a cru être le vœu du premier magistrat de la République (Très bien ! Très bien !); j'y vois une protestation contre une hostilité si étrangement, si malheureusement présumée (Très bien ! très bien !); j'y vois un signe d'alliance, et je vous promets, citoyens représentants, de seconder vos intentions; il ne m'en coûtera rien : je ne ferai qu'obéir à mes habitudes, à mes convictions, à mon inclination. (Très bien ! Très bien !)
L'autre enseignement que je tire de cette nomination, c'est l'invitation de contribuer de toutes mes forces à l'affermissement de la République. (Vifs applaudissements.) Je le ferai avec probité, avec loyauté, avec constance, et, s'il le faut, avec quelque énergie. (Très bien ! Très bien !) Je n'ajoute rien de plus, il n'y a pas d'autres mérites dans ma vie.
Ici je rencontre le serment que je viens de prêter, et auquel je serai fidèle ; je rencontre aussi le terrain de la constitution que je ne déserterai pas. Je trouve enfin deux intérêts sacrés et chers, destinés à se sauver l'un par l'autre, étroitement unis, confondus ensemble, l'intérêt de la République et l'intérêt de son président. (Très bien ! très bien ! )
Croyez-moi, citoyens représentants, j'ai su lire dans ce noble cœur. Oui, le président de la République a compris que le plus grand honneur qu'il soit donné à un citoyen de conquérir, c'est de s'appeler Napoléon Bonaparte, d'être l'élu de l'immense majorité du peuple français et d'affermir la République. (Nouvelle et vive approbation).
Vous avez déjà, citoyens représentants, grandement contribué à celle œuvre. Vous êtes apparus dans les circonstances les pins critiques, et il a suffi de votre présence pour rassurer les esprits et pour raffermir le sol. Vous avez sauvé le pays de la guerre civile et de la ruine. Le 15 mai vous assistiez sur vos bancs, calmes et résignés à tout, au spectacle hideux des saturnales de l'anarchie ; le 24 juin, vos écharpes sauvaient la société en péril. Jamais plus grand pouvoir n'a été confié à une réunion d'hommes, et jamais il n'en fut usé avec plus de modération. L'Assemblée nationale a le droit de finir, elle saura finir comme elle a vécu, maîtresse d'elle-même, fidèle à elle-même ; elle peut dès à présent prétendre à la reconnaissance, au respect du pays; elle vivra honorée dans l'histoire, et la gloire des assemblées qui la suivront sera de continuer son œuvre (marques générales et chaleureuses d'approbation). »
Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, vol. 7, du 1er janvier au 10 février 1849, Paris, 1849.
__________
Note 1. Aux termes de l'article 70 de la Constitution de 1848, "il y a un vice-président de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président dans le mois qui suit son élection. - Le vice-président prête le même serment que le président. - Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. - En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace. - Si la présidence devient vacante, par décès, démission du président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un président." L'article 71 précise : "Il y aura un Conseil d'Etat, dont le vice-président de la République sera de droit président."
Note 2. Le 20 janvier 1849, Boulay de la Meurthe est élu avec 417 voix, contre 277 à Vivien et 1 à Baraguey-d'Hilliers (19 bulletins blancs). La veille (séance du 19 janvier 1849), l'Assemblée constituante avait voté pour que le montant du traitement annuel du vice-président soit fixé à 48.000 francs (516 voix pour, 233 contre), après avoir rejeté (par 472 voix contre) la proposition initiale du Comité des finances de fixer à 60.000 francs par an le montant de ce traitement.
Pour en savoir plus :
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=9883
(notice biographique extraite du
dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 de A.Robert et G.Cougny)
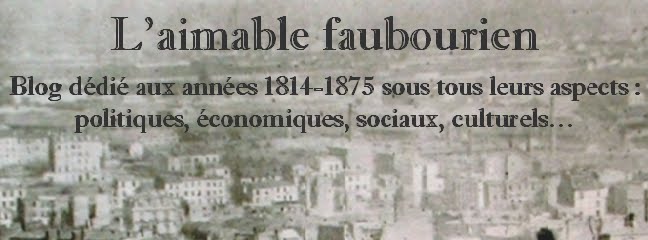

.JPG)

.jpg)









