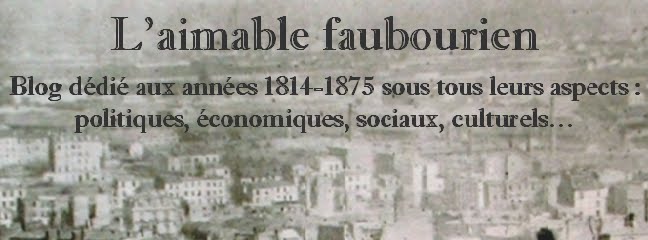"Suppots de l'amour unamine dans l'exercice de leurs fonctions" par Auguste Bouquet (lithographie, 1ère moitié du XIXe siècle).
« Le 17 novembre 1827, des élections générales avaient lieu ; le soir, on se disait tout bas que le ministère de M. de Villèle touchait à sa fin, que cette fois le parti libéral obtiendrait une immense majorité. Le 18 au matin, on commença à recevoir partiellement les nouvelles du résultat des élections ; les listes arrivèrent, incomplètes à la vérité ; mais comme tout faisait présager un succès formidable, les habitants des quartiers Saint-Martin et Saint-Denis s'empressèrent, à la chute du jour, de garnir leurs croisées de lumières ; des flots de clarté célébrèrent le triomphe qui paraissait assuré.
Le 19, les journaux de la capitale annoncèrent aux provinces que, la veille, les rues de Paris avaient été spontanément illuminées, et que le soir les illuminations recommenceraient. [...] La préfecture de police, informée que les habitants de la capitale, et notamment des quartiers limitrophes des halles, devaient, pendant la soirée, célébrer par une illumination générale le succès des élections, avait envoyé des agents sur tous les points de la capitale, principalement dans les quartiers Saint-Denis et Saint-Martin. Quant à moi, on m'envoya en observation dans la rue Saint-Denis, et, mêlé à la foule qui circulait avec peine, je pus saisir à droite et à gauche bien des lambeaux de conversation, mais pas une seule, je l'avouerai, n'était à la louange du gouvernement.
Tout Paris semblait s'être porté dans ces deux rues ; ceux qui avaient vu la veille voulaient revoir; ceux qui n'avaient pas vu voulaient voir pour la première et dernière fois ; enfin, les bourgeois venaient sur la chaussée pour juger de l'effet que produiraient leurs fenêtres illuminées. Ce qu'il y avait de plus curieux à voir, c'était la rue Guérin-Boisseau et autres ruelles de ce genre, où les deux rangs de maisons, présentant peu d'écartement, paraissaient ne s'être séparés que pour donner passage à un fleuve de feu. Pendant ce temps, les enfants se promenaient par bandes, demandant des lampions et brûlant, avec les pétards et les fusées dont ils étaient porteurs, la figure et les vêtements des passants.
Vers huit heures du soir, je me trouvais non loin du passage du Grand Cerf, lorsque je vis apparaître dans la rue Saint-Denis, et venant du côté de la place du Châtelet, une troupe d'hommes en guenilles, commandés par un individu armé d'un bâton ; ils se mirent à crier à tue-tête : Des lampions ! des lampions ! Il y en avait partout, que pouvaient-ils désirer de plus ? Ils continuèrent leur route, et bientôt l'homme au bâton leur désigna une maison dont plusieurs fenêtres n'étaient pas illuminées. A ce signal s'élevèrent des cris forcenés de mort aux villélistes ! mort aux jésuites ! mort aux bigots ! avec l'accompagnement obligé des lampions! qui, cette fois, était répété en fausset par les gamins.
Le gamin de Paris est essentiellement imitateur : il avait entendu crier, il cria ; puis, comme à un autre signal de leur chef les mêmes hommes se trouvèrent les mains pleines de pierres et se mirent en devoir de casser les carreaux de cette maison, le gamin fut bientôt armé des mêmes projectiles et il aida efficacement ses professeurs ; au bout de quelques secondes, un grand nombre de vitres furent cassées. Les habitants, craignant une invasion de la populace, s'empressèrent d'illuminer les fenêtres, au milieu des huées et des sifflets des spectateurs.
L'homme au bâton et sa troupe remontèrent encore la rue, mais toutes les croisées étaient garnies de lumières, et celles qui en manquaient, ou dont les lampions s'étaient éteints, étaient immédiatement éclairées ; cela ne faisait pas l'affaire de cette bande de braillards.
Ils redescendirent vers la Seine ; arrivés près du passage du Grand-Cerf, ils s'arrêtèrent devant une maison en construction, et l'homme au bâton s'écria : Aux barricades ! A ces mots, tous ses acolytes se jetèrent sur le bâtiment, enlevèrent matériaux, échafaudages, et en un instant, aidés d'une vingtaine de commis de boutique, ils eurent bientôt édifié une barricade formidable qui fut suivie d'une seconde. L'élan était donné, et le public circulait tant bien que mal au milieu de ce tumulte, riant des différentes scènes qui se produisaient à chaque pas. Je m'approchai alors de l'homme au bâton que je reconnus avec surprise pour être un ancien forçat attaché comme auxiliaire à la brigade de sûreté commandée par Coco Lacour ; un autre de la bande était un forçat en rupture de ban, que j'avais moi-même arrêté quelque temps auparavant en flagrant délit de vol au Temple. Cette troupe n'était formée que d'individus on ne peut plus mal famés, tenant sur la voie publique, et sous la protection de la brigade de sûreté, des jeux de hasard.
Pendant que tout ceci se passait, j'avais rencontré plusieurs commissaires de police, entre autres MM. Roche, Boniface, Galton et Foubert ; et, chose étrange, bien que la préfecture fût à deux pas et qu'un piquet de gendarmerie stationnât sur la place du Châtelet, aucun de ces messieurs n'avait cherché à faire arrêter ces misérables provocateurs ! Ce ne fut qu'à dix heures du soir, lorsque la barricade était entièrement terminée et occupée, qu'un détachement de troupe de ligne, commandé par M. B***, capitaine d'état-major de la place, se montra rue Saint-Denis, à la hauteur de la rue Grenelat ; à son approche, les agents provocateurs et leurs dupes s'empressèrent de prendre la fuite ; malgré celte retraite précipitée, le commandant n'en crut pas moins devoir ordonner à ses soldats de faire feu ; plusieurs des fuyards et des imprudents furent tués ou blessés. Plus loin, des charges de cavalerie furent exécutées le sabre à la main par la gendarmerie ; l'infanterie de la même arme s'avança également en faisant le coup de feu.
Je fis à M. Barré, mon officier de paix, un rapport détaillé de ce que j'avais vu et des individus que j'avais remarqués ; je le lui remis pour qu'il en rendît compte à qui de droit.
Dans la soirée du 20, les mêmes scènes recommencèrent et cette fois le feu, commandé par le colonel F***, fut non seulement dirigé sur les barricades, mais encore sur les fenêtres des maisons environnantes ; aussi quelques-unes des victimes furent-elles atteintes dans leur domicile. Cette seconde fusillade mit fin à cette échauffourée regrettable. Le lendemain 21, comme j'étais fort étonné de ne point avoir entendu parler de mon rapport, je profitai de la visite que je faisais à M. Barré, chaque jour, à deux heures de l'après-midi, pour lui en demander des nouvelles.
— Votre rapport ? me dit-il, il y a longtemps qu'il est déchiré, et même je vous conseille dans votre intérêt de ne jamais ouvrir la bouche à qui que ce soit de ce que vous avez vu.
La prétendue insurrection de la rue Saint-Denis était tout simplement une provocation de la police. La congrégation, qui sentait le pouvoir lui échapper, avait espéré, par une collision entre le peuple et l'armée, amener le roi à prendre des mesures de rigueur et à dissoudre la chambre nouvelle. Les individus qui avaient parcouru les rues en appelant leurs frères aux armes étaient des agents occultes que j'avais parfaitement reconnus ; seulement, on avait retiré à tous ces émissaires leurs cartes d'agents, afin que, s'ils étaient arrêtés, ils ne pussent pas compromettre la police.
On a vu comment tout cela avait fini : par du sang ! Dans la nuit du 20 novembre, à deux heures du matin, des cadavres furent relevés sur la chaussée Saint-Denis et dans le passage du Grand-Cerf ; on les mit dans des fiacres qui les transportèrent à la Morgue. Parmi eux se trouvait l'homme au bâton, l'ex-forçat B***, qui avait eu l'épine dorsale brisée par une balle, en cherchant sans doute à s'esquiver après avoir accompli son exécrable mission. Agent provocateur, ayant fait un criminel trafic de la vie des citoyens, il devait tomber lui-même pendant le combat, parmi les victimes de sa propre provocation, et cela sans avoir eu le temps de recevoir le prix du sang qu'il avait fait répandre. »
Louis Canler (1797-1865), Mémoires de Canler, ancien chef du service de sûreté, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, éditeurs, Bruxelles, 1862.
_____________________
Le quartier des halles à Paris, théâtre des émeutes de novembre 1827
(gravure, milieu XIXe siècle).
« La nuit et la plus grande partie de la journée du 19 se passèrent tranquillement. Vers deux heures de relevée, on reçut au quartier des ordres du palais de Rivoli, et il se fit immédiatement une distribution extraordinaire de vin, d'eau-de-vie et de cartouches. […] ... comme je me pique de voir ordinairement plus loin que le commun des bons gendarmes, et que j'ai d'ailleurs une expérience qui manque à la plupart des camarades, je me dis à part qu'il y avait quelque chose là-dessous je soupçonnai qu'il s'agissait d'un coup de main tel, que le grand maître de l'hôtel Rivoli jugeait prudent, avant de l'entreprendre, de retremper convenablement notre valeur, et je fus bientôt convaincu que, ainsi que cela m'arrive toujours, j'avais deviné juste.
Quatre heures venaient de sonner, le jour baissait, presque tous les réverbères du quartier jetaient de pâles clartés sur les armes des sentinelles, lorsque tout à coup le rappel battit sur tous les points. On court, on se rassemble notre commandant réclame le silence et d'une voix forte prononce le discours suivant : "Bons gendarmes l'ennemi fier d'un succès passager, et comptant trop sur ses forces et sur votre découragement, se livre en ce moment à l'ivresse de la joie audacieux partisans des lumières, c'est à la lueur d'une multitude de lampions séditieux et félons qu'ils célèbrent leurs victoires, et c'est par de l'hôtel Rivoli. (A ce nom révéré, tous les bons gendarmes portent spontanément la main à leur chapeau). Mais c'est bien ici le cas de dire que tel rit le malin, qui pleurera le soir. Ces farouches partisans de la tranquillité, ces barbares qui osent soutenir que le ventre n'est pas une partie noble, ces féroces électeurs qui veulent que tout le monde vive ces furieux enfin osent chanter leur victoire jusque sous les balcons de nos maîtres ! Bons gendarmes, prouvons-leur que comme Annibal s'ils ont vaincu, ils ne savent pas profiter de la victoire. Montrez à la France que deux jours de station sur le pavé de la capitale et deux retraites successives n'ont pas émoussé le courage dont vous avez naguère encore donné des preuves si éclatantes. Une manœuvre hardie peut nous assurer la victoire main-basse sur les lampions, main-basse sur les pékins ! L'heure du triomphe va sonner. Aux armes et que bientôt la plus profonde obscurité signale votre vaillance !"
A cet énergique et superbe discours succédèrent les cris mille fois répétés de A bas les lumières ! et vive le ventre ! Le tambour bat ; chacun prend ses armes ; le commandement par le flanc droit et par file à gauche se fait d'abord entendre puis on se forme par sections en ligne, et c'est ainsi qu'on s'avance en bon ordres jusqu'à la rue Saint-Denis, où l'on prend immédiatement position. Bientôt, à la lueur des feux de joie, on aperçoit dans toutes les directions des bandes nombreuses, portant pour uniforme des tabliers et des bonnets de coton. Pleins d'audace, les individus composant ce corps passèrent à plusieurs reprises devant nous, jusqu'à la portée du coup de poing, criant comme des enragés : Des lampions ou la mort ! et brisant à coups de pierres les croisées ténébreuses. A la vue de ces gens, quelques uns des nôtres, impatients de signaler leur courage, firent un mouvement ; mais il fut promptement réprimé par un ordre supérieur. Je tiens pour certain qu'il n'y eut pas dix bons gendarmes par compagnie qui comprirent le but de cet ordre ; mais cela ne pouvait m'échapper à moi, qui, ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire au lecteur, ai l'avantage de voir ordinairement plus loin que mon nez. Je sentis tout de suite où l'on en voulait venir, et j'essayai de le faire comprendre à mon chef de file en lui disant Les amis de nos amis... – suffit, c'est clair et nous allons voir beau jeu ! Mais, me dit-il, il me semble que si l'on cernait ces tapageurs... – A la bonne heure, repris-je, je sais bien que rien n'est plus facile ; mais ce n'est pas le plan si on les empoigne, la victoire est manquée.
Effectivement, j'avais bien deviné que les tapageurs en bonnet de coton n'étaient que des insurgés pour rire. Quand ils eurent cassé une honnête quantité de vitres selon l'ordonnance, ils se retirèrent, et les pékins, qui nous avaient vexés d'une manière conséquente pendant les deux jours précédents, arrivèrent bientôt en foule pour voir de quoi il s'agissait c'était là qu'on les attendait ! Dès qu'ils furent réunis en nombre suffisant nous fîmes un à gauche, on se forma par pelotons, et le feu commença.
Un grand homme qui je crois s'appelait Cicéron, disait qu'il n'avait jamais entendu le bruit du canon sans éprouver un tremblement involontaire ; j'avoue donc que aux premiers coups de fusil, je ressentis le même mouvement ; et cependant, loin de nous résister, l'ennemi dans les rangs duquel se trouvaient beaucoup de femmes et d'enfants, fuyait de toutes parts. Mais, malgré l'agilité de nos adversaires et le trouble dont je ne pus me défendre, je ne tardai pas à m'apercevoir que nos balles allaient beaucoup plus vite qu'eux. A la troisième décharge, les environs du marché des Innocents et du passage du Grand-Cerf étaient jonchés de morts et de blessés. Ceux qui échappaient à notre feu cherchaient à se réfugier le long des maisons ; mais, par une manœuvre habile et digne des plus grands éloges, nous ouvrîmes les rangs pour laisser passer notre cavalerie, qui se distingua par des charges d'autant plus brillantes qu'elles furent exécutées à la lueur des feux de joie allumés par l'ennemi. A mesure que nous gagnions du terrain, des tirailleurs étaient envoyés dans les rues latérales, où ils eurent un égal succès; et l’affaire paraissait terminée, lorsque les choses changèrent de face tout à coup. Un grand nombre d’insurgés, refoulés sur tous les points par des décharges continuelles, se précipitèrent dans la rue Saint-Denis ; et là, s'apercevant qu'ils étaient enveloppés, ils prirent la barbare résolution de se défendre. Aussitôt les échafaudages de plusieurs maisons en constructions furent jetés en travers de la rue, des charrettes furent accumulées, et l'ennemi, retranché derrière des barricades se fit des armes de tout ce qui se trouva sous sa main.
Malgré l'ardeur qui nous animait, nous reconnûmes promptement le danger. On fit halte à portée de pistolet et, malgré le feu d'écailles d'huîtres bien nourri que les assiégés faisaient pleuvoir sur nous, nous gardâmes notre position sans reculer d'une demi-semelle, attendant le renfort qu'un trompette, fait aide-de-camp postiche sur le champ de bataille, était allé chercher.
Sur ces entrefaites, un particulier s'approcha de notre commandant. "Monsieur, lui dit-il, n'oubliez pas que vous êtes destinés à protéger les citoyens, et non à les tuer, réfléchissez, je vous prie. – Apprends, faquin, répondit notre commandant, qu'un bon gendarme ne réfléchit jamais, et que, si ces canailles que nous tenons bloquées ne se rendent pas sur-le-champ, je ferai fusiller jusqu'au dernier."
Au moment où il achevait cette belle et énergique réponse plusieurs coups de feu se firent entendre nous ripostâmes par un feu de file et le combat s'engagea. Mais bientôt le cri de ralliement, A bas les pékins ! nous apprit que c'était aux nôtres que nous avions affaire. Le renfort demandé avait fait une manœuvre si habile qu'il arrivait sur les derrières des insurgés, qui se trouvèrent ainsi pris entre deux feux. Alors un vieux bourgeois, ayant mis sa tête à la fenêtre, s'écria : "C'est affreux ! Avez-vous bien le cœur de tirer aussi sur le peuple ? – Qu'appelles-tu peuple, vieille ganache ? répondit un brigadier : ne vois-tu pas que ce sont des maçons ? Retire-toi, dit à son tour un camarade, retire-toi, pékin, ou je te descends." Il allait effectivement le mettre à l'ombre, mais déjà un autre avait mis en joue le braillard, auquel il coupa la parole d'un coup de fusil.
Cependant l'assaut venait d'être ordonné ; nous marchions au pas de charge, tambours derrière. Ce fut alors que la mêlée devint terrible : les écailles d'huîtres tombaient comme la grêle ; il y en eut une qui ne passa pas à plus de six pouces de mon oreille droite, et une autre frappa si violemment le chapeau d'un brigadier, que son galon d'argent en reçut une forte contusion. D'un autre côté, les insurgés des maisons voisines, montés dans les mansardes, nous accablaient de bûches, de pots, et autres objets capables de couper la respiration aux plus robustes d'entre nous.
Le combat dura jusqu'à une heure du matin ; mais comme il est écrit que tout doit finir ici-bas, cette glorieuse affaire se termina et cela par plusieurs excellentes raisons : d'abord nous n'avions plus sur le champ de bataille d'ennemis vivants ; en second lieu les barricades avaient été emportées d’assaut, et enfin des cinq paquets de cartouches qui avaient été distribués à chacun de nous, il ne restait pas de quoi faire une fusée. Nous retournâmes donc au quartier, où une nouvelle distribution de liquide nous fut faite, et, en vérité, cette fois nous ne l'avions pas volée. […]
Le lendemain 20, la journée commença de manière à nous faire pressentir de nouveaux événements. […] Vers le soir, les briseurs de vitres, héros en bonnets de coton, dont nous avons parlé, furent lancés. En même temps nous sortîmes divisés en plusieurs colonnes. Bientôt les bonnets de coton disparurent au signal convenu, et les pékins, attirés de nouveau sur le terrain, furent obligés de se défendre. Mais cette fois la victoire nous coûta plus cher : nous comptâmes presque autant de morts que l'ennemi ; le sang coula de toutes parts ; je reçus simultanément trois coups de savate et deux coups de poing, et je tombai évanoui sur le tambour de la compagnie... »
Anonyme. Histoire de la bataille électorale de 1827 (16-20 novembre), rédigée par un gendarme ; avec des notes, par un tambour de la compagnie, Paris, Imp. de Guiraudet, 1827.