Honoré Daumier, La barricade, huile sur toile (1852-1858).
« Nous assistons, depuis quelques années, à une orgie intellectuelle sans exemple dans l’histoire. La raison humaine, dévoyée, est en pleine révolte contre l’éternelle vérité. Depuis que cette raison a abandonné la foi et la philosophie chrétiennes, elle se précipite avec une frénétique ardeur dans les plus monstrueuses erreurs ; au lieu de répandre la lumière autour d’elle, elle crée une nuit de plus en plus profonde ; au lieu de construire et d’édifier, elle renverse et détruit ; tourmentée par l’esprit du mal, elle attaque audacieusement l’édifice majestueux qui avait jusqu’ici abrité les âmes.
Aucune vérité n’est restée debout. L’idée d’un Dieu, cette clef de voûte de tout ordre social, s’est obscurcie dans l’esprit des masses ; l’idée de devoir, ce ciment des sociétés, n’échauffe plus les cœurs ; l’idée de l’immortalité, cette source de tant de consolations et de si douces espérances, ne brille plus sur l’humanité malheureuse.
Le socialisme, cette synthèse de toutes les folies, ce ramassis de toutes les contradictions, ce cri d’orgueil révolté, est tombé comme un fléau terrible dans le champ de l’intelligence, et a détruit sur son passage toutes les plantes, toutes les fleurs que le christianisme y avait été semées.
Le but de la destinée humaine a été méconnu ; les rêveries les plus insensées, les utopies les plus nuageuses ont, sous l’action des apôtres du socialisme, remplacé les plus éclatantes vérités. On a bien encore, il est vrai, parlé quelquefois de devoir aux hommes de notre temps ; mais comme cette idée n’avait plus de base ni de sanction, les hommes l’ont dédaignée, et la recherche d’un bonheur égoïste est devenue leur principale étude.
Combien est profond l’égarement de la raison humaine à notre époque, pour que des doctrines aussi absurdes, aussi stériles que celles de Fourier et de Proudhon aient trouvé de nombreux adeptes et excité d’immenses enthousiasmes !
Ces doctrines, qu’on appelle régénératrices, ne sont-elles pas un brûlant appel aux passions inférieures ? Ont-elles d’autre but que d’exciter la cupidité et d’allumer l’égoïsme ? Leur premier mot, à toutes, n’est-il point une infernale malédiction sur le travail de nos pères, sur le passé de l’humanité ? Ne nient-elles pas la légitimité de tous les droits acquis ? Ne confondent-elles pas le juste et l’injuste ? Ne coupent-elles pas les ailes à l’espérance, en affirmant le néant après la mort ? Ne bercent-elles pas le genre humain du chimérique espoir de transporter sur la terre la félicité du ciel ? Ne veulent-elles pas enfermer l’humanité dans un cercle étroit, où toute spontanéité serait condamnée, où toute grandeur serait flétrie, où le génie même serait regardé comme un crime ? Ne veulent-elles pas sacrifier, au nom d’une égalité impossible et injuste, les droits sacrés de la liberté ? ne méconnaissent-elles pas toutes les lois économiques de la production et de la distribution des richesses ? ne proclament-elles pas, en face des crimes qui déshonorent l’humanité, l’innocence native de l’homme ? Ne prétendent-elles pas rendre la société responsable de tous les forfaits attribués jusqu’ici à la liberté individuelle ? L’idéal qu’elles poursuivent n’est-il pas de fonder, sur les ruines du monde chrétien, une société athée, panthéistique, matérialiste et anarchique ? […] N’ont-elles pas nié la légitimité de la propriété et la nécessité d’un gouvernement ? N’ont-elles pas, bravant les enseignements positifs de l’histoire, et étouffant la voix solennelle de la tradition universelle, déversé le ridicule sur les dogmes les plus sublimes de la religion chrétienne ? N’ont-elles point cherché par tous les moyens possibles à remplacer le culte du VRAI, du BEAU et du BON par le culte avilissant du ventre ?
Ces doctrines sont demeurées pendant longtemps dans le domaine de la spéculation, dans les régions de la théorie ; pendant longtemps dans le domaine de la spéculation, dans les régions de la théorie ; pendant longtemps elles n’eurent d’autres défenseurs, d’autres adeptes que quelques pauvres intelligences dévoyées, que quelques rêveurs habitués à prendre les ombres pour des réalités. Mais bientôt, grâce au scepticisme religieux que nous légua le XVIIIe siècle, elles descendirent peu à peu des hauteurs de l’abstraction dans les foules des cités ; peu à peu, grâce à la grande liberté dont nous jouissions sous l’odieux tyran Philippe, elles gagnèrent du terrain ; elles recrutèrent des adeptes, formèrent des centres, établirent des foyers de propagation active dans presque toutes les villes de France, et s’universalisèrent de telle sorte, que, quand éclata la révolution de février, des légions immenses, armées en leur nom, jurèrent de détruire le vieux monde, c’est-à-dire la société et la civilisation. A la vue de ces doctrines de destruction, le vieux jacobinisme, ce monstre hideux à la mâchoire ensanglantée, frémit de bonheur dans les repaires où il se tenait caché : il vit là, dans ce monstrueux pêle-mêle de toutes les erreurs et de toutes les folie, un précieux arsenal où il pourrait se ravitailler pendant longtemps et trouver des armes merveilleuses pour la guerre de destruction que, depuis près d’un siècle, il a déclarée aux principes fondamentaux de l’ordre social ; aussi se précipita-t-il avec rage sur cette pâture nouvelle, et, après s’en être gloutonnement repu, rôda-t-il nuit et jours autour des murailles de la cité du bien, afin de la surprendre, de s’en emparer, de la dévaster et de la détruire. […]
Au lieu de diminuer, le nombre des adeptes du jacobinisme-socialiste ne fait que grandir de plus en plus : il semble que les flots de sang qu’il a déjà fait couler et qu’il se promet de faire couler encore exhalent une odeur qui enivre et change les hommes en bêtes. Il semble que le drapeau rouge qu’il agite au sein des populations ait le funeste don de les rendre folles, cruelles, féroces mêmes. […]
Le socialisme révolutionnaire étreint la France comme dans un étau : ses hordes affamées hurlent d’impatience dans leurs antres sauvages. Le plan de destruction, de pillage et d’incendie est dressé. Si la société s’oublie un seul instant, elle est perdue ; si la vigilance et l’énergie gouvernementale fléchissent un seul instant dans leur action, c’en est fait de la civilisation, c’est est fait de la liberté, de cette liberté si chèrement conquise par nos pères […] »
Barnabé Chauvelot, La solution, Paris, D. Giraud & J. Dagneau, 1850.
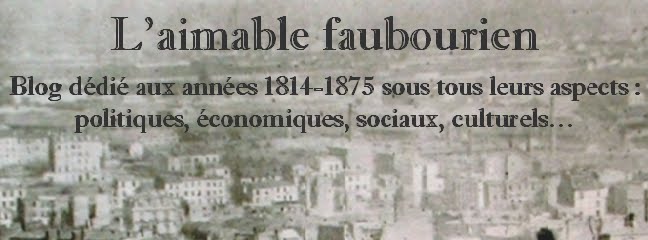


.JPG)
.jpg)












