Claude Henri Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825).
« L'Europe a formé autrefois une société confédérative unie par des institutions communes, soumise a un gouvernement général qui était aux peuples ce que les gouvernements nationaux sont aux individus : un pareil ordre de choses est le seul qui puisse tout réparer.
Je ne prétends pas sans doute qu'on tire de la poussière cette vieille organisation qui fatigue encore l'Europe de ses débris inutiles : le dix-neuvième siècle est trop loin du treizième. Une constitution, forte par elle-même, appuyée sur des principes puisés dans la nature des choses et indépendants des croyances qui passent et des opinions qui n'ont qu'un temps : voilà ce qui convient à l'Europe, voilà ce que je propose aujourd'hui.
De même que les révolutions des empires, lorsqu'elles se font par les progrès des lumières, amènent toujours un meilleur ordre de choses, de même la crise politique qui a dissous le grand corps européen, préparait à l'Europe une organisation plus parfaite.
Cette réorganisation ne pouvait se faire subitement, ni d'un seul jet ; car il fallait plus d'un jour pour que les institutions vieillies fussent entièrement détruites, et plus d'un jour aussi pour qu'on en créât de meilleures; celles-ci ne devaient s'élever, celles-là tomber en ruines que lentement et par des degrés insensibles.
Le peuple anglais, que sa position insulaire rendait plus navigateur que les autres peuples de l'Europe, et par conséquent plus libre des préjugés et des habitudes natales, fit le premier pas, en rejetant le gouvernement féodal pour une constitution jusqu'alors inconnue.
Les restes à-demi détruits de l'ancienne organisation européenne subsistèrent dans tout le continent ; les gouvernements retinrent leur première forme, quoiqu'un peu modifiée en quelques endroits ; le pouvoir de l'église méconnu dans le nord, ne fut plus, dans le midi, qu'un instrument de servitude pour les peuples et de despotisme pour les princes.
Cependant l'esprit humain ne restait point inactif; les lumières s'étendaient et achevaient partout la ruine des anciennes institutions : on corrigeait des abus, on détruisait des erreurs, mais rien de nouveau ne s'établissait.
C'est qu'il fallait que l'esprit novateur fût appuyé d'une force politique, et que cette force, résidant dans la seule Angleterre, ne pouvait lutter contre les forces du continent entier, qui servaient de rempart à tout ce qui restait du régime arbitraire et de l'autorité du pape.
Aujourd'hui que la France peut se joindre à l'Angleterre pour être l'appui des principes libéraux, il ne reste plus qu'à unir leurs forces et à les faire agir, pour que l'Europe se réorganise.
Cette union est possible, puisque la France est libre ainsi que l'Angleterre ; cette union est nécessaire, car elle seule peut assurer la tranquillité des deux pays, et les sauver des maux qui les menacent ; cette union peut changer l'état de l'Europe, car l'Angleterre et la France Unies sont plus fortes que le reste de l'Europe. […]
MESSEIGNEURS, vous seuls pouvez hâter cette révolution de l'Europe, commencée depuis tant d'années, qui doit s'achever par la seule force des choses, mais dont la lenteur serait si funeste.
Et ce n'est pas seulement l'intérêt de votre gloire qui vous y invite, mais un intérêt plus puissant encore, le repos et le bonheur des peuples que vous gouvernez.
Si la France et l’Angleterre continuent d’être rivales, de leur rivalité naîtront les plus grands maux pour elles et pour l’Europe ; s’ils elles s’unissent d’intérêt, comme elles le sont de principes politiques, par la ressemblance de leurs gouvernements, elles seront tranquilles et heureuses, et l’Europe pourra espérer la paix.
[...] L'âge d'or du genre humain n'est point derrière nous, il est au-devant, il est dans la perfection de l'ordre social ; nos pères ne l'ont point vu, nos enfants y arriveront un jour : c'est à nous de leur en frayer la route. »
Comte de Saint-Simon, De la réorganisation de la société européenne, ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples d'Europe en un seul corps politique, en conservant à chacun son indépendance nationale, Paris, chez Adrien Egron, 1814.
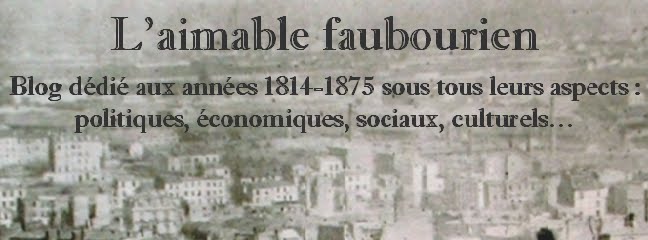

.jpg)









