Marchand chinois photographié avec sa femme
à la fin du XIXe siècle en Birmanie. Coll. British Library.
« L'industrie variée de la ville de Reims, productrice d'étoffes légères, avantageuses de prix et de qualité, avait paru devoir être l'une des favorisées, dans le cas où des débouchés s'ouvriraient à nos importations dans l'extrême Orient. Les faits que nous avons constatés ont confirmé ces prévisions, et les observations que nous avons consignées prouveront la possibilité de placer avec plus ou moins de succès les articles de cette fabrique en Chine et dans les colonies espagnoles, anglaises et hollandaises de l'Archipel indien.
L'une des premières conditions de réussite des articles destinés à l'exportation, c'est d'être exécutés dans les manufactures spéciales par des fabricants habitués à produire des étoffes similaires et dont l'expérience est une garantie de succès. Il arrive trop souvent, ou que l'on achète, sans souci des exigences de la consommation étrangère, des tissus établis suivant les goûts et les nécessités de la toilette française, ou que l'on ne se préoccupe nullement des habitudes de travail des ateliers auxquels on confie l'exécution des assortiments. Dans le premier cas, qui est le plus fréquent, on jette sur les marchés des Indes et des Amériques des marchandises qui ne sauraient y convenir, et qui y sont inévitablement rebutées et sacrifiées. Dans le second cas, on arrive à livrer des produits à peu près conformes aux types proposés, mais dont la laine, le montage, le tissage et presque toujours les apprêts laissent à désirer ; de là une cause non moins réelle de dépréciation. Nous avons constaté, dans les colonies françaises, hollandaises et espagnoles des mers de l'Inde et de la Chine, ces regrettables erreurs ; nous ne saurions donc trop conseiller à nos négociants, à ceux qui veulent loyalement remplir les ordres de leurs correspondants ou préparer des expéditions, de s'adresser aux foyers spéciaux des différents genres de lainages, et de ne pas provoquer par leurs commandes des déplacements ou des changements de fabrication. […]
Sans doute la toilette chinoise ne subit pas comme la nôtre la fantaisie de la mode ; la génération actuelle s'habille à peu près comme celle qui l'a précédée il y a dix siècles, et les traditions nationales, les lois somptuaires, les prescriptions des livres des rites, imposent à toutes les classes la rigoureuse observance des coupes, des couleurs et des ornements des vêtements. On exagère cependant la fixité des habitudes en matière de toilette ; les formes, et non point les étoffes, sont déterminées et consacrées par l'usage ; celles-là sont immuables, mais celles-ci peuvent être changées et varient en effet. […]
Si la Chine devait rester longtemps encore aussi immuable qu'elle l'a été pendant tant de siècles, il faudrait renoncer à nos espérances ; mais elle a déjà effectué dans ces dernières années quelques modifications dans ses coutumes. Ses affaires avec la Compagnie des Indes l'ont amenée à l'usage de nos étoffes de laine, et un contact continuel avec les étrangers l'habitue à nos produits et tend à les lui faire adopter. Suivant des négociants expérimentés de Canton, la flanelle est destinée à entrer, dans un temps plus ou moins éloigné, dans l'habillement des Chinois du littoral du Sud et du Sud-Est, et sa consommation serait déjà assez importante, si elle n'avait la concurrence de la finette américaine et du molleton de coton japonais. […]
Les Chinois se décideront-ils jamais à adopter dans leurs costumes et dans leurs ameublements les étoffes variées désignées en France par le nom un peu ambitieux de nouveautés ? Accepteront-ils nos dessins et nos combinaisons de nuances ? En un mot, notre goût est-il incompatible avec le goût chinois ?
S'il ne s'agissait ici que de satisfaire à un mouvement de curiosité, nous nous abstiendrions de toute recherche ; mais la question que nous posons a un caractère et un but essentiellement pratiques ; elle veut donc une solution, que nous avons essayé de trouver.
Les dessins qui couvrent ou constituent les tissus de Reims peuvent se diviser en quatre classes : 1° les rayures droites, diagonales ou flexueuses, les côtes-lignes, les carreaux à filets simples et les damiers ; 2° les dispositions quadrillées et écossaises variées à l'infini; 3° les mouchetés, les treillis lins et légers, les semis de fleurettes, de pois et de croisettes, etc. ; 4° enfin, les ramages, les fleurs, les lianes et tous les sujets à fond couvert.
De ces genres, celui dont l'adoption a été la plus générale chez nous est sans contredit l'écossais ; il semble que l'on ait épuisé, pour obtenir des effets nouveaux, toutes les combinaisons possibles de ligues, de rayures et de carreaux, et on les a diversifiés par des ombrés, des diversions de tissu, des jaspures et des oppositions de couleurs souvent originales. Que ce travail fût appliqué à des coatings, à des mérinos ou à des mousselines, peu importait aux Chinois ; ils le regardaient à peine, et plus d'une fois des marchands de Canton offrirent pour certaines tartanelles un prix avantageux, à la condition qu'elles ne seraient pas couvertes de quadrillés écossais. La vente de tout article façonné de la sorte est réellement impossible. […] Quelques Chinois éclairés, qui se rendent familiers les usages et les goûts européens, ont pensé à adopter pour les ameublements celles des dispositions qui leur plaisaient le plus. Ils avaient choisi, parmi les échantillons, des écossais qui devaient être affectés à une double destination ; les uns, en tartan léger, auraient recouvert des coussins de sièges ; la répétition de 40 centimètres au carré environ devait être entourée d'une double bande à filet qui eût servi de bordure; les autres, en mérinos ordinaire, étaient pour tentures et fichus de tête ; ces derniers devaient imiter les mouchoirs hong-ki-poun fabriqués dans les environs de Canton.
Les rayures et les damiers n'ont pas eu plus de succès que les écossais, et, à Canton comme à Chang-Hai, on a manifesté pour eux une antipathie singulière. On les a partout rejetés ; il a suffi de la présence d'une côte-ligne dans une disposition pour amener la dépréciation d'articles d'ailleurs excellents. Cette répulsion a d'autant plus lieu d'étonner que les Chinois fabriquent eux-mêmes des étoffes en coton à carreaux grands et petits et à mille raies quadrillées. Ils n'aiment pas non plus les fonds unis mouchetés, résiliés de linéoles, finement zébrés, guillochés ou semés de pois, de fleurettes, etc. Ce qu'ils recherchent, ce sont les ramages, les enlacements de feuilles et de fleurs, les dessins qui se rapprochent de ces arabesques particulières à la Chine et qu'il serait plus juste d'appeler des chinesques. […]
Nous avons déjà établi qu'en Chine les formes seules des vêtements sont strictement maintenues ; elles sont, en effet, imposées par la loi civile, motivées et consacrées par les souvenirs historiques. La nature des étoffes a varié, les couleurs traditionnelles ont été altérées ; enfin, à l'exception des insignes et des sujets symboliques, les dessins et les ornements ont été modifiés. Le goût n'est donc pas immuable en Chine, chaque jour il y devient moins exclusif ; les ramages des mousselines lancées de Saint-Quentin, les bouquets des indiennes perses d'Alsace, les arabesques et les fleurs des damas et des vénitiennes de Rouen et de Roubaix ont obtenu les éloges des Chinois. On sait que les négociants américains, habiles à profiter du bas prix de la main-d'œuvre et de la soie en Chine, y font exécuter, d'après les dessins de Lyon et de Paris, les soieries destinées à la vente de l'Amérique du Sud et des Etats-Unis. Nous avons constaté que la plupart de ces dessins ont été adoptés par les fabricants chinois et sont aujourd'hui tout à fait naturalisés. […]
Reims ne produit pour hommes, en étoffes de fantaisie, que des tartans pour habillements du matin ou doublures de manteaux, diverses armures légèrement drapées pour pantalons, des circassiennes et des mérinos doubles pour vêtements d'été, des duvets, des cachemires et des salins pour gilets, des napolitaines imprimées et des mérinos écossais pour cravates d'hiver, etc. Pas un seul de ces articles ne peut s'appliquer au costume des Chinois.
Ce costume se compose de quatre pièces principales : le pô, espèce de chéong-cham, est une longue robe flottante qui se boutonne sur le côté, descend presque jusque sur le coude-pied, et dont les deux pans de devant et de derrière sont distingués par deux fentes fermées par de petits boutons ronds en cuivre estampé. Les manches sont amples et longues, mais les parements se retroussent et le pli formé par leur rabattement est maintenu par un bouton. Le collet, ordinairement rapporté, est en drap lin ou en soierie bleu-ciel. Le pô est le vêtement que portent les marchands dans leurs boutiques, les négociants dans leurs hongs et les dignitaires dans leurs appartements ; c'est la tenue habituelle, le costume de travail et d'intérieur. […] Le ma-koua est un surtout, une sorte de pèlerine à manches amples, qui se boutonne par devant et descend jusqu'à la ceinture. […] Le taï-koua est aussi un surtout, une pelisse, presque un paletot ; il descend jusqu'aux genoux, a de larges manches terminées en forme de sabot de cheval, et relevées, quand on est dans l'intérieur, pour ne pas gêner les mouvements des mains. Cet habillement est porté ordinairement par les dignitaires ; les négociants et les bourgeois ne s'en révèlent que les jours de fête et de cérémonie. […]
Telles sont les quatre pièces principales du costume chinois : la première est de couleur grise ou bleue (bleu clair et gentiane); la deuxième, bleu mazarin ou fleur de pensée, et la troisième, le taï-koua, est bleu foncé pourpré, pensée ou grenat riche. Les doublures sont de préférence en satin ou en damas bleu ciel. Les nuances des culottes sont variées à l'infini. Comme cette partie du vêtement n'est souvent pas visible, les Chinois en choisissent la couleur suivant leur fantaisie ; il y en a en vert-pomme, en rosé, en mordoré, en bleu ciel, en jaune paille, en solitaire, et beaucoup en vert-doré.
Ces détails prouvent l'impossibilité d'appliquer au costume des Chinois des classes supérieures et moyennes les articles de nouveauté de Reims : quant aux gens du peuple, coolies, artisans, bateliers, tisserands, trop pauvres pour acheter des lainages, ils ne consomment que des (issus de coton ; et au fur et à mesure que la brise fraîchit, que le froid devient plus rigoureux, ils se contentent de multiplier sur eux le nombre de casaques de cotonnade bleue, blanche ou brune, ou d'en endosser une ou deux ouatées de coton bombax. […]
Le costume des femmes du Céleste Empire diffère en tous points, nous l'avons dit plus haut, de celui des Européennes. Les vêtements sont montants et fermés, et les surtouts de soie, légers l'été, ouatés l'hiver, remplacent avec avantage les fichus et les châles ; l'usage de ceux-ci est inconnu et il ne faut pas espérer en donner le goût aux Chinoises. Quant aux cravates, les dames de distinction portent au cou, nouée négligemment et pendante jusqu'aux genoux, une longue et large bande roulée en soierie souple et légère, ordinairement fond blanc avec des lignes ponceau quadrillées, et garnie aux deux extrémités de bordures brochées. On pourrait leur présenter en lainage des dispositions semblables qui plairaient également. Les châles de Reims, pour la plupart, ne conviennent pas pour la Chine, au moins en vue de l'usage auquel ils sont ordinairement consacrés. »
Natalis Rondot*, « Rapport à la Chambre de commerce de Reims »,
Etude pratique des tissus de laine convenables pour la Chine, le Japon,
la Cochinchine et l’archipel indien, Paris, Chez Guillaumin & Cie, 1847.
* Natalis Rondot (1821-1902) : économiste, industriel du textile, il est attaché en mission extraordinaire à l'ambassade française en Chine, afin de négocier des traités de commerce en Asie extrême-orientale.
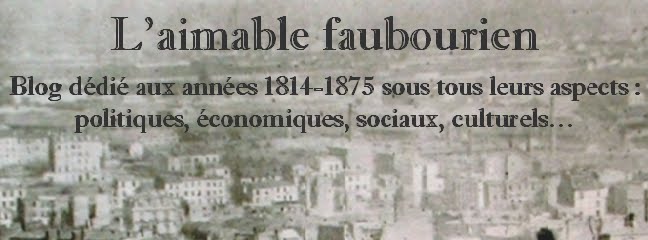



.JPG)
.JPG)









