"M. Gutierrez de Estrada demande à Napoléon III de restaurer la monarchie au Mexique et lui parle de l'archiduc Maximilien, frère de l'Empereur d'Autriche". Dessin paru dans Taxile Delord, Histoire illustrée du Second Empire, vol. 3, Paris, Chez Alcan, 1892-1895.
« Qu'est-ce que cette expédition ? Que veut-elle ? Que cache-t-elle ? Est-elle dans l'intérêt public, ou dans l'intérêt d'un seul ? Où peut-elle aboutir ? Le pays qui est lancé dans cette entreprise est celui qui serait le plus embarrassé de répondre à ces questions. Il ne sait pourquoi il fait cette guerre, ni comment il y a été engagé. Il verse son sang et celui d'autrui, et ne peut dire pour quelle cause. […]
En 1781, la France a mis le pied en Amérique ; ce fut pour l'aider à s'affranchir — expédition qui ouvrit l'époque nouvelle et rapporta la liberté dans le vieux monde. En 1862, la France débarque de nouveau, mais cette fois il ne s'agit plus d'affranchir ; il s'agit de faire violence. Dans les deux cas, la question renferme les intérêts de tout un monde. Le Mexique n'est qu'un point, d'où l'on espère rayonner sur un hémisphère. En 1781, la petite expédition de Lafayette et de Rochambeau devait laisser après elle tout un continent libre. En 1862, l'expédition du Mexique, si elle se développait, telle qu'elle a été conçue, aurait pour résultat tout un continent esclave, ou du moins asservi.
Entrez dans l'esprit bonapartiste, et ce que vous appelez "ses mystères politiques" se dissipera à vos yeux. […] On vient de vous le répéter ces jours-ci. Le Bonapartisme n'est pas simplement une opinion politique ; c'est un "culte" une "adoration," une "superstition." Le principal de ces dogmes superstitieux, c'est qu'il doit réaliser la chimère du grand Empire napoléonien. Et puisque l'Europe est assez mal avisée pour ne pas se prêter à cette félicité, il est naturel, il est inévitable, que l'on se retourne vers l'Amérique. Là doivent se trouver ces vastes espaces et les peuples soumis qu'on désespère de s'annexer en Europe. On ne parle plus de la frontière du Rhin, il faut aller chercher un Rhin dans le nouveau monde. Vous ne saurez jamais avec quelle rapidité s'éveillent les ambitions démesurées de pouvoir, les visions de domination dans un esprit rempli de ce que l'on a appelé les Idées Napoléoniennes.
L'occasion du projet d'invasion du Mexique a été la guerre des États-Unis. Aux premières nouvelles d'un échec des États du Nord, le Gouvernement des Tuileries se persuada que c'était fait de la grande République américaine. Du moins, il crut qu'elle était trop occupée pour mettre obstacle à une entreprise bonapartiste. Il ne s'agissait que de choisir l'endroit où l'on porterait le grand coup à l'indépendance du nouveau monde. Le Mexique parut l'endroit propice ; il se remettait à peine, sous un gouvernement régulier et libéral, de ses longues guerres civiles. Avant de laisser ses plaies se cicatriser, on viendrait le frapper inopinément ; et même il n'y aurait pas besoin d'une longue guerre ! Car on ferait à Vera-Cruz ce que l'on a fait à Civita-Vecchia ! L'exemple de l'expédition romaine profiterait ainsi à l'expédition du Mexique. On recommencerait en 1862 l'œuvre et les stratagèmes de 1849. On se présenterait en alliés. Le drapeau tricolore, n'était-ce pas la liberté, l'indépendance ! […] La facilité d'illusion est si grande dans l'auteur de cette entreprise, qu'il est allé jusqu'à penser que le nom seul de Bonaparte courberait les hommes jusqu'à terre. A peine aurait-on besoin de paraître ! Et l'on verrait au Mexique les anciens adorateurs du soleil, se prosterner devant le soleil couchant de la fortune napoléonienne.
[…] Nous voilà à Mexico, de gré, ou de force, qu'importe ? Une nation libre est effacée de la terre. C'est déjà un point satisfaisant; mais ce n'est là encore qu'un commencement. Ce peuple s'appartenait à lui-même. Il avait acheté cette liberté orageuse au prix de torrents de sang. Il s'agit de tout lui reprendre en un jour, de telle sorte qu'il paraisse lui-même complice de son reniement et de son abdication. Pour cela, rien de plus simple; nous appliquons à cette difficulté un autre de nos nouveaux principes de 1789, à savoir qu'un peuple n'est vraiment libre que s'il est asservi à l'étranger. Son suffrage n'est volontaire et sincère que s'il vote sous les baïonnettes ennemies, teintes du sang des défenseurs de la patrie ! Nous tiendrons l'urne de Mexico, et les Mexicains auront toute liberté, une fois qu'ils seront conquis ; moyennant pourtant qu'ils feront sortir de cette urne esclave une monarchie despotique à notre usage. Appelons-la d'abord autrichienne, pour intéresser à ce grand coup toute la vieille Europe. Autrichienne, ou non, il est convenu que cette monarchie sera avant tout bonapartiste. C'est là un rideau que nous tendons, pour amuser nos alliés ; mais le rideau tiré, il restera purement et simplement au pied des Andes un deux-décembre gigantesque qui menacera et convoitera tout un continent. Napoléon en 1812 a manqué sa carrière ; il n'a pu asservir le vieux monde. Il s'agit de réparer sa fortune en asservissant le Nouveau. »
Edgar Quinet, L’expédition du Mexique, Londres, W. Jeffs, 1862.
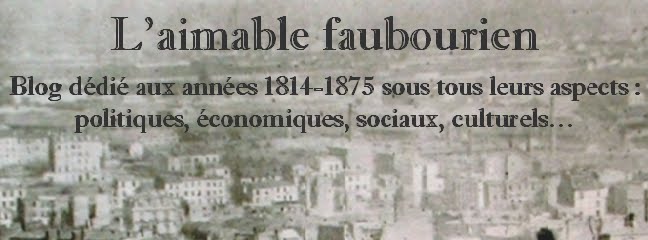
.JPG)










