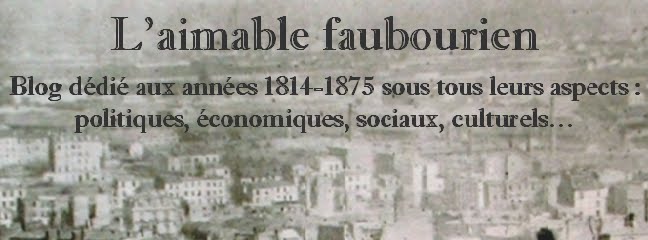La Révolution française de 1848, aquarelle de Cesare Dell'Acqua (1821-1905).
La première partie de l'article d'Eugène Loudun est à retrouver en cliquant sur le lien suivant :
« La province, il faut l'avouer, n'était pas préparée à la République : bien plus, elle en avait peur. Le mot de république ne lui représentait que la Terreur ; la République, c'était le sang et l'échafaud. Aujourd'hui, elle ne doit plus craindre ; mais on ne change pas tout aussitôt, et elle n'est pas, pour employer l'expression révolutionnaire, à la hauteur de Paris. On parle d'idées fédéralistes qui se prononceraient dans quelques départements ; si l'on entend que la province songe à scinder en Etats indépendants comme ceux d'Amérique, unis par un lien fédéral, il y a exagération. Ce qui émeut la province, et ce qu'elle veut au moins modifier, c'est la centralisation excessive, et tous les bons esprits sont d'accord avec elle. La province n'est plus ce qu'elle était il y a vingt ans : la facilité et la rapidité des communications, les voyages répétés à Paris, les courants des idées ont changé l'esprit provincial. Il n'est plus aussi routinier, il n'est plus apathique ; il se permet de juger et de censurer, et il nous juge sévèrement. Plusieurs rédacteurs en chef de journaux de province viennent d'être placés dans de hauts emplois à Paris ; c'est la preuve de son influence. Les départements ne veulent pas qu'un million d'hommes dirige complètement et toujours trente-six millions d'hommes, qu'il suffise d'un signe de la tête pour que tout le corps obéisse, et qu'un soudain mouvement de la capitale impose sa volonté à la France entière. On ne le veut pas davantage à Paris ; il n'y aura pas de fédéralisme ; elle ne sera pas détruite cette magnifique unité de la France qui nous a coûté tant de siècles, tant d'argent et tant de sang, et par laquelle nous sommes la première nation du monde ! Ce qui sera changé, c'est le système administratif ; on brisera le réseau à millions de fils des ordonnances, des arrêtés, des circulaires et des rapports qui enchaînait la province, qui arrêtait toute action, qui faisait qu'un pont ne pouvait établir une communication entre deux villes sans que tous les commis de dix bureaux eussent examiné, pesé, contrôlé, raturé, et gardé des mois entiers l'arrêté ministériel qui devait donner le mouvement et la vie à toute une population. La province n'a rien à craindre de ce côté ; la capitale l'aidera ; et, s'il était nécessaire, les députés des départements ne seraient-ils pas unanimes pour reconquérir leurs droits ?
Mais où le danger pourrait commencer, ce serait si, les élections générales étant retardées, l'ardeur magnanime qui plane sur la France allait s'amoindrir, si les intérêts mesquins qui se tassent et se rencoignent au fond des provinces, les petites personnalités des petites villes impatientes de se produire à la tribune pour être écoutées de l'univers, les ambitieux longtemps contenus et pâles d'envie, les intelligences retirées dans d'étroites spécialités, et fortes du despotisme de leurs théories, venaient à l'emporter sur de larges et généreux esprits, et arrivaient à l'Assemblée avec leurs sourdes rivalités et leurs amitiés plus dangereuses encore. Ils seraient transplantés tout d'un coup d'un sol maigre et d'un climat attiédi dans une terre brûlante et un air enflammé comme celui des tropiques ; quelques-uns, d'une nature vigoureuse, se reconnaîtraient immédiatement dans le milieu qui est propre à leur activité et à leurs nobles pensées ; mais les corps amoindris, en qui l'ardent soleil ne fait pas courir le sang plus vite, s'ils accueillaient par la froide et implacable raillerie des petites coteries le bel élan qui nous emporte, s'ils résistaient, et voulaient arrêter par leur impassibilité, ne seraient-ils pas la cause des colères et des tempêtes ? ne serait-il pas possible que les séances de l'Assemblée nationale ne devinssent des luttes où le peuple viendrait prendre sa part ? ne verrait-on pas se renouveler les invasions des hordes armées dans la Convention, et ne gouvernerait-on pas par des accès de fièvre, et à coups d'émeutes et de pavés ?
Ces craintes heureusement ne sont encore que des doutes, et nous ne les avons abordées que parce que nous avons voulu dire toute la vérité. Nous avons de justes et fortes raisons de croire qu'elles seront vaines ; on mûrit vite par les révolutions, et déjà peut-être les intérêts des petites villes rentrent dans l’ombre, et un noble tressaillement de la France annonce l'unanimité de préoccupations généreuses.
Nous ne sommes donc pas effrayé de ces occasions de trouble ; les idées qui ont pénétré la masse, et qui forment le fond de notre caractère, voilà les maux qui doivent appeler la réflexion des esprits sérieux, et unir tous les hommes de conviction, de patriotisme et d'enthousiasme, pour les combattre et les vaincre : c'est la corruption que le gouvernement déchu nous a apprise, et à laquelle il nous a habitués pendant dix-huit ans, et dont les racines ont atteint tant de cœurs nés avec les instincts du dévouement.
La république, a dit M. de Chateaubriand, est le meilleur des gouvernements quand le peuple a des mœurs ; le pire, quand il n'en a pas. Il ne faut pas croire que, parce que nous avons fait une révolution, nous ayons détruit la corruption ; elle existe non en profondeur, mais en étendue. Ils sont nombreux ceux qui avaient recueilli une oreille avide ces paroles d'un ministre de Louis-Philippe : Enrichissez-vous ! et celles-ci d'un autre homme, âme de ses conseils, M. Dupin : Chacun chez soi, chacun pour soi ! Ils vivent encore ces pères qui lançaient leurs enfants dans la vie en leur disant : Va faire-fortune ! Et on en a eu une preuve évidente par la curée éhontée à laquelle tant de gens se sont précipités dès le lendemain de la victoire. Mais, sans vouloir exciter les haines et aduler le peuple, avouons-le, cette cupidité, elle est attachée surtout à la peau de la classe moyenne ; c'est la bourgeoisie qui est le plus réellement corrompue, c'est elle qui s'est élancée vers le pouvoir et qui crie avec le plus d'ardeur : Vive la République ! Ce sont ceux-là dont il faut se garder, soit qu'ils enseignent la jeunesse au coin du foyer dans la famille, soit qu'ils prêchent hautement et publiquement à la face du peuple; ils n'emploieront plus les mêmes paroles et les mêmes moyens ; ils flatteront le peuple, mais ce seront les mêmes qui flatteraient les rois. Notre littérature, depuis quinze ans, était bien, selon le mot d'un penseur, l'expression de la société ; la plupart des hommes qui ont acquis une réputation littéraire l'ont gagnée parce qu'ils caressaient les inclinations sordides et les passions avilissantes ; ils ne songeaient pas à instruire, ils voulaient plaire ; on peut trouver dans leurs livres toutes les maximes des tyrans et les règles de corruption, qu'ils présentaient comme les moyens les plus naturels de gouverner. Ils expliquaient tout, ils excusaient tout, parce qu'ils excusaient ainsi leurs vices.
La masse de la nation, heureusement, n'est pas encore gangrenée de ces maximes désolantes ; le peuple n'a point été semblable à ces eaux souterraines qui sourdent à travers les couches inférieures, et qui pénètrent à des distances infinies; comme un violent torrent arrêté un moment, il a débordé furieux, irrésistible ; il a forcé l'obstacle, puis il est rentré paisiblement dans son lit, et il roule puissant et majestueux à travers ses bords escarpés. Cette révolution, d'ailleurs, si forte, si spontanée, a été le soudain réveil de la dignité humaine trop longtemps violentée. Retenus sous la montagne comme le Titan de la fable par trois cents chaînes d'airain, nous nous raidissions contre le poids qui nous accablait ; nous nous sommes redressés enfin, nous avons fait voler en éclats les premières couches qui enserraient le volcan, et nous voilà prêts pour les grandes actions et les grandes vertus. Cette révolution aura changé en un moment bien des âmes ; elle aura été le coup de foudre qui terrassa Saul sur le chemin de Damas ; il se releva purifié, illuminé, et il partit pour la conquête du monde au nom du Christ et de la liberté.
Nous lutterons donc avec la corruption et, espérons-le, nous en triompherons. En sera-t-il de même d'une idée qui plaît à l'esprit par une spécieuse apparence de justice, l'idée d'une égalité complète, illimitée ? Notre société est fondée sur le droit populaire, sur le principe de liberté ; mais, dans l'ignorance de la distinction des droits et des devoirs, quelques-uns ont cru que la liberté c'était l'égalité : erreur de grands esprits du siècle dernier ! Autant la liberté est naturelle à l'homme, autant lui est impropre l'égalité ; si Dieu avait créé l'égalité, il aurait créé l'unité, et le monde eût été Dieu ! Aussi le principe de l'égalité est-il de l'école des panthéistes. Il va apparaître , et des clubs retentissent déjà de leurs doctrines, des hommes qui, pendant quinze ans, ont rêvé dans la privation, le malheur ou les prisons, de chimériques institutions, qui trouvent que nous ne faisons rien encore, qui apportent les fumées d'une imagination sans cesse appliquée à un même objet, et qui en demandent la réalisation impossible. On périt vite parles excès, et les excès arrivent vite en révolution. Ce sera la tâche du peuple et du gouvernement à la fois de découvrir et de montrer les excès et l'injustice de ces prétentions isolées ; ce sera au bon sens du peuple de comprendre qu'il dira une vérité celui qui, ne s'aveuglant pas dans l'orgueil de ses systèmes, reconnaîtra qu'il n'est point l'égal des plus âgés, des plus intelligents, des plus vertueux, de sera la part de la sagesse du gouvernement de s'adresser au peuple avec une austère franchise, de poser les principes de ses devoirs à côté de ses droits, de proclamer que la révolution n'a pas été faite pour une partie, pour les ouvriers seulement, mais pour les bourgeois et les nobles, les riches et les prêtres, qui sont aussi le peuple, et que, si nous avons conquis la liberté, elle doit appartenir à tous.
C'est ici que commence l'obligation du gouvernement, et déjà, par une volonté de Dieu peut-être, il se trouve qu'il a peu fait encore ; il s'est appliqué à des détails, il n'a pas touché à de grandes choses ; il a compris qu'en tout, dans la nature, dans l'homme, dans les institutions, il y a trois temps d'action : le commencement qui prépare, le milieu qui mûrit, et la fin qui complète ; que les hommes forts sont les seuls patients, et qu'il ne faut pas changer trop vite si l'on veut la durée : Tempora tempore tempera.
Ce n'est pas tant des lois qui nous sont nécessaires que l'exposition des devoirs, et ces devoirs il les faut présenter, non en homme qui les pose en avant de lui comme des barrières, mais parce que c'est la vérité, et qu'il faut dire la vérité. Il faut que le gouvernement dise au peuple : voici vos devoirs, remplissez-les ! J'ai aussi les miens ; si j'y suis infidèle, accusez-moi et jugez-moi ! Qu'ils ne cherchent pas les applaudissements de la foule, elle les mépriserait ; qu'ils restent impassibles au milieu des éloges et des blâmes, prouvant seulement qu'ils sont dignes de marcher à notre tète par leur esprit de justice et leur probité. Les lois éternelles du juste n'ont pas été détruites par la révolution, au contraire ; les hommes seuls sont changés. Les révolutions se font parce que le peuple se rebelle contre l'injuste et veut rétablir le droit, et le droit ne va pas sans le devoir. En lui parlant des devoirs on ne lui dira pas une chose nouvelle, on lui rappellera ce qu'il sait, et ce que les hommes sont prompts à oublier. Le peuple est un enfant plein des plus magnanimes instincts, généreux, confiant, emporté, sensible, mais ignorant, ignorant en ce sens qu'il ne sait pas les causes, qu'il ne connaît pas les hommes, qu'il n'est frappé que des noms, et ainsi il croit tout aussitôt. C'est pour cela que les tyrans le tiennent dans l'ignorance. Nous, pour avoir la liberté, instruisons-le, et éclairons-le : plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres !
Le peuple a le sentiment du devoir ; il l'a dans ses entrailles, et quand on lui en parlera on le fera vibrer. Ce mot, dit au siècle dernier par d'Alembert, sera éternellement vrai : "La raison Unit toujours par avoir raison."
Dès qu'il s'est dit : Je le dois ! l'homme sent planer au-dessus de sa tête, non la destinée antique, implacable divinité qui soumettait les dieux, mais un pouvoir que lui-même a consacré : l'âme se tient dans une paix puissante qui naît de l'équilibre de toutes les facultés ; le visage même revêt cette noblesse et cette dignité données par le sculpteur grec aux types parfaits de la nature humaine. On n'est plus un enfant turbulent dans ses chagrins et ses joies; on est homme, et l'on se sent vivre dans la plénitude de sa volonté et de sa liberté.
Mais si le devoir est la liberté, il est aussi la solidarité, et la solidarité nous unit tellement qu'il a été juste de dire que, si l'inférieur porte sa chaîne au pied, le supérieur la porte au poing. Dans la tyrannie , cette solidarité est une chaîne ; dans la liberté , la chaîne est formée par les mains ; nous nous tenons tous, tous nous marchons en bande serrée contre le flot des événements ; le devoir de tous est de la maintenir pour qu'elle ne se rompe pas et que les vagues, s'engouffrant par la brèche ouverte, ne renversent les faibles et les forts, les petits et les grands, et ne nous emportent tous dans un commun désastre. Que les gouvernants tiennent ce noble langage au peuple, qui attend de leur parole les droits, les devoirs, la solidarité, et alors se constituera naturellement l'état politique qui est la réunion de toutes les forces particulières. Aux ouvriers sera assuré le travail ; aux poètes, la gloire ; aux ardents, l'action ; aux industriels, le commerce ; à tous, leurs droits ! Que le gouvernement invoque, qu'il rappelle l'ancienne devise de la France, oubliée par un gouvernement qui donnait tout à l'argent : L'HONNEUR ! Et le monde verra alors si la France n'a pas grandi encore !
Vous autres Français, disait un Anglais, Lord Chesterfield, vous ne savez élever que des barricades ; mais vous n'élèverez jamais de barrières ! Ce mot est faux. Si nous élevons des barricades, c'est que nous avons à la fois le plus vif sentiment du droit et le plus énergique emportement pour renverser l'injustice. Mais il est faux encore en ce qu'il voudrait établir cette, réputation de légèreté qu'on a faite à la France. Le peuple français léger ! Il n'est pas grave et compassé, en effet, car il est l'action et la vie. Quel peuple, en Europe, dans le monde, dans aucun temps, a fait des choses plus fortes, plus sensées, plus pratiques et plus durables que le peuple français, lui qui a créé la langue la plus logique de l'univers, qui a établi l'administration la plus serrée, qui a formé la nation la plus unie, qui a fondé la société la plus générale ! Il y a longtemps que les plus hautes intelligences l'avaient proclamé ; il y a trois siècles déjà que Charles-Quint disait : les Portugais paraissent fous, et le sont ; les Espagnols paraissent sages, et sont fous ; les Français paraissent fous, et sont sages. Et c'est un cri de génie, parce que c'est un cri de vérité, que ce mot de Shakespeare : La France est le soldat aîné de Dieu !
Nous voulons marcher à la tête des nations ; et notre priorité nous ne la prouverons pas par un seul mouvement violent, magnifique, sublime, mais par une continuité de grandes actions, et les grandes actions sont les grandes vertus ! Non ! nul peuple, en ce moment, ne nous vaut ; nul n'a ce jet soudain, ce dévouement héroïque, cet oubli de la partie matérielle de l'homme. Dès que la France parait, dès qu'elle parle, dès qu'elle agit, le monde s'écrie : C'est le grand peuple ! En toutes choses, à la bataille, dans les sciences, dans les lettres, en révolution, elle donne un coup si violent qu'elle fait jaillir la lumière. Mais ce ne sera pas un éclair qui passe ; ce sera comme le soleil qui brûle au fond des deux, qui s'avance dans sa gloire à travers sa route éthérée, qui éclaire tout, qui échauffe tout, et qui fait lever de la terre la sève, les arbres, les fruits et la vie !
Mais nous ne serons pas forts et libres que pour nous seuls. On l'a dit, la révolution que nous venons de faire est le triomphe de la civilisation. L'humanité marche sans cesse. La République que nous fondons est le gouvernement de la fraternité : sans que les princes et les rois s'en soient rendu compte, tous les efforts du genre humain ont été faits pour amener le triomphe du principe de l'amour. Toujours, à travers les siècles, les hommes ont tendu les uns vers les autres ; tour à tour esclaves, serfs, sujets, ils ont peu à peu dépouillé leurs préjugés et leurs haines, et par là ils ont brisé leurs chaînes. Nous n'avons renversé le dernier gouvernement que parce qu'il avait pris pour but d'établir de nouvelles délimitations entre les hommes. L'histoire de vingt de nos années les plus remplies est dans trois mots : en 1788, nous étions des sujets, et nous ne comptions plus en Europe ; en 1793, on nous appelait citoyens, et nous propagions dans le monde le principe de la liberté ; en 1808, nous étions des Français, et nous ne portions plus aux nations que notre gloire, notre grand nom et des fers ! Aujourd'hui, un seul nom est resté, le nom d'hommes, et quand on dit : hommes, on dit : frères. C'est au profit de l'Europe, du monde entier, que nous venons de vaincre ; nous sommes libres, et nous disons aux peuples, et tous les peuples le répètent : Soyons un seul peuple, une seule famille ; plus de rivalités de commerce, plus d'inimitiés de nations, plus de haines ; n'ayons qu'une haine, celle de l'injustice ; ayons un seul but, la complète réalisation de la loi du Christianisme, la fraternité. »
Eugène Loudun (pseudonyme d'Eugène Balleyguier, 1818-1898),
« Du présent et de l’avenir de la révolution ». Le Correspondant, t. XXI, 10 mars 1848.