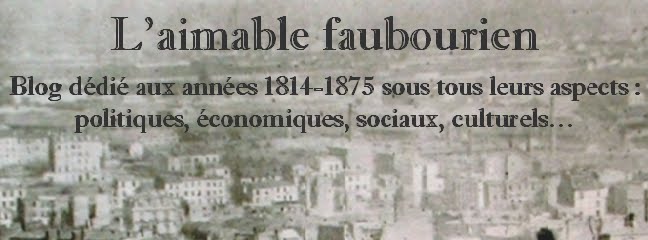Dessin extrait de Maurice Quentin-Bauchart, La caricature politique en France pendant la guerre, le siège de Paris et la Commune (1870-1871). Paris, Labitte, Em. Paul & Cie, 1890.
« Lorsque M. de Bismarck a répondu insolemment à M. Jules Favre, qui venait à Ferrières lui demander la paix ou tout au moins l'armistice, que nous ne pourrions obtenir cette paix qu'à la condition de lui livrer l'Alsace et la Lorraine, etc., etc., nous Français, nous avons répondu : plutôt mourir que de commettre une pareille lâcheté, et, puisque vous voulez notre déshonneur, que la guerre se continue donc et que Dieu nous juge !
Aujourd'hui nous disons à Guillaume, à ses dignes associés, ainsi qu'à leur chancelier : vous voulez la guerre d'extermination, faîtes-la donc cette guerre de cannibales ! Eh bien ! soit, la guerre sans merci, la guerre sans pitié ! de votre côté la guerre des sauvages, la guerre des barbares ! Quant à la France, elle est chevaleresque, elle est magnanime ; elle répondra à vos cruautés par la patience et par la persévérance; de son côté vous trouverez la guerre par les armes courtoises, mais aussi la guerre par le mépris, la guerre par la haine, la guerre par l'isolement !
Ah ! Guillaume, poursuis ta marche infernale ! mais ne t'aventures pas trop loin, car il y a des barrières que les plus audacieux ne sauraient franchir! Jettes un regard sur tes propres États ; vois ce que deviennent tes peuples au milieu de tes grandes victoires !
Vas donc demander, roi aveugle, aux SOIXANTE MILLE VEUVES et aux CENT CINQUANTE MILLE ENFANTS, qui aujourd'hui n'ont plus de pères, si leurs cœurs s'élèvent à l'unisson vers le diadème impérial dont tu as orné ton front ! Mais non ; demandes-leur plutôt si leur joie n'éclate pas en sanglots, en songeant à la misère et au désespoir que tu leur as légués !
Demandes aussi aux mères, qui ont eu tant de peine à élever leurs fils, si elles sont radieuses et fières en voyant les drapeaux français appendus aux murs des arsenaux de Berlin, et si, en contemplant ces glorieux trophées, elles ont oublié que ces mêmes fils, qu'elles ont tant de fois pressés dans leurs bras, sont morts sur la terre étrangère, privés de sépulture, en appelant à leur secours ces mères chéries qui, hélas ! ne les reverront plus !
Si tu faisais cette demande, roi superbe, la réponse pour toi serait foudroyante.
Mais les mères, les veuves et les orphelins ne peuvent, pas exprimer leur désir, leurs volontés, leurs douleurs et leurs espérances devant les Parlements : la politique leur est interdite ! Aussi, Guillaume, n'as-tu rien à craindre de ces êtres faibles et chétifs. Poursuis ton chemin; il te restera encore assez d'hommes sans cœur pour étouffer les cris des malheureux sous le bruit formidable de leurs chants guerriers et pour acclamer tes honteux triomphes !
L'avenir, un avenir glorieux pouvait t'appartenir ; tu l'as détruit : tu as terni ton blason après Sedan ; ta gloire éphémère tombera dans l'oubli, on ne se souviendra que de tes cruautés ! Quant à Bismarck, ton âme damnée, son nom sera buriné dans les archives humaines, à côté de ceux des doges de Venise, des inquisiteurs espagnols, des Cromwell, des Machiavel et des Mourawiew !
Poursuis ton chemin à travers ces champs désolés qui rappellent le chaos ; soutiens-toi bien sur cette terre mouvante; appuies-toi solidement sur le bras de Bismarck; attaches-toi à lui, car désormais vos destinées sont égales ! Unis dans le massacre, unis dans la victoire, VOUS serez unis dans le châtiment ! Avancez donc tous deux; avancez toujours ! le gouffre est là ! béant et profond ! Il vous attend, il vous réclame, il vous attire ! C'est en vain que vous chercherez à l'éviter. Je vous le dis : il est là, là sous vos pas ; et le nom terrible qu'il porte, ce gouffre que vous n'avez pas voulu voir, est un nom affreux, implacable, sans merci ni pitié, un nom qui ne comporté ni paix ni pardon : il s'appelle la Vengeance!
N'espère pas, cruel et ambitieux monarque, que les ressentiments du peuple français, trouveront leur dernier assouvissement dans cette lutte suprême, dans ces combats titaniques, dans ce déluge de sang. Non! Comme l'abîme appelle l'abîme, ainsi le sang appelle le sang, et la semence jetée dans les sillons français, creusés par tes boulets, n'enfantera que des moissons vengeresses !
Germains, des crimes de vos pères,
Le ciel punissant vos enfants ;
De châtiments héréditaires
Accabler leurs descendants.
Guillaume, ta couronne d'empereur sera bien lourde à porter ; le fatal rocher de la force et de la violence retombera sur toi ; la mère affamée qui voit mourir son enfant sur ses mamelles taries criera aux survivants : "Souvenez-vous !" Chaque meurtre humain est gros d'un serment de représailles. […] Et nos enfants, Guillaume, grandiront dans la colère, la haine et la vengeance !!!
Maintenant, sus aux Allemands ! »
Timon III. France et Allemagne. La Vengeance ! ! !, Bruxelles, Imp. J. Coquereau, janv. 1871.