Rencontre des empereurs français et autrichien le 11 juillet 1859
(lithographie autrichienne de 1859)
« Quel était le but officiel de la guerre d'Italie ? Il s'agissait d'enlever à l'Autriche ses possessions italiennes et d'assurer ainsi l'indépendance, non pas de l'Italie, selon l'acception révolutionnaire du mot, mais des différents États italiens. "Nous respecterons, disait l'Empereur, les territoires et les droits des puissances neutres ; nous n'allons pas en Italie pour y fomenter le désordre ; nous voulons délivrer ce pays de la pression étrangère qui pèse sur lui et contribuer à y fonder l'ordre sur des intérêts légitimes satisfaits" (Proclamation du 3 mai 1859).
Ce programme était celui de l'entrée en campagne. Il promettait d'exclure complètement l'Autriche du territoire italien, mais il acceptait tous les autres souverains de la Péninsule et maintenait implicitement l'idée de la Confédération italienne, déjà émise dans la brochure officieuse Napoléon III et l'Italie et dans les bases d'arrangement proposées précédemment à l'Autriche. Ces bases portaient (art. 4) qu'il conviendrait de "substituer aux traités entre l'Autriche et les duchés une confédération des Etats de l'Italie entre eux, pour leur protection mutuelle tant intérieure qu'extérieure" (Moniteur du 19 avril 1859). Si cette proposition, qui conservait à l'Autriche ses provinces italiennes, était dépassée, le projet de confédération subsistait toujours. La France et l'Europe savaient donc que le succès de nos armes devait substituer une Italie confédérée à l'Italie semi-autrichienne dont les cris de douleur nous avaient attendris.
Ce programme était celui de l'entrée en campagne. Il promettait d'exclure complètement l'Autriche du territoire italien, mais il acceptait tous les autres souverains de la Péninsule et maintenait implicitement l'idée de la Confédération italienne, déjà émise dans la brochure officieuse Napoléon III et l'Italie et dans les bases d'arrangement proposées précédemment à l'Autriche. Ces bases portaient (art. 4) qu'il conviendrait de "substituer aux traités entre l'Autriche et les duchés une confédération des Etats de l'Italie entre eux, pour leur protection mutuelle tant intérieure qu'extérieure" (Moniteur du 19 avril 1859). Si cette proposition, qui conservait à l'Autriche ses provinces italiennes, était dépassée, le projet de confédération subsistait toujours. La France et l'Europe savaient donc que le succès de nos armes devait substituer une Italie confédérée à l'Italie semi-autrichienne dont les cris de douleur nous avaient attendris.
Au fond, nous engagions une lutte d'influence contre l'Autriche. C'était une nouvelle phase de la vieille querelle poursuivie depuis des siècles entre la France et l'Allemagne dans le double but de posséder une partie du sol italien, et d'exercer une action plus ou moins grande sur les destinées politiques de toute la Péninsule.
Il n'y avait là rien que de très-avouable. Personne en France ne pouvait trouver mauvais que Napoléon III voulut prendre de ce côté, comme il l'avait déjà fait en Crimée, une revanche des traités de 1815. Les intérêts politiques les plus sérieux pouvaient, d'ailleurs, retirer d'une semblable guerre de très légitimes et très fécondes satisfactions. C'était quelque chose d'écarter l'Autriche de l'Italie, de l'amoindrir sans lui faire perdre son rang comme puissance allemande, et, surtout, sans fortifier d'une façon inquiétante aucun autre Etat. Le Piémont agrandi de nos conquêtes et déchargé, à notre profit, de deux de ses anciennes provinces, devenait assez fort pour résister à l'Autriche et ne pouvait cependant se soustraire à notre tutelle. Il continuait d'avoir besoin de nous et échappait ainsi à la tentation d'être ingrat.
Si de tels projets pouvaient être facilement acceptés, quelques-uns des moyens mis en œuvre causaient de vives inquiétudes et soulevaient de graves réclamations. Le Piémont était le complice avoué de la dévolution, l'ennemi de l'Église, et montrait dès lors, dans sa politique, une déloyauté audacieuse. Le prendre pour allié, lui donner un rôle prépondérant en Italie c'était s'exposer à fomenter le désordre. Le gouvernement français avait beau dire qu'il ne ferait pas cela, ou craignait qu'il n'eût la main forcée. Déjà il ratifiait le langage du Piémont, prétendant contre toute évidence que l'Autriche voulait absolument la guerre ; déjà il tolérait que le cabinet de Turin provoquât à la révolte les sujets des souverains dont on promettait de respecter les droits et les territoires ; déjà il acceptait le concours de Garibaldi et de ses volontaires. Ces faits et d'autres de même nature, qu'il serait trop long de rappeler, ne permettaient ni aux catholiques ni aux simples conservateurs d'accepter la guerre d'Italie avec sécurité. Les catholiques, surtout, ne pouvaient oublier le langage que M. de Cavour avait tenu au Congrès de Paris relativement aux Romagnes. Le ministre sarde ne devait-il pas profiter de la guerre pour réaliser les projets d'annexion qu'il n'avait pas craint alors de laisser voir ? Ces préoccupations étaient si générales, si vives et si fondées, que le gouvernement français reconnut la nécessité de s'expliquer catégoriquement. L'Empereur chargea son ministre des cultes d'éclairer le clergé sur les conséquences de la lutte. Et le ministre déclara que le souverain, après y avoir songé devant Dieu, promettait que sa sagesse, son énergie, sa loyauté bien connue ne feraient défaut ni a la religion ni au pays ; qu'il voulait que le Pape fut respecté dans tous ses droits de souverain temporel. Une dernière parole de l'Empereur vint affirmer plus fortement ces déclarations si explicites, si solennelles : "nous n'allons pas en Italie, dit-il, ébranler le pouvoir du Saint-Père, que nous avons replacé sur son trône."
Ces promesses étaient rassurantes. Cependant l'inquiétude subsistait. On craignait que les incidents de la guerre ne permissent à nos alliés, garibaldiens ou piémontais, d'acquérir assez d'influence pour déchirer notre programme. Les journaux officieux s'amusaient ou s'indignaient de ces craintes ; ils traitaient d’autrichiens ceux qui les laissaient voir et s'écriaient que la France étaient sûre de ses alliés comme d'elle-même.
Les Piémontais et les révolutionnaires commencèrent néanmoins par envahir les territoires neutres et par déclarer déchus de leurs droits les souverains que la proclamation impériale avait promis de respecter. Ne vous alarmez pas, disaient les optimistes ; ce sont là des accidents de guerre, des nécessités momentanées, des effervescences italiennes dont on aura raison au dénouement; les ambitions piémontaises et les déclamations de Garibaldi ne pourront rien contre la volonté de la France. L'Empereur a marqué son but, ce but sera atteint et non pas dépassé ou déplacé : nous aurons une Italie libre des Alpes à l'Adriatique sous la forme d'une confédération dont feront partie tous les souverains restés neutres et où le Pape, maintenu en possession de tous ses États, recevra un rôle digne de lui.
On dût croire bientôt que ce programme serait ponctuellement rempli. La guerre, au lieu de grandir les Piémontais et les garibaldiens, les annula. Garibaldi, que nous avons vu si puissant dans ces derniers temps, put à peine lever alors trois mille volontaires. Il fit quelque bruit, grâce aux journaux, mais nulle besogne. Pendant que les opérations décisives avaient lieu, il guerroyait sur les bords du lac Majeur contre un corps-franc de quinze cents autrichiens, et dans toutes les rencontres, chaque parti s'attribua la victoire. Au fond, corps-francs autrichiens et volontaires italiens, sentant qu'ils jouaient un rôle de comparses, ne jugèrent pas à propos de se faire grand mal. Quant à l'armée régulière du Piémont elle fut d'une infériorité manifeste. Elle n'eut aucune part dans les victoires de Montebello, de Magenta, de Malegnano ; elle eut été battue à Palestro sans l'arrivée de nos zouaves ; et le corps d'armée que commandait Benedek la fit plier à Solferino. Bref, elle montra très-bien, durant toute la campagne, qu'à forces égales ou même supérieures, elle se serait fort mal trouvée d'un tête-à-tête avec les Autrichiens. Custozza a prouvé qu'elle n'avait pas changé.
Napoléon III dominait donc la situation. Non-seulement il pouvait mettre fin à la guerre contre l'Autriche, mais il pouvait aussi faire rentrer chez eux les Piémontais et leurs auxiliaires. Que ce second point dût offrir des difficultés particulières, nous ne le nions pas ; seulement nous contestons qu'il fût impossible d'y arriver. L'empereur lui-même était certainement de cet avis lorsqu'il signa à Villafranca les bases de la paix. Voici ces bases, que le Piémont, auquel nous n'avions pas encore donné le droit de se jouer de nous, s'empressa d'accepter :
"Confédération italienne, sous la présidence honoraire du Pape."
"L'empereur d'Autriche cède ses droits sur la Lombardie à l'empereur des Français, qui les remet au roi de Sardaigne."
"L'empereur d'Autriche conserve la Vénétie ; mais elle fait partie intégrante de la Confédération italienne."
Cette paix donnait gain de cause à la politique de Napoléon III et terminait par des arrangements que pouvaient ratifier les catholiques, les conservateurs, les libéraux sincères, une guerre dont la Révolution s'était promis tout le profit. Le Pape conservait ses États ; les souverains restés neutres recouvraient les leurs, puisque la Confédération italienne n'était possible qu'à cette condition ; le Piémont s'arrondissait de la Lombardie ; la Vénétie, sans être absolument rendue à elle-même, obtenait, par le seul fait de son entrée dans la Confédération, des droits politiques et une existence nationale. Quant à la France, même en dehors de tout agrandissement territorial, elle avait la meilleure part dans la paix, une part digne de son rôle dans la guerre.
Victorieuse de l'Autriche comme elle l'avait été de la Russie, nulle autre puissance ne pouvait plus lui disputer le premier rang. Elle dominait l'Italie sans l'écraser et pouvait revendiquer plus hautement que jamais son titre de fille ainée de l'Eglise. La prudence et la modération de l'Empereur au lendemain de Solferino avaient ajouté à son autorité sur les souverains ; elles lui garantissaient particulièrement le bon vouloir de l'Autriche et devaient rassurer promptement tout le grand parti conservateur européen, un instant inquiété. Le principal organe des catholiques, L'Univers, ne pouvant penser qu'un acte revêtu de la signature de la France et de l'Autriche serait biffé par le Piémont et le conspirateur Garibaldi, applaudissait au caractère anti-révolutionnaire de la paix et s'écriait : "Gloire aux deux empereurs catholiques, qui ont fait entre eux la paix du monde et qui se réservent la protection de l'Église !"
Que fallait-il pour maintenir ces grands résultats les développer, en recueillir tous les fruits ? Il fallait rester dans la voie où l'on venait de rentrer par la paix de Villafranca, après avoir été sur le point d'en sortir. En d'autres termes, il fallait avoir une politique.
Les espérances que les bases de la paix avaient si légitimement fait concevoir furent bientôt ébranlées. Tandis que le Piémont et la Révolution continuaient d'affirmer leur programme, la France se montrait hésitante ; elle donnait de bonnes paroles aux catholiques, aux conservateurs, aux partisans de la Confédération italienne, mais elle laissait le champ libre au parti unitaire. Les gouvernements insurrectionnels et provisoires établis à l'ouverture de la guerre dans l'Italie centrale, restaient partout en fonction avec l'appui très ostensible du cabinet de Turin ; et, de son côté, le cabinet des Tuileries ne faisait rien pour mettre fin à cet état de choses. Les officieux cherchaient cependant à rassurer les esprits en disant que les négociations poursuivies à Zurich pour changer en traité définitif les bases de Villafranca, arrangeraient tout.
Bientôt on dût reconnaître que le gouvernement français, entrant dans les vues du Piémont, se réservait d'imposer des sacrifices au Saint-Siège. En effet, l'Empereur, répondant le 11 octobre 1859 à un discours où S. E. le cardinal Donnet lui avait respectueusement rappelé ses engagements, fit cette déclaration : "je vous remercie d'avoir rappelé mes paroles, car j'ai l'espoir qu'une nouvelle ère de gloire se lèvera pour l'Eglise le jour où tout le monde partagera ma conviction que le pouvoir temporel du Saint-Père n'est pas opposé à la liberté et à l'indépendance de l'Italie. Je ne puis ici entrer dans les développements qu'exigerait la grave question que vous avez touchée, et je me borne à rappeler que le gouvernement qui a ramené le Saint-Père sur son trône ne saurait lui faire entendre que des conseils inspirés par un sincère et respectueux dévouement à ses intérêts..." […]
Pendant que l'on préparait le traité de Zurich, le Piémont travaillait à l'annuler, et dès qu'il fut signé il l'annula. Que M. de Cavour et son roi n'eussent aucun souci de leur parole et de leur signature, on ne pouvait plus s'en étonner. Mais que la France leur donnât de telles licences contre des engagements qu'elle avait dictés et qui servaient ses plus grands intérêts ; voilà ce qui devait surprendre. Le monde eut cette surprise. Le Piémont garda tout ce qu'il occupait directement ou par ses complices et annonça la résolution de compléter son œuvre, c'est-à-dire de faire l'unité italienne. Le traité de Zurich, qui pouvait être et qui devait être le point d'appui d'une restauration de l'ordre en Italie, ne pût même pas arrêter les empiétements révolutionnaires.
Les esprits confiants conservaient cependant un dernier espoir : ils croyaient qu'un congrès allait se réunir pour présider à la réorganisation de l'Italie, conformément aux stipulations de l'art. 19 du traité de Zurich. C'est alors (décembre 1859) que parut la fameuse brochure, intitulée : Le Pape et le Congrès, où l'on prétendait établir, au nom de la France, que si l'indépendance temporelle du Pape était nécessaire au libre exercice de son indépendance spirituelle, l'étendue du territoire pontifical n'avait par elle-même aucune importance. Par conséquent, le Piémont pouvait garder les Romagnes, en attendant mieux.
La réponse de Pie IX fut prompte et foudroyante. Le 1er janvier, il dit au général de Goyon, qui lui présentait officiellement, au nom de l'Empereur, les félicitations de l'armée française : "nous prions Dieu dans l'humilité de notre cœur, de vouloir bien faire descendre en abondance ses grâces et ses lumières sur le chef auguste de cette armée et de cette nation, afin que, par le secours de ces lumières, n puisse marcher sûrement dans sa voie difficile, et reconnaître encore la fausseté de certains principes qui ont été exprimés dans ces derniers jours, dans une brochure qu'on peut définir un monument insigne d'hypocrisie et un ignoble tissu de contradictions." Le Saint-Père disait de nouveau qu'il attendait de l'empereur la condamnation de la brochure ; il ajoutait : "nous en sommes d'autant plus convaincu que nous possédons quelques pièces qu'il y a quelque temps, Sa Majesté eut la bonté de nous faire tenir, et qui sont une véritable condamnation de ces principes."
La brochure ne fut pas condamnée. Loin de là, le 11 janvier 1860, Le Moniteur publia une lettre de l'Empereur au Pape. Dans cette lettre, datée du 31 décembre 1859, Napoléon III regrettait que Pie IX n'eut pas consenti, après la paix, à une séparation administrative des Romagnes, et concluait par cet avis comminatoire : "si le Saint-Père, pour le repos de l'Europe, renonçait à ces provinces qui, depuis cinquante ans, suscitent tant d'embarras à son gouvernement, et qu'en échange il demandât aux puissances de lui garantir la possession du reste, je ne doute pas du retour immédiat de l'ordre."
Cette lettre tranchait la question, et désormais l'unité italienne était faite sinon achevée. Du moment, en effet, où la France approuvait l'usurpation des Romagnes, le droit n'existait plus en Italie. Quelles barrières pouvaient maintenant arrêter le Piémont et la Révolution ! Une seule, le quadrilatère autrichien. Mais si cette barrière gênait le Piémont au Nord elle ne l'empêchait ni de garder les duchés, ni de conquérir Naples et les dernières provinces du Saint-Siège. Aussi M. de Cavour s'écriait-il un peu plus tard, dans un élan de joie et de reconnaissance : "la lettre de Napoléon III au Pape, proclamant que le règne du Pape sur les Romagnes est fini, nous a donné plus que nous n'avons obtenu à Palestro et à San-Martino..." (discours de M. de Cavour, 20 mai 1860). Sans doute, car les batailles contre l'Autriche n'avaient donné au Piémont que la Lombardie, et la lettre du 31 décembre lui livrait l'Italie.
Quant au Pape, sa réponse fut une nouvelle protestation contre les faits accomplis. Il déclara qu'il ne pouvait abdiquer son droit de souveraineté sur les Romagnes "sans violer des serments solennels, sans exciter des plaintes et des soulèvements dans le reste de ses États, sans faire tort à tous les catholiques, enfin, sans affaiblir les droits non-seulement des princes de l'Italie, qui avaient été injustement dépouillés de leurs domaines, mais encore de tous les princes de l'univers chrétien, qui ne pouvaient voir avec indifférence l'introduction de certains principes très pernicieux" (Encyclique du 19 janvier 1860).
Tandis que le Saint-Père faisait entendre cette nouvelle protestation, le cabinet de Turin consommait et prétendait régulariser l'annexion de l'Italie centrale. Il y eut un semblant de vote sous la direction des dictateurs piémontais. La duchesse récente de Parme fit justice de cette hypocrisie dans sa protestation. "C'est sous l'intimidation de la menace, dit-elle, sous la corruption de l'intrigue, sous la pression de la terreur ; c'est par suite des serments au roi Victor-Emmauuel qu'on avait imposés sous peine de destitution aux employés de toutes les branches d'administration ; c'est par suite du découragement général produit par neuf mois d'incertitude et de dangers effrayants qu'on a pu arracher à un grand nombre d'individus les manifestations d'un suffrage faussé par avance" (Protestation de Louise-Marie de Bourbon, régente des Etats de Parme, 28 mars 1860).
Le gouvernement français, bien que très tolérant pour le Piémont, n'entendait pas que celui-ci put faire l'Italie à son seul profit. Il lui rappela "que dès avant la guerre" on l'avait prévenu "que si les événements amenaient un grand royaume en Italie, nous demanderions que le versant des Alpes ne restât pas dans ses mains" (discours de M. de Persigny, 27 août 1860). C'était la revendication de Nice et de la Savoie. Le marché était trop avantageux pour que le Piémont pût l'oublier : il prit Parme, Modène, la Toscane, les Romagnes, fit son grand royaume et nous céda la Savoie et le petit comté de Nice.
Cet arrangement jeta de la poudre aux yeux du vulgaire, mais ne put couvrir près des hommes politiques et moins encore près des hommes de principe l'échec et le caractère vacillant de la politique française. Si la Sardaigne avait été contenue dans de sages limite – et surtout si la Confédération italienne avait été établie, l'annexion de Nice et de la Savoie à la France eut été un véritable avantage, un sérieux succès ; mais il n'en était pas ainsi. Que de sacrifices de tous genres nous faisions au contraire, pour obtenir ces deux provinces ! Nous permettions à l'allié impuissant qui nous devait la Lombardie, de s'annexer trois Etats entiers et une partie des États de l'Eglise ; nous laissions violer la convention de Villafranca et le traité de Zurich ; nous condamnions Venise à rester simple province autrichienne ; nous rendions impossible l'établissement d'une Confédération : nous mettions la Sardaigne en position de prendre toute l'Italie et de fonder un État unitaire et révolutionnaire menaçant pour nos intérêts ; enfin, malgré les engagements si solennels pris envers le Saint-Siège, nous autorisions le Piémont à garder les Romagnes. N'était-ce pas payer trop cher nos nouvelles acquisitions ? En somme, notre influence morale subissait une atteinte et notre puissance matérielle ne se trouvait pas agrandie — à beaucoup près — dans la proportion des devoirs que l'unité italienne, devenue inévitable, pouvait nous imposer dans l'avenir.
On disait alors, il est vrai, que si le Piémont s'agrandissait encore, nous nous agrandirions aussi. Si c'était un espoir ou un projet, nous l'ignorons ; mais à coup sûr, c'était une illusion. Le Piémont est devenu l'Italie et nos frontières n'out pas été reculées. Elles ne pouvaient pas l'être, dit-on, puisque l'Italie a terminé son unité sans nous.
Cette raison n'est pas valable. Le Piémont n'a pu prendre Naples, la Sicile, les Marches et l'Ombrie que par suite de la tolérance et de la protection dont nous n'avons cessé de le couvrir. Il ne comptait pas, en effet, sur l'appui direct ou indirect de la Prusse quand, en 1860, au lendemain de l'annexion de la Romagne et des duchés, il faisait envahir la Sicile, puis Naples par Garibaldi et chargeait Cialdini d'annexer de nouvelles provinces pontificales. Où puisait-il alors l'audace de braver l'Autriche, de violer le droit public européen, de porter de nouveaux coups à ce pouvoir temporel que nous promettions toujours de défendre ? Il la puisait dans le sens que le gouvernement français donnait au principe de non intervention, lequel se résumait à dire que le Piémont, dont les forces étaient très supérieures à celles de ses voisins, avait le droit de les attaquer, sans que personne eût le droit de les secourir. Et à ceux qui trouvaient l'argument vicieux, on répondait que l'armée française se chargerait de le faire valoir.
En suivant cette voie on devait aboutir à l'unité italienne. Nous y sommes. Ainsi sur cette question comme sur toutes celles que nous avons déjà examinées, le gouvernement impérial est arrivé à un résultat différent de celui qu'il s'était marqué. Il s'était promis d'établir une confédération soumise à l'influence française, et, dans tous les cas, impuissante contre nous ; il a fondé un État unitaire qui le gênerait fort si demain les cabinets de Florence et de Berlin faisaient alliance contre la France. Nous ne pouvons voir là ni la marque, ni les effets d'une politique réfléchie, ferme, heureuse, allant droit à son but et l'atteignant. »
Eugène Veuillot, « De la politique extérieure de la France, »
Le Catholique, 1er décembre 1866.
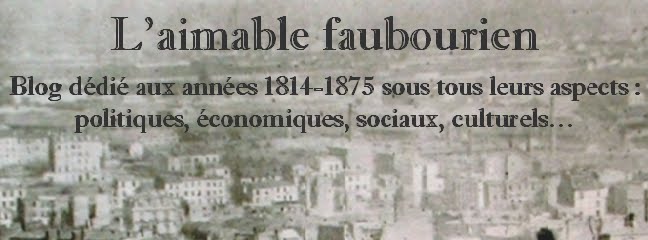




.JPG)
.JPG)

.jpg)











