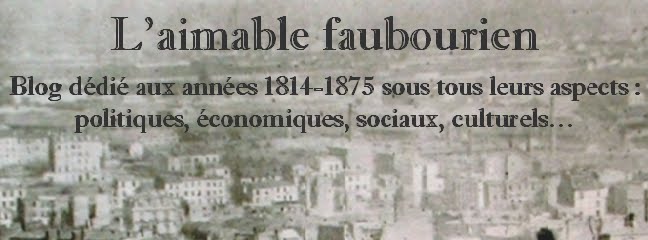Alexandre Martin Albert (1815-1895), dit "l'Ouvrier Albert", fils de cultivateur devenu ouvrier mécanicien, il rejoint sous la Monarchie de Juillet diverses sociétés secrètes, avant de fonder avec d'autres ouvriers le journal L'Atelier. Pour Daniel Stern (pseud. de la Comtesse Marie d'Agoult), "la nomination d'un ouvrier au gouvernement provisoire est un fait historique dont il ne faut pas méconnaître le sens et le caractère. Elle est le signe de l'émancipation, aveugle encore, mais désormais assurée de la classe laborieuse ; elle marque l'heure du passage de la révolution politique à la révolution sociale." (Histoire de la révolution de 1848, vol. 1, 1851).
« Les Tuileries prises, le roi parti, La Réforme et Le National sentirent la nécessité d'un rapprochement immédiat. Il n'y avait pas une minute à perdre en vaines querelles. La Chambre pouvait se remettre de sa stupeur. Le peuple lui-même n'attendrait pas longtemps qu'on lui offrît un gouvernement. […] Les haines étaient vives entre ces deux journaux. La compétition du pouvoir ne semblait pas de nature à les ramener à des sentiments de conciliation. De part et d'autre on avait formé un comité en permanence. Depuis plusieurs heures, ces deux comités rivaux recrutaient les notabilités de leur faction. Au National se tenaient MM. Emmanuel Arago, Marrast, Martin (de Strasbourg), Sarrans, Dornès, Recurt, Vaulabelle, etc. A La Réforme MM. Beaune, Flocon, Gervais (de Caen), Cahaigne, et vingt autres discutaient sans arriver à une conclusion. […] Des deux parts, on dressait des listes de gouvernement provisoire. Mais si l'on parvenait à se rencontrer sur quelques illustrations qu'un mérite spécial et qu'une gloire extra-politique plaçaient dans une sorte de neutralité ; il n'en était pas ainsi des autres. On acceptait M. Lamartine comme poète, M. Arago comme astronome, M. Dupont (de l'Eure) comme honnête homme et comme octogénaire. Mais M. Marrast ne voulait pas entendre parler de M. Ledru-Rollin. M. Flocon avait M. Garnier-Pagès en horreur, et M. Marie frémissait à l'idée de partager le pouvoir avec le communiste Louis Blanc. […]
L'impossibilité de s'entendre amena purement et simplement un partage du pouvoir. Ce fut une conclusion fatale, inévitable. Il en résulta plus tard dans le gouvernement provisoire un manque d'homogénéité, qui devint pour la seconde République la source de tant de maux. La patrie en saigne encore et les larmes en couleront longtemps ! […]
On parvint enfin à s'entendre sur une liste ainsi conçue : "Dupont (de l'Eure), François Arago, Ledru-Rollin, Flocon, Marie, Armand Marrast, Crémieux, Garnier-Pagès, Lamartine, Louis Blanc." Ce dernier alla aussitôt lire la liste à la foule de combattants qui se pressaient dans la cour de l'hôtel. De rauques acclamations l'accueillirent. Pourquoi applaudissaient-ils ? Sans doute parce qu'applaudir est un besoin des masses, un prurit qui se déclare à la paume des mains de l'homme-multitude aussitôt qu'un homme-individu se place en face de lui et parle. Cette liste éclectique ne méritait certainement pas l'approbation du peuple. La science, le talent et la vertu s'y trouvaient réunis. Il y manquait l'unité. L'impéritie gouvernementale devait résulter de cette impuissante mixture de noms si diversement nuancés. Cela ressemblait trop à un dépècement du pouvoir par des ambitions secondaires. On ne sentait là personne qui eût le nerf d'un Cromwell ou d'un Robespierre, qui dût absorber les individualités inférieures et imprimer au gouvernement de la République une forte impulsion.
Les combattants pressés dans la cour eurent peut-être une vague perception de ce partage de la proie gouvernementale, car la pensée de s'en attribuer une part leur vint à l'esprit. Il fallait pour cela qu'un des leurs fût promu au rang des futurs dictateurs. La lecture de la liste était à peine achevée qu'un nom volait de bouche en bouche : "Albert ! Albert !" s'écriait-on. Lorsque ce nom arriva dans la salle de la rédaction, où se trouvaient de nombreux ouvriers, le cri de "Vive Albert !" retentit et consacra sa nomination. Un ouvrier allait prendre place au gouvernement d'une des premières nations du monde.
M. Albert était-il donc un de ces génies inconnus que les révolutions font soudain sortir de la foule ? En aucune façon. Ouvrier mécanicien, appartenant d'ailleurs à une famille aisée, M. Albert ne se distinguait par aucune de ces hautes et rares qualités qui désignent un homme aux fonctions gouvernementales. Sa notoriété ne s'étendait pas au delà des régions dans lesquelles s'écoulait sa vie. Depuis longtemps affilié aux sociétés secrètes, il avait pris part, dans les derniers temps du règne de Louis-Philippe, à la direction des Saisons. Hâtons-nous d'ajouter que M. Albert était estimé de tous à cause de la pureté de son caractère, de sa bravoure, de son dévouement à la cause républicaine. Il faut que ces nobles qualités aient été bien incontestables chez lui pour qu'aucun des agents secrets qui ont infecté la presse de dégoûtantes calomnies n'ait osé touchera cette simple et honnête figure.
Il est à regretter, au point de vue démocratique, que M. Albert n'ait pas été doué de facultés éminentes. Il eût donné à sa nomination une portée considérable qu'elle n'avait pas en réalité. Examinée de bonne foi, la nomination de M. Albert au gouvernement provisoire de la République française atteste bien plutôt la puissance des sociétés secrètes, que la volonté déterminée chez le peuple de se gouverner lui-même et d'arriver à une répartition plus rigoureuse, plus exacte de l'autorité. L'ouvrier des sociétés secrètes est un homme déclassé. Il n'appartient plus en réalité au travail ; il appartient à la politique. La nomination de M. Albert, dans la cour et dans les bureaux de La Réforme, par une foule d'hommes auxquels il avait commandé dans les sections, n'a pas d'autre sens que l'hommage rendu à un bon chef par ses soldats. Pour que cette élection eût pris le caractère que les hommes du parti avancé cherchèrent à lui donner, il eût fallu, au lieu de M. Albert, voir surgir quelque ouvrier connu de tous, désigné par l'acclamation générale des légions du travail, ou plutôt par une sorte de sentiment public. Il n'en existait pas de tel.
La nomination de M. Albert eut donc plutôt l'air d'une flatterie à l'adresse du peuple, qu'un fait de la volonté du peuple lui-même. Que ce soit là un signe considérable dans l'histoire d'une nation, quoiqu'il soit permis d'en relever l'importance, on ne saurait sans exagération lui donner un caractère de réforme sociale. Après tant de sottises perpétrées au soleil, quiconque a conservé des convictions démocratiques, est sommé, sous peine de mort éternelle, de déposer la dernière de ses illusions. M. Albert justifia d'ailleurs les réserves que l'histoire enregistre aujourd'hui par une inaction et un effacement absolus. Paris se demanda longtemps quel était cet Albert, ouvrier, en qui l'humble artisan et le penseur fondaient une secrète espérance. L'artisan se disait que les bienfaits du pouvoir allaient descendre, sous forme de lois généreuses, jusque dans son humble logis. Le penseur entrevoyait déjà l'aurore d'une grande évolution de l'esprit humain, le dernier cadre des classifications rompu, la naissance d'une société en participation collective, que sais-je ? La vertu, le mérite personnel, débarrassés de toute entrave et devenant la vraie, l'unique distinction entre les hommes. Quelque disciple d'Emerson y vit peut-être l'aurore du gouvernement des héros. Le nom de M. Albert a été un grand leurre. »
Hyppolite Castille, Histoire de la Seconde République en France,
vol 1, Paris, Victor Lecou éd., 1854.
vol 1, Paris, Victor Lecou éd., 1854.
__________________
« LE CITOYEN ALBERT , OUVRIER ( SANS PORTEFEUILLE),
(C'est un Montagnard qui parle à un Conservateur.)
Quand je vous dis qu'Albert est habile ouvrier,
Dans quel art ? dites-vous d'un air mi-sardonique
Que je ne veux qualifier.
Apprenez qu'aujourd'hui l'art n'est plus qu'un métier
Nous fondons une République
Où doivent régner seuls les talents, les vertus,
Et ce n'est que dans la boutique,
Parmi ces hommes aux bras nus,
Qu'on trouve ces Romains, nouveaux Cincinnatus,
Sortant de l'atelier ou quittant leurs chaumières
Pour détrôner les rois et punir les tyrans ;
Ou , s'il le faut, sortant des derniers rangs ,
Baïonnettes intelligentes
Qui n'ont besoin de vieillir sous les lentes,
Pour être aussi bons chefs qu'intrépides guerriers ;
Puis, retournant dans leurs humbles foyers,
Y trouvent leurs femmes et filles ,
Filant le lin , lissant leurs vêtements grossiers ,
Et leur tenant tout chaud le potage aux lentilles.
Ah ! vous pensez, bourgeois et riches corrompus,
Modernes Lucullus, Crassus, Apicius,
Bravant la frugale Montagne,
Siège des grands et nobles cœurs,
Vous pensez, de ce peuple adroits explorateurs,
Vous abreuver toujours de ses sueurs
Où vous semblez trouver le bouquet du Champagne,
Sans jamais vous désaltérer !
Mais le temps est venu de vous régénérer.
C'est à son tour à faire un peu cocagne.
Cédez-lui donc la place en payant son écot,
N'oubliant que le pain tout seul est chose fade,
Qu'il attendit assez la grasse poule au pot
Et ne boit jamais qu'à rasade.
Sinon, le triangle d'acier
Pourrait bientôt reprendre son office,
Machine régénératrice
Qui dort depuis la fin du grand siècle dernier
Et finirait par se rouiller.
J’entends, le mot est dur et vous fait sourciller.
Prétendez-vous du peuple entraver la justice ?
Quand on fonde un nouveau sur un vieil édifice,
Ne faut-il pas d'abord qu'on démolisse ?
C'est là tout l'art des modernes maçons.
Entendez-les déjà crier avec courage :
Frères, amis, mettons-nous à l'ouvrage.
Démolissons, démolissons.
Pour reconstruire après, manquons-nous d'architecte ?
Eh bien ! Albert est là : suffit.
Sa force au moins n'est pas suspecte.
Quel besoin a-t-il donc d'études et d'esprit,
De savoir même ce qu'il dit ?
Quand on sait, les bras nus, s'il faut, jusqu'à l'aisselle,
Manier le marteau, la scie ou la truelle,
Quel conservateur insolent,
Regrettant l'état monarchique,
Oserait bien lui nier le talent
De gouverner la République ? »
Charles-Louis Rey (pseud. Géronte cadet), Poésies diverses,
Nîmes, chez les principaux libraires, 1852.