"La République est proclamée !",
aquarelle de Pierre-Eugène Lacoste, 1848.
« Après le grand coup que Dieu vient de frapper, et qui a bouleversé un puissant Etat contre toute prévision, quand les conseils d'un roi renommé par son adresse et sa prévoyance ont été subitement aveuglés, lorsqu'une sanglante catastrophe, tout paraissant apaisé et la royauté rassise, a fait recommencer une lutte implacable, et qu'en moins de douze heures le pouvoir royal a été renversé, il serait insensé à l'homme de prétendre préparer l'avenir dans sa pensée, et de dire : Voilà ce qui sera ! Dieu ! que faites-vous là-haut, vous qui par des traits si inattendus, si invisibles, par cette volonté dont nous ne connaissons que les effets, abatte ? ce qui semblait le plus profondément enfoncé dans la terre, qui chassez les rois, poussez quelques hommes de la foule à la puissance, et, inaltérable, laissez tout dans le trouble et l'attente ! Mon Dieu ! que nous sommes petits, et que vous êtes grand !
La France vivait dans la torpeur ; le monde, inquiet, s'étonnait. Quoi donc ! se disaient les nations, ce gouvernement corrupteur a-t-il été si fort que non-seulement il ail dompté ceux qui l'approchaient et le servaient, mais encore qu'il ait abattu et endormi ce peuple généreux chez qui plus rien ne bouge, pas un cri, pas un souffle ! Les jours de la France sont-ils finis ? Mais non ; tout d'un coup, et sans que personne s'y attende, ce peuple abaissé se relève, et il se trouve uni. Tous se regardent; on crie : Marchons ! plus de corruption ! plus de rois ! Les bras ont fait voler les voilures en éclats, déraciné les pavés, coupé les grands arbres, arraché les barreaux de fer. Ce peuple était le même qu'il y a cinquante ans, aussi spontané, aussi indigné, aussi vivant : il était libre !
Le roi Louis-Philippe a été chassé en trois jours comme le roi Charles X ; mais tous deux n'ont point eu la même condition dans leurs départs. L'un fut reconduit par des députés qui escortèrent sa majesté tombée ; il sortit dans un appareil encore royal : c'était là le dernier acte d'une grande et noble tragédie. L'autre s'est enfui précipitamment de son palais, sans adieux, sans guides ; il s'est dérobé au milieu de l'émeute populaire rugissante : ça a été la première scène d'un drame qui s'est ouvert par de violentes colères, de fiévreuses convulsions, et qui nous fait attendre des péripéties inaccoutumées.
Il est accompli à demi ce vœu d'un ouvrier du Midi : Mon Dieu ! faites donc tomber un jour de poudre et une heure de feu, et que tout soit dit ! Tout n'est pas dit ; nous sommes trop près encore du choc qui nous a éblouis : tout à l'heure nous commencerons à en ressentir les premiers effets. Mais, dès aujourd'hui, ce que nous pouvons, ce que nous devons, c'est, examinant les événements d'après les passions immortelles de l'homme, écoutant cette immense rumeur populaire qui nous enveloppe, et demandant à la Providence de nous donner la bonne volonté et la foi, c'est de convoquer tous les esprits à l'union, de calmer les agitations emportées, de parler aux gouvernants de leurs obligations, aux peuples de leurs devoirs, et d'apporter à tous les conseils que nous dictent notre patriotisme et notre conscience. Nous ne nous occupons pas de plaire, mais de servir. Les conseils utiles, comme le dit Massillon, sont rarement des conseils agréables.
En un jour, en une soirée, la royauté a été abolie, un gouvernement provisoire a été institué, la République proclamée. Des hommes, presque tous connus et admirés de la nation à différents titres, ont été chargés des destinées du moment, de détruire et de conserver, de fonder et de préparer. En peu de jours, pressés par des exigences précipitées et incessantes, ils ont accumulé des actes marqués au coin de la sagesse et de la modération ; et cependant l'opinion publique, avide, inquiète, se disperse en mille bruits opposés ; on attend les choses les plus contraires : on craint la tempête, on espère le soleil.
Il n'est qu'un seul besoin, il ne doit y avoir qu'une seule pensée : l'unité ! Et c'est pour cela que nous venons ici chercher ce qu'il y a de vrai dans les craintes et les espérances, assurés d'avance que les craintes sont presque toutes vaines, que les espérances auront leur réalité, et qu'il suffira de montrer la vérité pour que les faibles se raffermissent, pour que les forts persistent, et que tous s'écrient d'un même élan : nous avons voulu devenir libres, et nous mériterons de l'être par notre commune volonté !
Détruisons les craintes d'abord ; nous serons plus à l'aise pour exprimer nos espérances.
Il peut y avoir trois sortes de craintes : les craintes immédiates, celles qui surviendraient peu à peu, et celles qui tiennent au fond même de notre caractère et de notre situation morale.
Ce que certaines gens redoutent, et ce qui n'est point à redouter, c'est le manque d'argent et la détresse du commerce, l'influence des partis contraires, les mines souterraines des communistes, la ressemblance avec 93, la guerre générale, un despotisme militaire, enfin l'abus de la force du peuple armé.
L'argent ne manque pas et ne manquera pas ; un trésor considérable est entre les mains du gouvernement ; des besoins imprévus ont forcé de faire des dépenses inopinées, mais passagères ; les distributions de pain cesseront à mesure que les grands travaux commencés diminueront la masse des nécessiteux. La garde nationale mobile est chèrement payée, il est vrai ; mais la réduction de l'armée établira une compensation, si même elle ne donne un bénéfice. Par une sagesse remarquable, aucun impôt considérable n'a été aboli, d'abord parce que le gouvernement n'en a pas le droit, puis parce qu'il devait faire face aux dépenses. La République nouvelle n'a pas, comme le Consulat, trouvé tout désorganisé ; ici, au contraire, tout est organisé. Elle n'est pas, comme la monarchie de Juillet en 1830, sans soldats, sans finances, quand l'Europe entière semblait vouloir nous déclarer la guerre, et qu'il fallait tout de suite créer une armée ; et pourtant alors nous nous en sommes tirés ; les gens de bourse furent émus un moment, puis tout reprit son cours accoutumé. Aujourd'hui les services sont assurés, les administrations fonctionnent, aucun trouble n'a détruit une seule ressource ; jamais révolution n'a été dans de meilleures conditions.
Le commerce ne souffrira pas davantage ; on n'a point vu, ainsi qu'en 1830, émigrer rapidement les étrangers, les riches, les nobles ; ils abandonnaient la cité parce qu'ils avaient la peur du peuple et la haine du nouveau gouvernement. Rien de semblable en ces jours-ci. La conduite du peuple a été si héroïque et si calme à la fois que, loin d'en avoir peur, on l'admire ; la République a été accueillie par un parti riche et nombreux avec une faveur d'acclamation ; les étrangers rassurés ne sont pas partis ; bien plus, ces nobles et ces riches ont compris le devoir que les circonstances leur imposent : c'est d'en haut qu'il faut que vienne l'exemple de la confiance. Déjà des fêtes dans le faubourg Saint-Germain sont annoncées ; on cite les jours choisis par les grandes maisons ; avec les fêtes, le mouvement, les achats, les échanges, le commerce. On est calme, on est content, et l'on veut le prouver à tous.
Quand on dit que les légitimistes sont contents, il faut entendre qu'ils le sont surtout du renversement de Louis-Philippe : ils se réjouissent de voir un trompeur trompé ; pourtant, dès qu'ils ont su que la République garantissait l'ordre et la propriété, ils ont les premiers applaudi à l'établissement d'un gouvernement sage, fort et modéré : ce n'est pas eux pour le moment que la République aurait à regarder comme ses ennemis.
Des hommes qui ne finissent pas, mais qui commencent, ce sont les communistes et les socialistes. Il a existé, en ces dernières années, un homme qui a cru avoir trouvé le mot d'une civilisation inconnue et infinie, qui a donné le principe d'une association universelle, qui en a établi les rapports, les conditions et les conséquences. Dans son vaste cerveau, le monde a été constitué en ses moindres détails ; il a touché à tout : le gouvernement, la religion, la famille, il a tout brisé en mille pièces, et, prenant l'inverse de ce qui existait, il a étendu sur l'univers l'immense et complet réseau de la société universelle. Rien n'en a été distrait; chaque homme y a eu sa place, chaque action du jour son moment, chaque vie son but. La société a été montée comme une grande machine dont tous les mouvements sont prévus, et l'homme a pu entrevoir dans l'avenir, définie et marquée en chiffres mathématiques, invariables, la réalisation de l'existence éternelle de l'humanité.
Mais orgueil et aveuglement insensé ! Pour faire cette œuvre qui traçait à l'homme sa destinée dans les siècles, le génie de Fourier a été obligé de méconnaître la moitié de l'homme ; il a ouvert une route profonde, et l'homme devait y marcher jusqu'à la fin, sans pouvoir en dévier ; il était poussé au but sur des rails de fer : c'est en prison qu'il était emporté vers le bonheur. Pour tenter ce que Dieu fait par sa seule volonté, Fourier avait pris la plus rude barre de fer des tyrans, il avait enlevé à l'homme sa liberté.
Pourtant aucune utopie n'est complètement inutile ; il est resté de cet immense rêve une idée juste et féconde, l'association, et elle est juste parce qu'elle est la première application du plus grand principe qui ait jamais été proclamé sur la terre, la fraternité, ou, pour dire le mot du Christ, la charité, l'amour ! S'associer, c'est pratiquer l'Evangile.
Les communistes ne sont que l'exagération de l'école socialiste ; ils ont poussé les conséquences à l'extrême, mais aussi leurs moyens, sont de la rigueur la plus absolue. Ici, plus de liberté, plus de volonté ; tout pour la commune, rien pour soi. Il n'est permis à personne de demeurer oisif; vous ne travaillez pas, vous êtes puni ; vous êtes sûr de manger, mais vous êtes attaché. C'est l'histoire du chien gras qui porte au cou les traces de son collier ; le loup préfère rester maigre et libre. Le peuple est comme le loup, il veut rester libre. On a fait grand bruit du communisme ; il est moins étendu qu'on ne l'a dit : il n'y a de communistes, et encore en petit nombre, que dans les grandes villes et à Paris. Aux journées de février, ils n'avaient qu'une barricade sur huit mille. La province ne les connaît pas et n'en veut pas ; en supposant qu'ils tentassent un mouvement, pense-t-on qu'elles resteraient tranquilles, toutes ces villes où les petits bourgeois, les maîtres-ouvriers, presque tous les artisans, sont propriétaires d'un pré, d'une vigne ou d'un coin de terre ? Moins on possède, plus on tient à sa propriété. "J'ai remarqué, disait Pascal, que, quelque pauvre que l'on soit, on laissait toujours un héritage." Et chacun veut laisser un héritage. La propriété est le droit naturel. Je comprendrais que l'on eût des craintes en Angleterre, où vingt-cinq mille privilégiés possèdent le sol ; mais en France, où nous avons six millions de propriétaires, ce sont six millions de soldats contre les communistes. Avec une telle armée passionnée de son intérêt, je n'ai point peur des communistes.
Le renouvellement de la Terreur n'est pas davantage à craindre : il faudrait que ce fût le pouvoir ou le peuple qui la fît, et le pouvoir, par ses actes, prouve qu'il ne le veut pas ; le peuple, par ses idées, ne le peut pas. Le gouvernement a tout d'abord proclamé ses nobles intentions en abolissant la peine de mort pour crimes politiques, et cette décision, l'Assemblée nationale non-seulement la confirmera, mais la complétera ; elle abolira la peine de mort dans tous les cas, nous l'espérons, nous le croyons. Quant au peuple, le peuple de 1848 n'est pas celui de 93. Si nous voulons égaler notre première révolution, comprenons-la ! Le peuple n'a aucune des conditions de la Révolution : ni l'abaissement inouï, ni l'inégalité en tout établie, ni des misères invengées, ni une lutte indispensable contre une caste maîtresse absolue, ni des fureurs amassées pendant des siècles. D'autres idées, d'autres besoins le poussent, et ce sont des idées nouvelles. Les opinions vieillies ont du penchant à assurer leur domination par le sang ; les jeunes idées sont généreuses, confiantes, libérales ; elles ne veulent pas la violence ; nées au matin, elles ont l'avenir; elles se présentent le front serein, l'œil bleu, l'air souriant ; elles semblent dire : Venez à moi ; elles appellent l'amour, et on vient à elles.
Nous ne demandons pas la guerre : nous savons ce qu'elle entraîne de misères, même heureuse; nous n'attaquerons pas l'Europe. "Hier nous disions à l'Europe, s'est écrié avec éloquence un des membres du gouvernement, Marrast, laissez-nous en paix, et nous serons sages ! Aujourd'hui nous dirons : nous resterons en paix si vous êtes sages !" La guerre pourtant est inévitable peut-être ; peut-être pour les deux nationalités de Pologne et d'Italie, descendrons-nous de l'autre côté des Alpes et du Rhin. Mais sans parler ici, NOUS le dirons plus loin, du rôle magnifique et de la mission divine que la France aura alors u remplir vis-à-vis des autres nations, en ce qui nous regarde, loin que la guerre doive nous faire peur, elle nous sera utile, elle nous sauvera peut-être! Nous avons besoin de mouvement; à l'activité humaine il faut des efforts proportionnés à son énergie : ou des luttes contre la nature, comme la jeune Amérique empiétant sans cesse sur ses forêts immenses et domptant les géants, fils de la terre, ou des combats de l'homme contre l'homme. Nous ne sommes pas un peuple à tomber dans l'apathie, nous sommes un peuple ardent ; si nous restions chez nous, dans le lièvre qui nous agite, inoccupés, peut-être descendrions-nous dans la rue et ferions-nous des guerres civiles. Pas de guerre, si nous ne sommes pas attaqués ; mais qu'elle vienne, chacun trouvera la place à son impatience et à sa flamme ; le gouvernement sera facile : nous aurons la gloire avec la liberté !
Mais si cette gloire nous valait un despote militaire ! Non ! nous ne sommes pas en Prusse, pour croire qu'un homme en uniforme est autre qu'un homme en habit de bourgeois ; nous avons eu un despote militaire, c'est assez : le prestige est tombé ; il serait singulier, quand on ne croit plus à la couronne, qu'on crût à l'épée. Aujourd'hui un général n'est rien s'il n'est que général. Ceux-là seuls qui aient eu une valeur réelle, Foy, Lamarque, etc., n'avaient de militaire que le nom ; le laurier de leur gloire, ils l'avaient fait refleurir à la chaude atmosphère des assemblées publiques ; ils n'étaient grands que parce qu'ils étaient de grands citoyens !
Enfin, quelques-uns voudraient nous présenter le peuple armé comme un épouvantail ; ces hommes en blouse qui portent un fusil, cette foule qui possède un sabre ou une baïonnette enlevé dans la bataille, ces canons de l'Hôtel-de-Ville gardés par des enfants effrayent des esprits timides. Leur épouvante vient de leur ignorance ; ils ne connaissent pas le peuple, ils ne l'ont vu sans doute ni dans les barricades, ni le lendemain de la victoire. Aux barricades le peuple était impatient d'ardeur, prêt à braver mille morts, et, en même temps, généreux, confiant; il appelait des conseils, il choisissait pour chef tout homme qui semblait combiner et penser. Il ne s'abusait pas ; il avait la candeur, cette vertu de l'enfance. Toutes les forces bouillonnaient en son âme, et il ne savait comment les employer ; il se sentait le bras, il demandait la tête.
Après le combat, quand le sang fumait encore et que la rumeur de sa colère grondait dans l'air, le voilà tout à coup changé ; il est maître, il est fort : il veut l'ordre ; aussitôt lui-même il fait sa police ; il arrête le pillage, il saisit les voleurs et en fait justice ; il n'est plus armé comme peuple, il l'est comme gardien de la propriété nationale et de la paix.
Un crucifix est enlevé des Tuileries, et ces hommes, ivres de la bataille, découvrent leur front et font au Maître de tous un cortège imposant et recueilli ; ils sentaient sans doute que ce n'étaient pas eux qui avaient vaincu, que rien n'avait été fait d'après un plan et par une volonté humaine. Cette révolution si soudaine, si imprévue, presque impossible, elle avait été menée comme les bouleversements de la terre. Un craquement s'était fait entendre : les uns avaient été jetés à droite, les autres à gauche, les rois poussés à un lointain rivage, le peuple apporté comme un flot jusqu'au pied du trône. C'était un déluge ; où se trouvaient les terres s'étendait l'Océan, et la grande main de Dieu planait sur le monde.
C'est qu'il faut le dire, nous parlerons plus loin des défauts du peuple, ici il ne s'agit que de ses vertus; de toutes les parties de la nation française, le peuple est celle où le sentiment religieux est le plus vivant. Les hautes classes étaient religieuses par politique ou par souvenir, un petit nombre par une grande science. Le pouvoir et ceux qui dirigeaient l'opinion, orateurs, publicistes, professeurs, défendaient la religion dans leurs discours, parce qu'ils savaient par principe qu'elle était nécessaire. Ils entrevoyaient ce qui devait résulter de la liberté sans contrepoids, et ils mettaient en avant la religion pour que les esprits fussent frappés du prestige d'un pouvoir qui est au-dessus de l'homme ; mais ce n'était qu'une affectation. On parlait plus du Christianisme au Parlement et dans les feuilles publiques qu'au temps de Louis XIV, parce que, sous Louis XIV, les gouvernants pratiquaient le culte, et que les nôtres le dédaignaient. Quant à la classe moyenne, n'ayant pas l'instruction des hautes classes, les idées d'irréligion du XVIIIe siècle étaient passées chez elle à l'état de préjugé ; elle n'avait senti le besoin de s'élever vers Dieu ni par la gratitude, ni par la souffrance ; elle se réglait d'après une morale facile, qui n'était ni la vie, ni la vertu, et, assise dans une confiance ignorante, se fortifiant dans son isolement et son égoïsme, elle se riait de la loi de charité et de fraternité humaine, sans prévoir que cette loi est la seule force qui empêche la société de s'écrouler et de se disperser en mille débris.
Mais le peuple est religieux par instinct, parce qu'il souffre, parce qu'il attend, parce qu'il espère ; il invoque Dieu, il parle à Dieu, il croit en Dieu, comme il aspire l'air, comme il se réchauffe au soleil. Le sentiment de la religion tient au sentiment de la dignité humaine; un esclave peut être superstitieux, un peuple libre seul est religieux. Aussi, dès qu'il a été appelé à agir, le peuple s'est montré ce qu'il était naturellement, pénétré de l'instinct de l'ordre et de la majesté des assemblées. Lorsqu'on a convoqué ses délégués pour traiter de ses intérêts les plus pressants, on a vu ces ouvriers, rudes manieurs du bois et du fer, venir s'asseoir avec calme sur les fauteuils occupés hier par les chefs de l'aristocratie de la France, et, modérés dans une puissance survenue sans préparation, présenter fermement leurs prétentions, écouter en silence les réponses et les difficultés, discuter sans emportement, proposer et arrêter des mesures de conciliation, des arrangements de moyen terme dont on eût pu croire que le peuple était incapable d'apprécier la délicate prévoyance. Presque au même moment les littérateurs et les artistes se réunissaient pour de médiocres questions de présidence et de comité, et l'assemblée des ouvriers l'emportait sur ces hérauts de l'intelligence, en réserve, en convenance, en sagesse et en dignité. On a fait appel à l'honneur du peuple, et l'on a eu raison. Toutes les fois que l'on aura confiance en lui, il sera capable de tout.
Les craintes immédiates sont donc fausses ; il peut y avoir quelque doute sur celles qu'inspirent les événements qui vont se succéder.
On pourrait redouter que le gouvernement, ne persistant pas dans la voie prudente qu'il a tenue, ne fût poussé à des mesures violentes ; puis que, l'Assemblée nationale ne soit influencée par des passions excessives de timidité, de peur, d'emportement ou d'intérêt.
Jusqu'ici le gouvernement a été soutenu par l'opinion ; on a foi surtout dans quelques hommes d'un éminent talent et d'un beau caractère ; les mesures que le gouvernement a prises ont été marquées d'une fermeté modérée et contenue. Il n'a pas détruit ; il n'a repoussé des fonctions publiques qu'un petit nombre d'hommes. Il a ménagé habilement, sans jactance ni faiblesse, les partis et les classes ; un seul décret, l'abolition des titres de noblesse a excité des réclamations : cet acte est peu important d'ailleurs, et le patriotisme éclairé du gouvernement, son dévouement infatigable à la chose publique, son langage calme et élevé tout ensemble, cette modération qui est venue à des hommes impétueux dès qu'ils ont eu appris les difficultés du pouvoir, sont des marques assez rassurantes de la bonne foi de ses intentions et de la persistance de ses efforts ; le présent fait compter sur l'avenir. »
Eugène Loudun (pseudonyme d'Eugène Balleyguier, 1818-1898),
« Du présent et de l’avenir de la révolution ». Le Correspondant, t. XXI, 10 mars 1848.
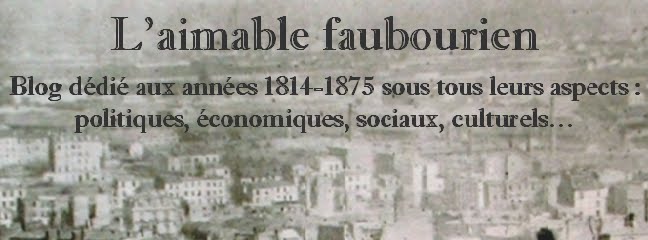




.JPG)












