 |
Journée du 6 avril 1871 : à Paris, la guillotine est brûlée au pied de la statue de Voltaire, inaugurée en août 1870 (dessin paru dans : Paris insurgé, histoire illustrée des événements accomplis du 18 mars au 28 mai 1871, Paris, 1872).
« Le 6 avril, vers neuf heures, le rappel battait dans une partie du 11e arrondissement, et bientôt le 137e bataillon prenait position sur la place Voltaire. Après quelques instants d'attente, le public que cette réunion avait attiré, voyait les rangs de la garde nationale livrer passage à quelques hommes accompagnés d'une escouade de gardes nationaux. Ils déposèrent, au centre de l'espace laissé vide, de fortes charpentes, des cordes, des engins divers et une épaisse lame d'acier sur laquelle les regards ne s'arrêtaient pas sans une émotion pénible : c'étaient les différentes pièces composant l'échafaud destiné aux exécutions capitales, ou, pour employer les termes officiels, les bois de justice.
Par une inspiration attestant dans la population parisienne un profond sentiment du progrès et de l'adoucissement des mœurs qui caractérisent la civilisation de notre temps, un grand nombre de citoyens du 11e arrondissement s'étaient rendus rue Folie-Méricourt, au lieu de dépôt de l'instrument de supplice, et s'étaient emparés des charpentes, afin d'en faire, au pied même de la statue de Voltaire, une auto-da-fé auquel applaudirent tous les vrais partisans du Progrès. Le premier acte de la République de 1848 avait été de prononcer l'abolition de la peine de mort; les républicains de 1871 ont voulu reprendre cette idée et lui donner en quelque sorte une sanction matérielle, en brûlant l'échafaud publiquement, au grand jour.
Quand on vit les flammes s'emparer des sinistres charpentes, des applaudissements et des cris de Vive la République ! ont éclaté de toute part; on suivait l'œuvre de destruction avec une sorte d'empressement attentif, et plusieurs femmes qui étaient présentes s'approchaient du foyer pour saisir quelque charbon à demi éteint, afin de conserver un témoignage matériel de cette éclatante protestation contre la peine de mort.
Puisse cette hideuse guillotine, que le peuple vient de brûler, ne jamais se relever sur nos places publiques. »
H. Ayraud-Degeorge, Le Petit National, 8 avril 1871.
_____________________
« Ce matin, jeudi, un spectacle des plus insolites avait attiré une foule considérable vers le boulevard Voltaire (ci-devant du Prince-Eugène.) On brûlait publiquement, sur la place et devant la statue de Voltaire, le bois de justice, autrement dit l’échafaud, ou, puisqu’il faut l’appeler par son nom, la guillotine.
Le public qui assistait à cet auto-da-fé de l’instrument du supplice paraissait satisfait. Cela se comprend à merveille, si l’on veut voir dans cet incendie la fin des homicides judiciaires et des condamnations capitales. Si ce spectacle est un symbole, nous en ferons honneur à ceux qui l’ont ordonné. Oui, à la condition qu’il signifie abolition de la peine de mort et inviolabilité de la vie humaine, nous y applaudissons de toute notre âme.
Mais si ce n’était par hasard que la suppression d’un appareil démodé, la mise au rebut d’un engin trop encombrant, trop diffamé, trop malpropre ; si l’on proscrivait simplement la guillotine, comme jadis le bûcher, la roue, la corde et l’estrapade, tout en laissant subsister l’œuvre ou plutôt les hautes œuvres de ces instruments de mort ; si, en un mot, cela n’indiquait qu’un changement de procédé ou de méthode, où seraient alors la conquête de la civilisation et le progrès de l’humanité ?
Et véritablement, s’il ne s’agissait que de destituer Guillotin pour employer Chassepot, qui va vite en besogne ; si enfin on jouait du fusil sans renoncer à la lanterne, à quoi bon alors se priver de la guillotine ? On n’aurait obtenu qu’un progrès en arrière et dans le sens de la destruction humaine, comme le jour où l’arbalète disparut devant l’arquebuse. Si, en brûlant l’échafaud, on n’avait fait que supprimer le signe en nous laissant la chose, ce serait là un lugubre, enfantillage et rien de plus. Et nous ne verrions pas la différence qu’il y aurait entre mettre le feu à la guillotine ou à un kiosque du boulevard, si ce n’est que l’échafaud appartient à l’État et coûte beaucoup plus cher.
Voilà pourquoi, ne pouvant considérer la manifestation de ce matin comme une sinistre puérilité, nous l’enregistrons comme un indice de l’apaisement des haines et de la fin de nos guerres fratricides. »
Le Siècle, n° 14025, vendredi 7 avril 1871.
______________________
« Hier, à dix heures du matin, le peuple a brûlé l’échafaud sur le boulevard Voltaire. L’idée était bonne et le boulevard bien choisi. Mais à quoi bon, je le demande, cet auto-da-fé accompli sur le bois de justice, si, en détruisant l’échafaud, nous conservons la peine capitale, avec cette seule nuance que la guillotine est remplacée par le chassepot ?
Les Français sont décidément des êtres surprenants. Ils sont tous d’accord pour proclamer l’inviolabilité de la vie humaine, mais cette inviolabilité consiste à déclarer qu’aucun individu, à quelque sexe qu’il appartienne, et quelque crime qu’il ait commis, ne sera désormais appelé à grimper les degrés de la fatale machine qui a emprunté son nom au docteur Guillotin. En revanche, il paraît convenu entre nous qu’adosser un homme contre un mur et lui envoyer douze balles dans le corps ne s’appelle pas violer la vie humaine.
Le mode d’exécution ne nous inquiète pas, c’est l’exécution elle-même qui nous préoccupe. Si même il fallait choisir entre le fusil ou la guillotine, j’ai idée que je préférerais encore cette dernière, eu égard aux derniers préparatifs qui exigent un certain temps, tandis qu’il n’y a rien comme une arme à feu pour rayer avec promptitude un citoyen du nombre des vivants.
La terrible guerre que nous traversons n’établit que trop irréfutablement la vérité de ce que j’avance. Ce que nous voulons, ce n’est pas l’incendie de l’échafaud, c’est l’abolition de la peine de mort. »
Henri Rochefort, Le Mot d'Ordre, 7 avril 1871.
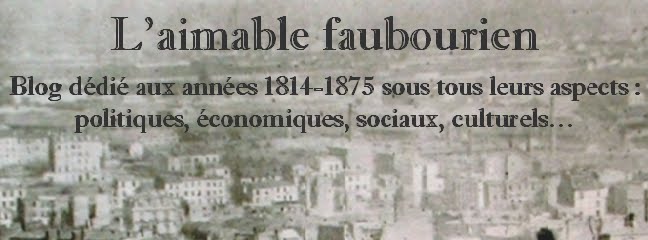

.jpg)









