« De l’abolition de l’esclavage colonial.
S’il est un gouvernement qui puisse porter une main hardie sur l’édifice colonial, c’est la République française […] ; et M. Arago, ce grand patriote, ce savant illustre qui dirige avec tant d’autorité le Département de la Marine, a parfaitement compris que rien ne l’empêchait de dompter les résistances de la caste souveraine des colonies et de briser les chaînes des opprimés.
De la servitude vient le mal, c’est la servitude qu’il faut attaquer, non par des demi-mesures, mais par un système large et généreux, qui, sans exposer ni la vie ni la fortune des colons, rende aux classes laborieuses l’intelligence et l’énergie indispensables au succès de leurs travaux.
Que sont, en effet, ces races humaines pour lesquelles les colons n’ont que violence et iniquité ? Ce sont des êtres comme nous, que l’abjection dans laquelle ils vivent n’empêche pas de ressentir les horreurs de leur sort… Dans leur sein battent des cœurs d’hommes, et dans ces cœurs bout le désir de se venger de ces humiliations et des outrages de la servitude.
Ce sont des esclaves, me direz-vous ; ils viennent d’un pays inconnu ; ils sont noirs, leur nez est épaté, leurs cheveux sont crépus, leur odeur est étrange ; ce sont des êtres intermédiaires entre l’homme et les animaux, des êtres voués au joug par leur infériorité native… Insensés ! qui acceptez si légèrement des sophismes dictés par l’orgueil et la cupidité, que ne cherchez-vous, dans l’inégalité des degrés de civilisation, la cause des différences de conformation entre les races ?
Les sauvages ont, en général, le front aplati et l’angle facial moins ouvert que les Européens… Qui vous dit que ce soit pas l’effet du défaut d’exercice de leur intelligence, et qu’il n’en soit pas de leur cerveau comme de leurs bras, d’ordinaire moins développés que leurs jambes, qu’ils exercent davantage.
Au surplus, où avez-vous vu que la race noire ne fût point perfectible ? Elle marche… comment assigner un terme à ses progrès ? Toutes ses tribus ne sont pas restées à l’état sauvage. Quelques-unes sont entrées dans la voie de la civilisation. Le puissance nation des Ashantées (dans la Nigritie maritime) a pris, depuis quelques années, un rapide et brillant essor, et les Anglais, vaincus par elle, ont été sur le point d’abandonner tous leurs établissements sur la Côte d’or.
Les voyageurs qui ont exploré récemment l’Afrique centrale ont rencontré des villes et des villages peuplés de nègres laborieux, hospitaliers et parfaitement policés.
Mais, dira t-on, ces facultés ne dépassent pas une certaine limite… Ce serait condamner en même temps les Chinois, les Arabes, les Tartares et une foule d’autres peuples qui, arrêtés par des causes locales ou politiques, n’ont point fait un pas depuis des milliers d’années.
Comment d’ailleurs refuser à la race noire les facultés divines d’une intelligence qui s’est révélée par de si éclatantes soudainetés chez des individus qui lui appartiennent ? Croyez-vous que Michel Lando à Florence, que Mazaniello à Naples, fussent des chefs plus étonnants d’une révolution populaire que Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe et tant d’autres Spartacus qui, nés dans les chaînes, s’élancèrent d’un bond au premier rang, et, sans autre guide que les inspirations d’un génie inculte, se montrèrent à la fois hommes de guerre, politiques habiles et législateurs profonds ? Ce n’est donc pas la capacité intellectuelle que l’on peut contester aux Noirs… […] »
Le Salut Public. Journal quotidien, politique, scientifique et littéraire, n° 4, dimanche 19 mars 1848.
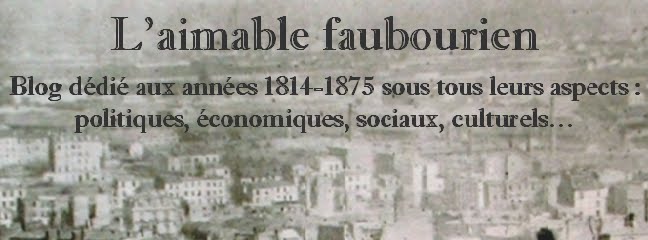

.JPG)









