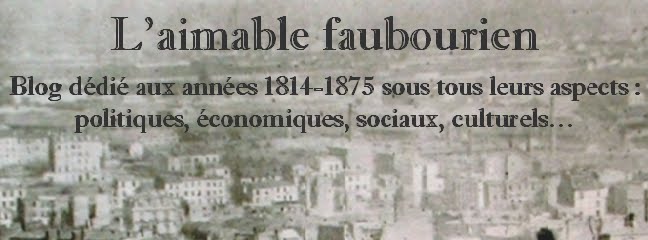« C'est le samedi 16 octobre 1858 que s'opéra notre débarquement. Les forçats et les repris de justice avaient déjà pris terre, lorsqu'à six heures du matin je fus conduit à l'île Royale, où je stationnai trois ou quatre heures, pour être en fin de compte dirigé sur l'île du Diable, résidence des détenus et transportés politiques. […]
Moins grande de beaucoup que ses voisines, derrière lesquelles elle se tient discrètement cachée, l'île du Diable, vue du canot qui m'y conduisait, m'offrit l'aspect le plus saisissant de la misère et de la désolation. Là, point de grands arbres pour arrêter les rayons du soleil, mais des arbustes rabougris, presque des broussailles; pas de routes sablées, nais des rochers chauves, pas d'édifices pittoresques, mais quelques rares constructions tenant le milieu entre la caserne et l'écurie. Voilà comment m'apparut le séjour où j'avais à passer dix années de ma vie, à l'âge où l'homme est moins que jamais sûr de récolter la moisson qu'il a semée. […]
La première autorité de l'île était, depuis quelques mois, un simple brigadier de gendarmerie, et c'est à lui que je fus remis par mon garde-chiourme. La réception fut convenable […]. C'était un homme encore jeune, et, à ce qu'il me semblait, valant mieux que son triste métier. II me dit qu'il y avait trois appels par jour, le premier à cinq heures du matin, les deux autres à six heures et à huit heures du soir, et que, sauf l'obligation de passer la nuit au dortoir commun, j'étais libre dans l’île. La liberté est assurément quelque chose, même dans une île qui n'a que 2,500 à 3,000 mètres de tour, sur une largeur moyenne de 400 mais on ne peut pas passer douze heures en état de vagabondage, et je me demandais avec une profonde inquiétude comment j'emploierais les loisirs que le gouvernement me faisait. […]
Si le paysage me parut aussi sauvage qu'un désert, je ne fus guère rassuré en voyant passer au loin des hommes aux pieds nus, aux traits brûlés par le soleil, aux vêtements en lambeaux ; c'étaient mes futurs compagnons. Si à ce moment une immense commisération s'éleva dans mon cœur, je mesurai tout aussi tôt le sort qui m'était réserve, et je ne cacherai pas que j'en fus médiocrement satisfait.
Serai-je donc ainsi dans quelque temps ? me disais-je. Vais-je, moi aussi, dépouiller mes habitudes pour me plier aux nécessités de la vie sauvage? Et j'étais là en plein soleil, ne sachant ou déposer mes malles, assez inquiet surtout de savoir si je pourrais déjeuner. Enfin, un déporté qui survint par hasard m'offrit de partager sa case, et, guidé par lui, je me dirigeai vers l'intérieur de l'île. Je rencontrai sur mon chemin des cabanes capricieusement semées à droite et à gauche, toutes bâties de pierres et de boue, à peine couvertes de paille de maïs, ornées de trous qui, suivant la grandeur, figuraient la porte ou la fenêtre. C'étaient les résidences de jour de mes compagnons et près d'elles assurément les dernières masures de nos paysans auraient passé pour des palais. Arrivé au logis de mon hôte, la vue de l'intérieur ne fit qu'ajouter à mes perplexités. Le mobilier se composait d'une table boiteuse et d'un escabeau, et, sauf la satisfaction que j'éprouvais d'échapper à l'ardeur du soleil ; je ne prévoyais pas que ce triste aménagement put en offrir d'autre. Quoi qu'il en soit, j'étais trop familiarisé avec les ennuis et les privations pour m'effrayer de si peu ; puis je savais par expérience que, s'il est prudent de ne jamais prendre au comptant les apparences favorables, la situation la moins séduisante comporte une somme de ressources qu'il suffit de savoir trouver. Fort de cette réflexion philosophique, j'attendis patiemment la distribution des vivres, et je profitai de ce répit pour recueillir quelques renseignements sur le personnel auquel je venais de m'adjoindre et sur les conditions du régime que j'avais à subir.
Au moment de mon arrivée, les détenus de l'île du Diable étaient au, nombre de 36, moi compris; ils se divisaient en plusieurs catégories la première, en date comme par le nombre, se composait de citoyens frappés au 2 décembre 1851; puis venaient des transportés de juin 1848, que, sous un prétexte ou sous un autre, on avait transportés d'Afrique à la Guyane; enfin, les condamnés des ardoisières d'Angers, plus quelques condamnés pour sociétés secrètes, et l'infortuné Tibaldi, condamné judiciairement à la déportation, le seul de nous tous pour lequel l'amnistie du 16 août 1859 n'ait apporté que de nouvelles rigueurs ! J'allais oublier deux noirs du Sénégal qui avaient été expatriés et transformés en prisonniers politiques, parce que leur séjour dans nos possessions de l'Afrique occidentale portait ombrage aux autorités.
Cette petite colonie, formée d'éléments passablement disparates, ne me semblait pas sentir aussi vivement que je le faisais les rigueurs et les humiliations du régime auquel elle était soumise. Mais je ne tardai pas à comprendre les motifs de cette différence d'appréciation. Les horribles épreuves que mes compagnons avaient traversées précédemment les rendaient moins sensibles aux inconvénients devant lesquels s'effarouchait ma susceptibilité de nouveau débarqué; en songeant au passé, ils se trouvaient presque heureux du présent. Naguère obligés de travailler comme les forçats, ils jouissaient maintenant d'une liberté relative et disposaient de leurs temps à leur gré. Cette concession tardive, qui n'était en somme que l'abandon d'une monstrueuse violence et qui laissait subsister toutes les misères de la séquestration dans l'exil au désert, cette concession, si chèrement achetée, avait en quelque sorte réconcilié mes compagnons avec le détestable séjour de l’île du Diable.
Mais parce que le prisonnier politique souffre sans se plaindre, faut-il amnistier ses geôliers, qui, ne pouvait triompher de la résistance passive opposée à leurs fureurs, ont, de guerre lasse, dû modifier un système aussi injustifiable devant là loi que devant l'humanité ? En vérité, ce serait faire la part trop belle aux serviteurs éternels de toutes les tyrannies, et ce n’est pas cette balance qu'il faut peser les actions qui affectent la dignité et la liberté des citoyens. Ne l'oublions pas, le dogme commode de l’obéissance passive ne détruit pas la responsabilité individuelle, car la responsabilité individuelle est la condition indispensable de la moralité publique; elle ne se rachète pas avec des accès d'humanité partiels, avec des caprices qui se rencontrent de loin avec la justice. Nul ne peut se faire le ministre de l'iniquité. Voilà le principe, et l'adoucissement d'une consigne barbare ne suffit point pour absoudre celui qui n'a pas craint de l'accepter, et qui, par un retour en arrière, cherche moins à servir la justice qu'à ménager sa sécurité. Nous vivons, qui ne le sait ? dans une époque où l'éducation sociale est à refaire de fond en comble; où les plus déplorables préjugés dominent tous les esprits; mais, avant quelques années, on aura peine à comprendre comment la France a pu, depuis 1848, fournir tant de mouchards, de geôliers et de bourreaux. »
Charles Delescluze, De Paris à Cayenne, journal d'un transporté, Paris, Le Chevalier, 1869 (texte rédigé en 1864).