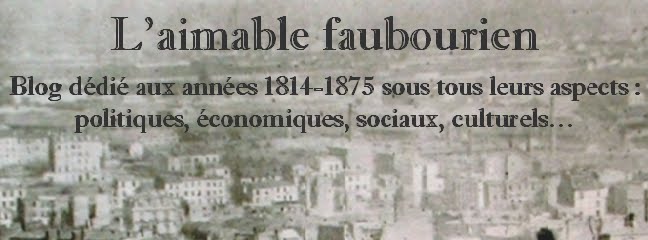Jean-François Gravelet, dit "Charles Blondin" (né à Saint-Omer, en 1824 - mort à Londres en 1897).
« Blondin est un mythe, Blondin n'est qu'un canard. D'abord, il a passé la rivière, et comme le dit la chanson : les canards l'ont bien passée. Il est vrai que la rivière de Blondin c'étaient les chutes du Niagara. Un nageur intrépide avait déjà voulu traverser ce fleuve à la nage, mais il s'était fait attacher à un bateau ; un autre prétendait traverser les rapides qui précèdent les cataractes sur des échasses de fer, mais il avait disparu sans dire s'il reviendrait pour exécuter son projet. C'est alors, en 1859, qu'un journal américain raconta que Blondin, acrobate français, dont personne n'avait encore entendu parler, venait de traverser d'un bord à l'autre le Niagara en marchant sur le câble en fil de fer d'un pouce de grosseur qui est tendu entre les deux tours du pont suspendu, à 10 pieds au-dessus de tons les autres câbles. Les compliments qu'il avait reçus pour ce haut fait l'avaient porté, continuait le journal, à faire mieux, et l'idée lui était venue de traverser d'une rive à l'autre, sur une corde posée en aval des chutes, à moitié chemin à peu près des cataractes au pont.
Le Times de New-York s'étonna que, les magistrats n'eussent rien fait pour empêcher un pareil acte de témérité. Le Courrier des États-Unis prit la peine de rassurer son confrère : Blondin avait fait quelque chose de bien plus difficile en passant cette corde elle-même au moyen d'un faible grelin. Le surlendemain Le Courrier des États Unis raconta qu'à l'heure dite Blondin avait traversé le Niagara, offrant galamment de porter un voyageur sur son dos, proposition que personne n'avait acceptée. Blondin, disait-il, était en maillot rosé, il s'est avancé le front haut et sans balancier. En le voyant danser sur son câble, qui à celte hauteur avait l'apparence d'un fil, les respirations étaient suspendues. Tantôt il se balançait sur un seul pied, tantôt il bondissait, tantôt il se couchait sur le dos, s'allongeait le long de la corde, tournait, retournait, se mettait à califourchon. Arrivé au milieu de la corde, Blondin s'est placé debout, dans la position d'un homme qui avance la tète hors d'une fenêtre, et se penchant légèrement sur l'abîme, il a tiré de sa poche une ficelle qu'il a déroulée lentement. Un petit vapeur cet venu sous le câble, a attaché au bout de la ficelle une bouteille de vin que Blondin a remontée, et, saluant l'aimable société, il l'a bue à la santé de ceux qui le regardaient, a jeté la bouteille au diable, et a repris le chemin du Canada, où il est arrivé dix-neuf minutes après son départ de la rive américaine : des hourras, des bravos retentirent de toutes parts. Les Canadiens le retinrent une demi-heure, et Blondin est revenu a son point de départ en 8 minutes. Les spectateurs placèrent alors le petit Français sur leurs épaules et le portèrent en triomphe jusqu'à une voiture.
Tel fut le premier récit de ces voyages merveilleux qui ne pouvaient manquer de se reproduire. La seconde fois le journal accusait 10,000 spectateurs, c'était 2,000 de moins que la première. Blondin se couvrit la tête d'un sac épais qui l'empêchait de lien voir, mais il s'aida d'un balancier. Puis il passa le Niagara avec une brouette ; puis il le passa ayant sur le dos un individu, M. Colcord, qui devint son agent à New York; puis il recul dans son chapeau une balle que lui envoya le capitaine du petit steamer stationnaire sur le fleuve; puis il traversa le fleuve la nuit, au milieu des feux d'artifice. Il avait attaché quantité de lanternes de couleurs différentes aux deux extrémités de son balancier; malheureusement la moitié de ces lumières tomba dans le gouffre, ce qui diminua l'effet. Arrivé au milieu, il se posa sur la tête. Ses lumières s'éteignirent, et il atteignit la rive canadienne, dans l'ombre, avec autant de facilité que si la lune eût éclairé. Il revint entouré d'un cercle de fer d'où partaient des chandelles romaines ; au milieu il se suspendit encore par les pieds et revint dans l'obscurité la plus complète. Enfin Blondin emporta un fourneau et des œufs, et se mit à faire au milieu de sa corde des omelettes qu'il envoyait au capitaine du steamer. C'était, comme on dit, incroyable, et quelques journaux américains déclaraient que vraiment cela valait l'argent qu'on dépensait pour se transporter à ce surprenant spectacle. »
Dictionnaire de la conversation et de la lecture: inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables a tous, offrant le résumé des faits et des idées de notre temps, Vol. 1, Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1864.
____________________
« Besoin d'émotion.
(Londres, 25 juin 1861)
II a été donné à Blondin de se faire ici une place importante dans le domaine des préoccupations publiques. Cet homme... Est-ce bien là le mot ? Je n'en sais trop rien, ma foi ! A le voir se tenir debout, s'asseoir, marcher ; à l'entendre parler, etc., etc., rien, assurément, n'indique qu'il appartienne à une autre espèce que vous et moi, c'est-à-dire à la catégorie des êtres que le philosophe grec, si bien réfuté par Diogène, définissait "un animal à deux pieds et sans plumes". Mais ce qui est sûr, c'est qu'à tous les attributs d'un animal pensant il joint ceux du singe le plus agile qu'ait jamais produit la création. II faut le voir courir avec la vélocité d'Hippomène — pour employer des comparaisons plus nobles — sur une corde longue de cinq cents pieds, placée à deux cents pieds du sol, et cela la tête couverte d'un sac qui fait la nuit autour de lui ! ll faut le voir se tenir renversé au centre de cette corde, la tête en bas, les pieds en l'air, les bras étendus ! L'autre jour, au Cristal-Palace, ne s'est-il pas avancé sur la corde roide, chargé d'un énorme appareil de cuisine, et ne s'est-il pas assis sur cette corde — à une hauteur de 150 pieds, n'oubliez pas ceci — pour faire une omelette, opération qu'il a menée à bonne fin, à travers tous les procédés requis ? Et vous figurez-vous un homme capable d'exécuter sur la corde le saut périlleux, avec un abîme béant au-dessous de lui, et monté sur des échasses ? Quel prodige de précision mathématique peut le sauver de la mort, lorsque, entre la mort et lui, il y a moins que l'épaisseur d'un cheveu ? Mystère !
Le succès qu'il a eu en Angleterre, vous le devinez. Exprimé en chiffres, il revient à ceci : Blondin a été engagé au Cristal-Palace pour douze représentations, elles actionnaires se trouvent avoir conclu un excellent marché, en ne lui offrant comme salaire que... 30,000 fr. Tout récemment, à Bradford, deux exhibitions de ses hauts faits gymnastiques lui ont valu 6,250 fr. Jugez du reste !
Une singulière querelle s'est élevée, à Bradford, entre lui et le comité du parc, qui l'avait engagé. Le comité, par des motifs de sagesse financière aisés à comprendre, ne voulant pas qu'on pût jouir du spectacle sans payer le droit d'entrée, avait fait placer la corde à une hauteur calculée de manière à ce qu'elle n'excédât pas celle des murs d'enceinte. Blondin arrive. Et comment rendre son indignation à la vue d'une corde qui n'était guère qu'à cent pieds du sol ! On a eu toutes les peines du monde a le consoler. Nul doute cependant qu'une hauteur de cent pieds ne fût tout ce qu'il lui était permis d'exiger raisonnablement pour se rompre le cou.
On avait fait courir le bruit que Blondin offrait 2,500 fr. (100 liv. st.) à quiconque consentirait à être porté par lui, dans ses promenades sur la corde. Ce bruit est sans fondement. Ce qui est vrai, et ce qui a été par lui-même raconté à un de mes amis, c'est qu'un beau jour il a reçu une lettre ainsi conçue : "Monsieur, on assure que vous offrez 100 liv. st. à quiconque se laissera porter dans vos bras. Je suis à votre disposition, et me contenterai même de 50 liv. st., à condition toutefois que si, par impossible, vous veniez à commettre quelque erreur, — a mistake, — la somme serait remise à ma mère." A Bradford, on m'affirme qu'un gentleman s'est proposé pour rien, par pur amour de l'art ! Ceci est à ajouter au chapitre des excentricités anglaises. Un fait assez amusant à constater est celui-ci : Au temps de la guerre de Crimée, et, plus tard, pendant la guerre d'Italie, lorsqu'il n'était bruit en Europe que des exploits de nos zouaves, nombre d'Anglais tenaient absolument à ce que les zouaves fussent des Arabes : eh bien, le même sentiment pousse nombre d'Anglais à prétendre que Blondin est un Canadien. Il a beau être de Saint-Omer ; il a beau n'avoir rien de commun avec le Canada, que d'y avoir fait un voyage, je connais des Anglais qui refuseront à Blondin le privilège d'être de son pays, jusqu'à ce qu'il leur ait montré son acte de naissance. Et même alors, je ne suis pas bien sûr qu'ils se rendent.
Pour compléter ces détails, j'aurais à vous représenter l'incomparable acrobate poussant devant lui, sur la corde roide, sa propre fille, assise dans une brouette ; et l'enfant— car ce n'est qu'une enfant—faisant pleuvoir sur le public, du haut de son trône mobile, une pluie de fleurs lancées çà et là avec une grâce à vous faire dresser les cheveux sur la tête, et la mère, là, en face, assistant à ce formidable spectacle, d'un air parfaitement rassuré ; et la Chambre des Communes finissant par dire : "Ah! pour le coup, c'est trop fort!" Mais cette circonstance, vous l'avez déjà mentionnée vous-même, et elle a donné lieu, de votre part, à un court commentaire auquel je m'associe du fond du cœur. C'est peu; s'il faut vous dire toute ma pensée, je trouve immoral qu'on laisse ainsi un homme faire profession de jouer publiquement avec la mort, pour le plus grand amusement des désœuvrés, des hommes blasés et des petites-maitresses auxquelles il faut des émotions fortes. C'est une horrible éducation donnée au public que celle de ces jouissances féroces. Il est très-intéressant, j'en conviens, de voir jusqu'à quel point l'organisation physique du corps de l'homme est merveilleuse, et il ne l'est pas moins de pouvoir juger de la puissance illimitée de l'habitude, dont on a coutume de dire que "c'est une seconde nature", et dont il serait plus juste de dire, que "c'est la première". Par malheur, là n'est point la vraie source de l'intérêt qui s'attache à ces sortes de spectacles. Le danger que court l'acteur, voilà ce qui en constitue, pour le plus grand nombre, le charme affreux. S'il en était autrement, quelle nécessité de placer la corde à 200 pieds du sol ? Or, que devient, avec de semblables exhibitions, ce respect de la vie humaine, qui est une des plus essentielles vertus de l'homme civilisé? Il y a en ce moment, à Londres, un autre de nos compatriotes, nommé Léotard, dont les exercices gymnastiques sont aussi une merveille ; mais lui vous enchante, sans vous donner le frisson ; on peut admirer sa prodigieuse souplesse, sans que la pâleur vous monte au visage. Hélas ! J’ai bien peur qu'à cause de cela même, Léotard ne soit moins couru que Blondin. »
Louis BLANC, Lettres sur l’Angleterre, vol. 1, Paris, Lacroix, Verboeckhoven & cie, 1866.